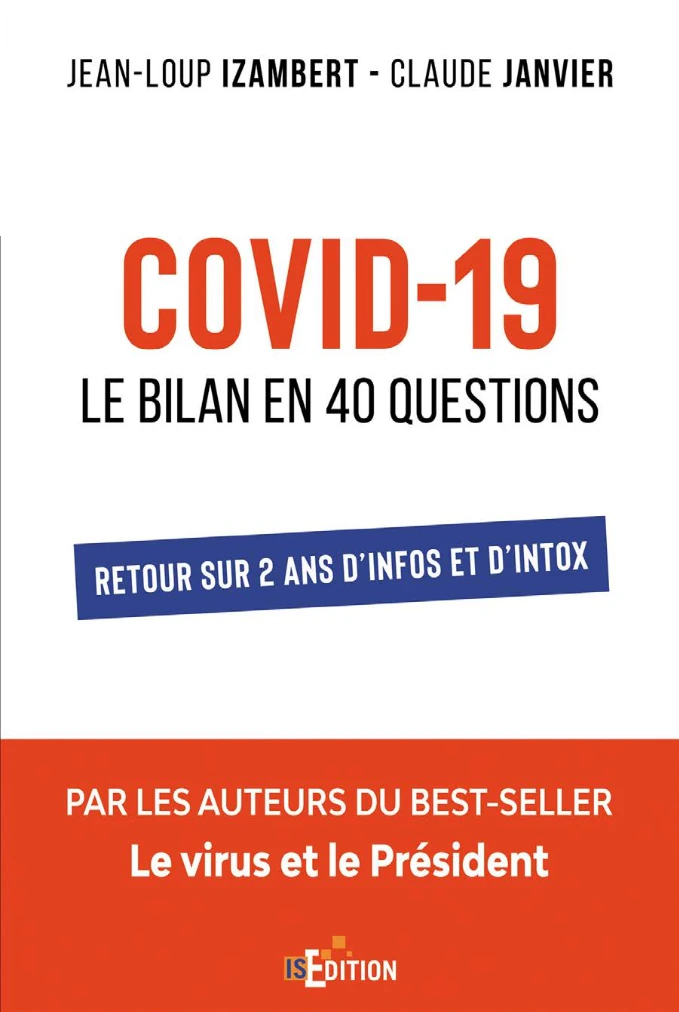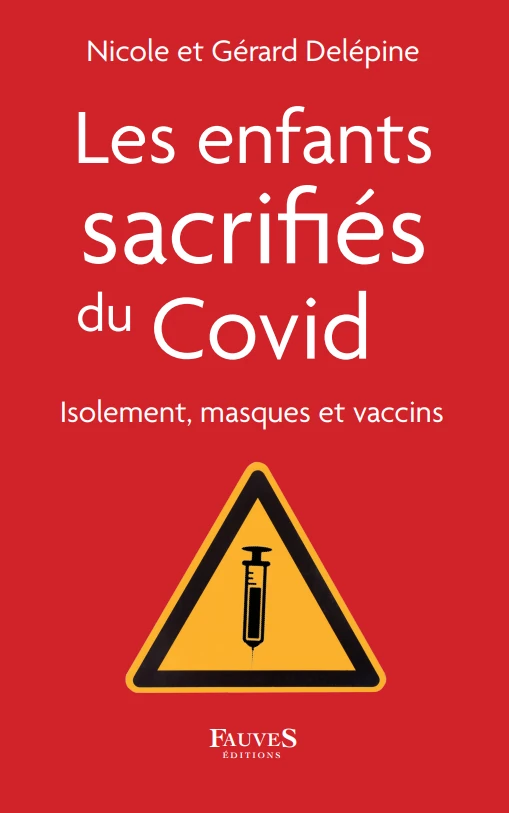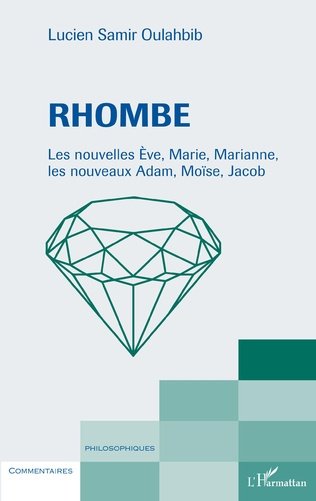19/04/2024 (2024-04-19)
Alain Damasio : « Il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir »
[Source : reporterre.net]
[Photographies : Patrice Normand]

© Patrice Normand / Reporterre
Par Hervé Kempf
L’écrivain Alain Damasio sort Vallée du silicium, chroniques inspirées d’un voyage dans la Silicon Valley californienne. « Les technocapitalistes visent la libération individuelle, ils vivent dans un élitisme absolu », dit-il.
Alain Damasio, écrivain, publie Vallée du silicium (Seuil), des chroniques et une nouvelle science-fiction inspirées de son séjour dans la Silicon Valley, aux États-Unis. « La matérialité du monde est une mélancolie désormais », annonce le bandeau du livre.
Écoutez ce grand entretien ci-dessous ou sur une plateforme d’écoute de votre choix.
Reporterre — Quelle conception de l’avenir les technocapitalistes de la Silicon Valley ont-ils ?
Alain Damasio — Un avenir où l’innovation technologique continuera à constituer la norme, quel que soit son impact sur nos ressources terrestres. Un avenir où le désirable pour l’humain serait son augmentation (cognitive, physique) au sens du transhumanisme. Un avenir où l’épanouissement individuel par la technologie doit primer sur les liens aux autres et aux vivants.
Ton livre se présente comme une démarche anthropologique. Pourquoi ?
À l’origine, je ne l’ai pas intentionnellement construit comme ça, mais dès que tu t’interroges sur ce que la technologie fait à l’homme, tu déploies nécessairement des réflexions sur l’espèce humaine et son évolution, sur la manière dont le numérique nous transforme et dont la Silicon Valley nous façonne. Un champ crucial reste celui du corps. Les transhumanistes ont ce mot terrible pour le désigner : meat. La viande. C’est une chair morte, non irriguée. Seul le système nerveux central compte. Le reste, la chair frissonnante, les muscles, toutes nos sensations, notre sensualité fine ne les intéressent pas, parce que cela ne véhicule pas d’information exploitable dans le régime de la trace. Ce corps est maintenu en forme par le fitness ou la course dans le seul but que le cerveau et le système d’informations puissent fonctionner.
Le corps est conçu et vécu comme une machine. La nourriture est énergie. Le sport est une hygiène. Le cerveau s’optimise. Le bien-être s’algorithme. Ce corps est désaffecté, désinvesti. C’est un corps qu’on ne sent plus, qui n’a plus d’existence et qui ne te sollicite plus parce qu’il est maintenu dans un environnement climatisé, souvent assis, et dans une absence de mobilisation émotionnelle et affective.
Cette vision machinique du corps peut être reliée à celle de la planète. Quelle conception les gens de la Silicon Valley ont-ils de la planète Terre ?
La façon dont ils traitent les corps fait écho à la façon dont ils traitent la planète. Dans les deux cas, ils se vivent comme maître et possesseur de la nature — de ma nature pour le corps. Leur degré de conscience écologique très faible m’a frappé : le peu de magasins bios par rapport à la France, par exemple. L’alimentation reste un sujet dépolitisé chez eux. La prise de conscience de l’élevage, de ce qu’il faut pour produire la malbouffe m’a semblé inexistante. Les Californiens vivent sous une climatisation constante, et ne supportent plus que le corps sorte d’une fourchette entre 20 et 25 °C, ce qui devient aussi la norme en Europe. Maintenir un corps humain à ces températures en permanence représente une dépense énergétique énorme. Pour que ce corps n’ait plus besoin de faire le moindre effort, le climat a été domestiqué. Autant, en France, nous sommes en retard de dix ans sur leurs usages quotidiens de la technologie, autant, dans cette Californie techie [passionnée de technologie], la prise de conscience écologique m’a paru très « arriérée ».

© Patrice Normand/Reporterre
Dans « Homo deus », Yuval Noah Harari parle de « surhommes » et de « castes inférieures », à propos de la société future créée par le développement des technologies. Penses-tu que cela décrit la vision des technocapitalistes ?
Ils vivent effectivement dans un élitisme « naturel ». Les leaders de la Tech n’ont pas la naïveté de croire que les apports transhumanistes puissent être universalisés. Ce n’est pas leur problème. Ils sont structurés autour de la libération individuelle, l’évidence de s’extraire des régulations étatiques, l’inégalité sociale comme une conséquence inévitable de l’accumulation du capital. Donc le transhumain est conçu pour une petite élite. Et peu importe que cette augmentation soit souvent strictement quantitative, oublie toute intelligence relationnelle ou émotionnelle et qu’elle trahisse une vision de sociopathe.
Le technocapitalisme se militarise, nous fait-il la guerre ?
Je ne pense pas qu’il fait la guerre au sens où il aurait une volonté politique d’exercer un pouvoir sur les populations. C’est un système très pragmatique, fondé sur l’action et dont le seul objectif reste la maximisation du profit. Ce qui implique bien sûr un large spectre de manipulations comportementales pour opérer. La Silicon Valley exerce des effets de pouvoir colossaux, qui sont d’abord un pouvoir sur les usages et les pratiques, le rapport concret à son environnement, aux autres, un impact induit sur la gestuelle et le corps. Bien sûr, les pouvoirs établis, les gouvernements, les médias mainstream, les armées et les polices, récupèrent ces outils pour leurs propres besoins et renforcer leur contrôle, leur influence ou leur maîtrise sur nos vies. Mais selon moi, l’impact de la Tech est d’abord anthropologique et « souple » avant d’être militaire ou sécuritaire.

© Patrice Normand/Reporterre
Dans ton livre, tu soulignes la tension entre peur et liberté. Est-ce une des tensions les plus fortes du monde actuel ?
Oui. Il y a vingt ans, on se demandait où l’on se situait sur une ligne entre liberté et sécurité, et dans quelle mesure des pratiques libres et émancipatrices étaient favorisées par rapport à des pratiques sécuritaires et identitaires. Cette tension a été enfouie tellement les logiques sécuritaires l’ont emporté, ce qui explique ce grave décalage du spectre politique vers la droite, en Europe et ailleurs. Selon moi, ce phénomène a aussi une origine anthropotechnique : la logique immunitaire hygiéniste appliquée au corps aboutit à la sensation que tout devient dangereux. Plus tu es protégé et plus tu te protèges, plus le technococon devient épais et plus tu filtres tes rapports aux autres, si bien que la moindre intrusion, agression, harcèlement ou confrontation à l’altérité te paraît problématique et difficile. Et donc, tu vas demander encore plus de sécurité et de protection. Ce cercle vicieux tend vers quelque chose qu’il faut appeler l’immunité. Mais immunité partout, humanité nulle part !
Et cette logique du tout sécuritaire conduit à un repli sur soi…
Oui, alors que pour être libre, il faut accepter que les liens que tu vas tisser avec les autres te libèrent et ne sont ni des chaînes, ni des dangers, ni des menaces. Il faut sortir de la peur de l’autre : se confronter à l’altérité entraîne forcément de se confronter à l’inattendu, à l’imprévisible, à ce qui peut te déstabiliser. La principale critique que je forme envers nos technologies quotidiennes est qu’elles conjurent l’altérité. Elles sont construites pour fabriquer de l’identique. Home est son biotope : le petit chez-moi, familier, le cocooné, le confortable, le cajolé. Sauf que cette vision, et les pratiques de rejet qui l’accompagnent nécessairement, sont d’une grande violence pour les gens qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de ce technococon égocentré.
Dans Le ministère du futur, Kim Stanley Robinson décrit la situation écologique et inégalitaire actuelle et imagine des écologistes tuer, prendre des milliardaires en otage, faire exploser des avions. Qu’en penses-tu ?
C’est la bonne solution aussi, à mes yeux. Je suis un partisan de l’action directe. On subit de façon trop molle et complaisante des actes d’une violence et d’une agressivité absolues. Les technocapitalistes ne se posent pas la question de ce que leur vision du monde produit sur nos vies ordinaires. Les actions directes, comme le sabotage, le brouillage, le piratage des chaînes de production, le boycott des produits, me semblent très souhaitables. Lorsqu’on dit ça, on donne l’impression d’être radical et hystérique alors qu’on énonce une banalité lucide. Ce qui est radical est ce que la Tech fait : ne pas s’interroger sur l’impact de la production d’une voiture électrique sur le travail des enfants en Afrique, par exemple, ou le pillage minier. Il faut stopper, invalider et inverser cette violence, la retourner. Et utiliser tous les moyens dont on dispose : le hacking [pénétrer illégalement dans un système informatique], les blocages, les occupations, la lutte des imaginaires, l’artivisme, les ZAD, etc. Il y a toujours des failles et il faut les utiliser. Mais aujourd’hui, très peu de militants sont prêts à prendre des risques parce que…
Parce qu’en face, il y a des appareils de répression de plus en plus élaborés et sophistiqués…
Complétement. C’est très intéressant de revoir l’histoire du mouvement Action directe dans les années 1970-1980. Ils pouvaient faire dix ou quinze actions avant que la police se mobilise ou qu’ils soient mis en prison. Aujourd’hui, des gens taguent une usine Lafarge et ils subissent une surveillance colossale, des peines de prison disproportionnées, quatre-vingt-seize heures de garde à vue. Le système répressif est d’autant plus féroce que les actions sont rares et modestes, c’est un paradoxe qui traduit un étouffement dans l’œuf de toute contestation. À nous d’être fins.
Cette surveillance est permise par l’intelligence artificielle et les instruments numériques.
On ne parle pas assez du couplage entre le régime de contrôle et le régime numérique. À partir du moment où le régime de contrôle, qui apparaît dans les années 1990, s’est couplé avec les possibilités du numérique, une puissance de feu colossale est apparue. Les degrés de surveillance et de finesse de contrôle n’ont jamais été aussi importants qu’à l’heure actuelle.
Quelle serait la résistance au système que tu décris et que nous subissons ?
Je n’aime pas le terme de résistance parce qu’il revient à considérer que malgré tout, le système va continuer à opérer, qu’il sera toujours dominant et que notre capacité est seulement d’en limiter les effets négatifs. Je pense qu’il faut construire des alternatives, proposer d’autres façons d’exister, de s’alimenter, d’habiter. Puis de montrer que ça marche et surtout que ça nous rend heureux et libres. Il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir.

© Patrice Normand/Reporterre
C’est extrêmement difficile parce que le technocapitalisme est fondé sur l’accomplissement de désirs individuels et immédiats. Je détaille dans mes chroniques ces quatre machineries de désir très puissantes que le technocapital active : la paresse plaisante, le pouvoir octroyé, la conjuration des peurs et des incertitudes et l’imaginaire du transhumain, cet antique désir « d’être dieu », d’échapper à notre finitude. Il faut ressusciter un désir qui fasse pièce à cette économie de désir qu’accomplit magistralement la consommation numérique. C’est un sacré défi, c’est un sacré combat.
Où se déploient aujourd’hui ces formes de résistance ?
De ce que j’observe, les nouvelles formes de libération se jouent désormais plutôt dans les zones rurales : campagnes, montagnes. Il y a un vrai retour à la terre, à l’image des années 1970. Beaucoup de communautés, d’oasis, de tiers lieux, de quarts lieux, de zones d’expérimentation, de ZAD se développent. Ça se passe sous les radars des médias urbains qui constituent la majorité des médias. Mais ça existe et ça résonne très au-delà des sites où ça naît, comme la ZAD de Notre-Dame l’a fait. Pour moi, l’espoir et les avancées concrètes se forment dans ces zones rurales et par ces expériences : maraîchage de montagne, économie du gratuit, intelligence collective, renouement aux forces du vivant, techniques de subsistance, fluidité de genres.
Je trouve l’idée de « zone » très forte. Il ne s’agit ni d’un domaine clos, ni d’une communauté autarcique, ni seulement d’un habitat partagé. C’est plus ouvert, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de frontières, ça rayonne et s’étend. On ne changera pas ce monde fondé sur les désirs individualisés et les échanges immatériels sans expérimenter en collectif, éprouver d’autres modes de vie qui destituent les effets de pouvoir, s’alimenter en bio, local et frais, trouver une autonomie énergétique, pratiquer le low-tech qui t’empuissante dans ton rapport à la techno, etc. Et surtout sans réactiver des liens au monde, au vivant et aux autres, qui te rendent plus vaste, plus joyeux et plus vif. On a besoin de lieux, d’espaces concrets pour ça et de pratiques incarnées, on a besoin de créer aussi, sans cesse, pour déjouer les machines de pouvoir qui nous pilotent.

⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.