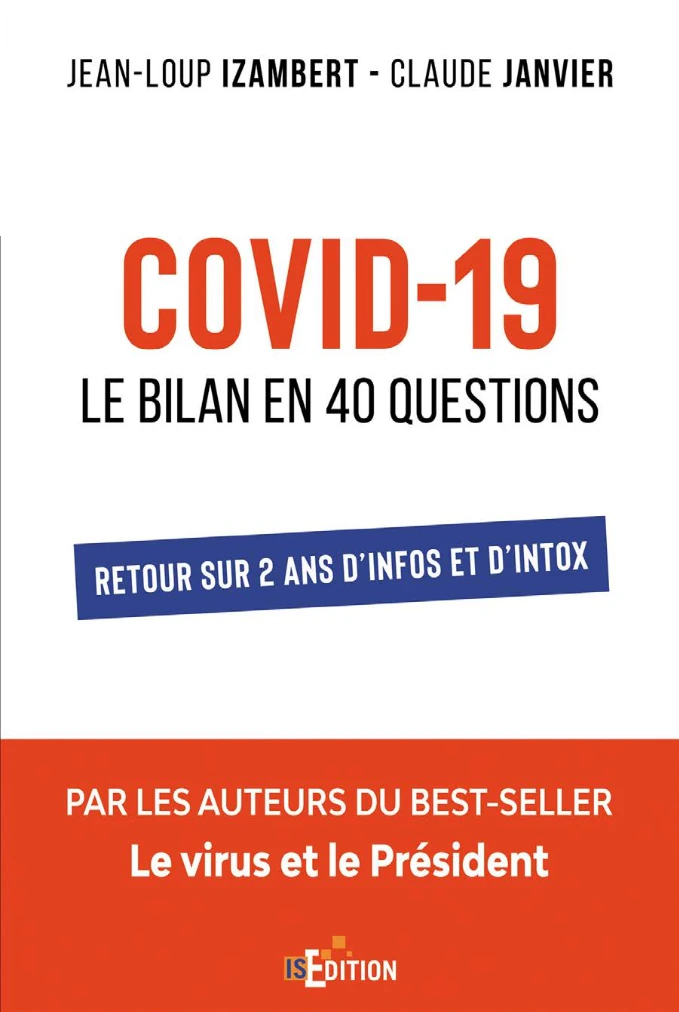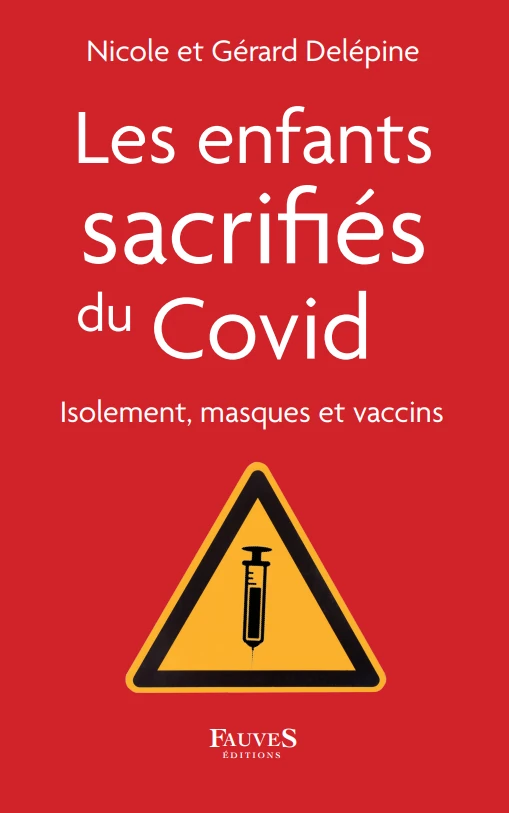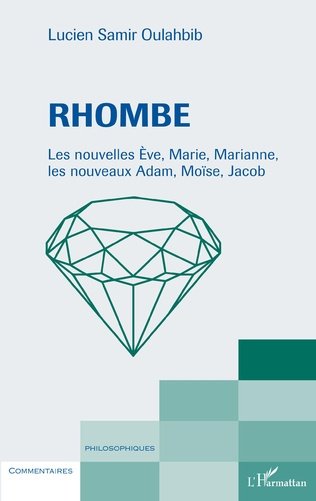10/03/2021 (2019-07-07)
[Source : Reporterre]

Comment tendre vers « l’innovation écologique radicale » ? Pour le chercheur François Léger, chercheur en agroécologie, c’est en s’intéressant aux microfermes qui permettent l’autonomie alimentaire et sociale, et en repartant « de l’intime et du sensible pour repenser nos systèmes politiques ».
François Léger est enseignant-chercheur au sein d’une unité mixte Inra/ AgroParisTech dédiée à l’agriculture urbaine. De 2011 à 2015, il a coordonné une étude sur la « performance économique du maraîchage biologique en permaculture » à la ferme biologique du Bec Hellouin, située dans l’Eure.

- Cet entretien est publié dans le livre Un sol commun, aux éditions Wildproject, paru en mai 2019, et repris en « Bonnes feuilles ».
Marin Schaffner [1] — Quels ont été vos premiers pas dans l’agroécologie ?
François Léger — J’ai fait de la biologie à l’université, où je me suis intéressé peu à peu à l’écologie des milieux anthropisés et en particulier des milieux agricoles, ce qui m’a orienté vers l’agronomie. J’ai enchaîné avec un doctorat d’écologie, sur la relation de paysans mexicains à leur environnement. Ce qui a été pour moi essentiel, ça a été de comprendre que ces paysans ne cultivaient pas simplement du maïs : ils construisaient et géraient durablement un agroécosystème. Cette « révélation » m’a orienté vers une interprétation de l’agriculture comme médiation technique entre les humains et les écosystèmes qu’ils habitent. Et les rencontres avec certains des promoteurs de l’agroécologie scientifique dans les années 1980 – Efraïm Hernandez Xolocotzi, Miguel Altieri – m’ont permis de trouver le cadre théorique qui me faisait défaut pour explorer cette voie et étudier des systèmes agricoles dans leur globalité écologique, sociale et culturelle. De retour en France, j’ai travaillé dans un organisme de recherche-développement en élevage. J’ai eu à m’occuper des mesures agroenvironnementales à visée de protection de la forêt méditerranéenne ou de conservation d’espèces et d’habitats remarquables, impliquant des élevages extensifs. Une part importante des éleveurs engagés dans ces mesures pratiquait des formes d’agriculture très éloignées des modèles industriels/productivistes partout recommandés. J’ai découvert que s’ils étaient généralement moins efficaces en termes de volumes de production, beaucoup d’entre eux, parce qu’ils fondaient leur action sur une intelligence écologique aiguisée, gagnaient finalement mieux leur vie et avaient un bien-être au travail nettement supérieur à celui de leurs homologues qui s’étaient pliés à ce modèle dominant. Une bonne partie de mon combat – si je peux dire – a été ensuite de contribuer à démontrer que vertu écologique, construction de lien social dans les territoires, bien-être des individus et efficacité économique n’étaient pas contradictoires. Cette idée ne rencontrait pas forcément beaucoup de succès. Les verrouillages cognitifs, scientifiques et institutionnels restaient trop nombreux et trop forts. Ce n’est qu’il y a quelques années qu’elle a fini par être partiellement admise, avec l’idée d’une « agriculture écologiquement intensive ». Et il aura fallu attendre 2017 pour que l’Insee publie une étude montrant – pour le lait, le vin et le maraîchage – que, oui, on gagne mieux sa vie en faisant de l’agriculture biologique.

Comment définiriez-vous l’agroécologie en quelques mots ?
L’agroécologie c’est avant tout un déplacement de l’attention de la production vers les humains pris dans leurs écosystèmes, et même, plus précisément, pris dans des réseaux d’interactions qui font écosystèmes, le tout avec une finalité claire : la transformation des systèmes alimentaires vers un plus grand bien-être des écosystèmes et des humains. De ce point de vue-là, la devise des permaculteurs « prendre soin de la terre, prendre soin des humains » me convient, et je dirais même que ce principe est à la base de toute forme d’écologie politique, dans le sens où il n’y a pas de séparabilité de l’environnemental et du social.
Tout à l’heure vous parliez « d’intelligence écologique », qu’entendez-vous par là ?
L’intelligence écologique, c’est la capacité à comprendre comment faire avec le vivant et non contre lui. Mais comment acquérir cette intelligence, comment la construire, voilà pour moi des questions essentielles. J’ai passé une bonne partie de ma vie à côtoyer des paysans qui ne travaillaient pas comme on leur disait de faire, et qui devaient donc inventer leurs propres corpus de savoirs et de savoir-faire. Ils m’ont montré que l’une des grandes forces de cette intelligence écologique pragmatique, c’est qu’elle ne relève pas d’une connaissance analytique exhaustive, mais plutôt d’une connaissance holiste, intuitive, poétique et sensible.
L’Occident a réalisé cette abomination qu’est la négation de notre appartenance à la nature, de notre existence comme corps vivant. À ne vouloir être que le produit de notre cerveau, nous ne pouvons que nous servir mal de lui. De là découle notre incapacité à développer une pensée politique et morale sur l’environnement, puisque nous avons réduit tout le réel en objets, en utilité immédiate, en valeur marchande. L’urgence de l’écologie me semble être de reconnecter les gens aux autres vivants (même aux guêpes et aux araignées, en assumant la peur qu’elles nous inspirent). Nous devons repartir de l’intime et du sensible pour repenser nos systèmes politiques. Et, à ce titre, face à la dégradation de nos conditions de vie, les questions de santé me semblent être centrales pour l’écologie, parce qu’elles remettent au premier plan notre propre corporalité.
L’agriculture industrielle n’est-elle pas symptomatique de ce rapport utilitariste au monde ?
Si, bien sûr, puisque c’est une agriculture du détachement. Elle fait fi de la réalité biologique et sensible du monde, tout en prétendant à une capacité de contrôle absolu sur un vivant absolument chosifié. Cette agriculture, et l’alimentation qui va avec, sont consubstantielles de l’ordre capitaliste du monde. Le modèle de l’agriculture industrielle et la relation dominatrice au monde qui lui est sous-jacente conduisent à la destruction de la vie, à la disparition des paysans, à la malbouffe. Cette souffrance du monde, des animaux, des plantes, des sols, des humains eux-mêmes, n’a aucune justification.

Vous avez également travaillé sur les microfermes. Quelles analyses avez-vous pu en tirer ?
Le développement agricole de ces soixante dernières années, basé sur des modèles d’exploitations toujours plus grandes, affirmait que le progrès exigeait des économies d’échelle permettant de mettre en œuvre des technologies toujours plus puissantes et sophistiquées. Pourtant, on constate que même des très petites surfaces, inférieures à un hectare en maraîchage, font des fermes parfaitement viables. Pour un écologue, un intérêt majeur de ces toutes petites fermes, c’est que chacune sur son territoire est une sorte de microcosme écologique, qui permet notamment d’étudier les bienfaits de la diversité comme source de résilience. Et, d’autre part, on observe autour des microfermes toute une série d’enjeux sociaux de la transition écologique, en particulier de reconstruction de liens sociaux non seulement autour des légumes « sains et bons », mais aussi autour de valeurs communes permettant de démarchandiser et mutualiser des ressources. Tout cela mis bout à bout, on se rend compte que ces microfermes sont des endroits vraiment intéressants pour penser les manières concrètes de faire advenir de nouvelles autonomies alimentaires et sociales.
Depuis votre perspective agroécologique, que pressentez-vous pour les dix prochaines années ?
J’imagine volontiers d’autres mondes. Par exemple, où nos systèmes alimentaires seraient reconstruits dans une logique de proximité, à base essentiellement de produits frais. Cela signifierait renoncer aux produits industrialisés, donc reconsidérer nos façons de cuisiner. Il faudrait alors repenser aussi nos modes de vie et de travail. Et comment éviter que les femmes soient à nouveau soumises à la tyrannie du domestique ? J’en arrive toujours à la conclusion qu’il n’est de changement que total, même si je ne sais pas penser le mouvement vers cette utopie réaliste. De plus, comment stabiliser les connaissances nécessaires, quand le vice du capitalisme de toujours privilégier l’efficacité immédiate bride la recherche scientifique et citoyenne sur de nombreuses solutions vertueuses à moyen ou long terme – notamment dans le biomimétisme, encore grandement inexploré.

Enfin, la difficulté du changement, c’est son coût. Pour passer d’un système peu rentable à un système plus rentable (sur les plans économique, social et écologique), il y a forcément une, deux, trois années ou plus d’apprentissages durant lesquelles l’efficacité chute. Le rôle des politiques publiques devrait être de couvrir ce risque-là. Or, aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’argent et d’énergie dépensés pour maintenir le statu quo en agriculture que pour aller vers l’innovation, et encore moins vers « l’innovation écologique radicale ». Dans ces conditions, pour quelle obscure raison le monde changerait-il ? Il change pourtant, mais ces changements sont portés par des individus et des collectifs en marge, négligés et parfois dénigrés. Il faut travailler avec ces marges et faire que leurs solutions deviennent assez incontestables pour offrir des horizons crédibles à la société tout entière.
L’agroécologie a-t-elle des leçons ou des conseils à donner à toutes ces transformations sociales ?
La démonstration apportée au Brésil, en Afrique, en Inde, que des conduites agroécologiques donnent de meilleurs résultats en termes de sécurité alimentaire, de qualité de la vie et de l’environnement, est un acquis important. Il y a partout, en France aussi, une prise de conscience de l’efficacité des systèmes agricoles écologisés. Mais ceux-ci imposent des arbitrages nouveaux entre des registres de performance multiples. Il ne s’agit plus de rechercher un optimum d’efficacité économique sous contraintes mais de dévoiler les conditions systémiques de la viabilité, c’est-à-dire du respect simultané et permanent de seuils minimaux pour une batterie de critères écologiques et sociaux. Cela implique un changement profond de façon de penser et de construire la vision de notre futur, dans les sciences, les politiques publiques. Et dans les têtes de chacun…
Propos recueillis par Marin Schaffner
[1] Marin Schaffner, ethnologue de formation et voyageur au long cours (Asie du sud-est, Afrique de l’Ouest et quatre coins de France), mène de nombreux projets de recherche, d’animation et d’écriture sur l’écologie, la pédagogie, les migrations et le handicap. Ce livre d’entretiens Un sol commun – Lutter, habiter, penser est son premier ouvrage.
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.