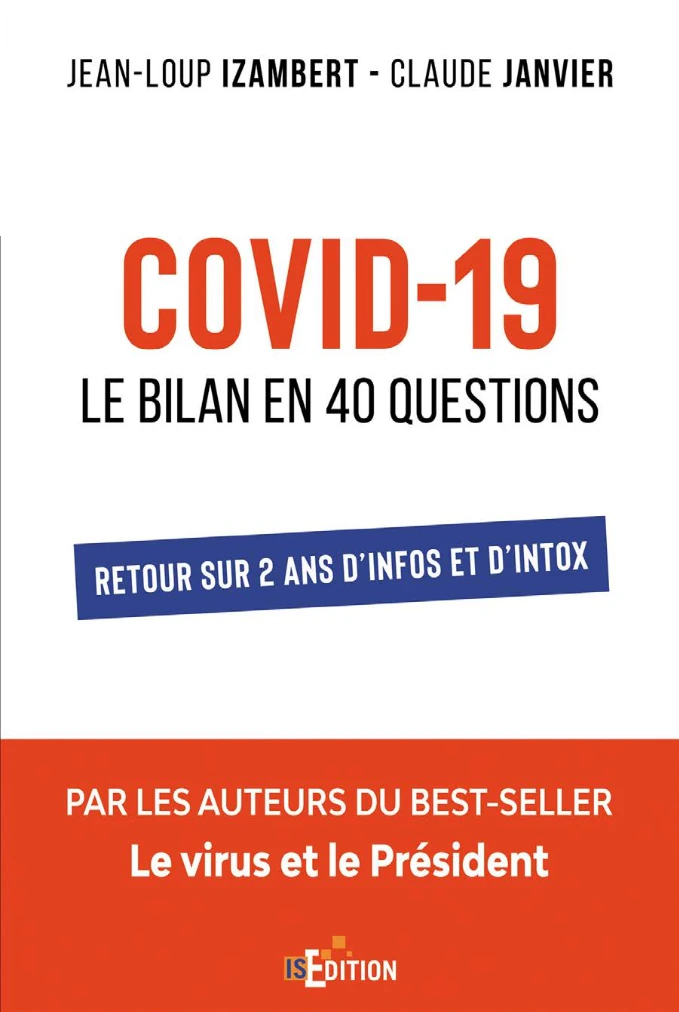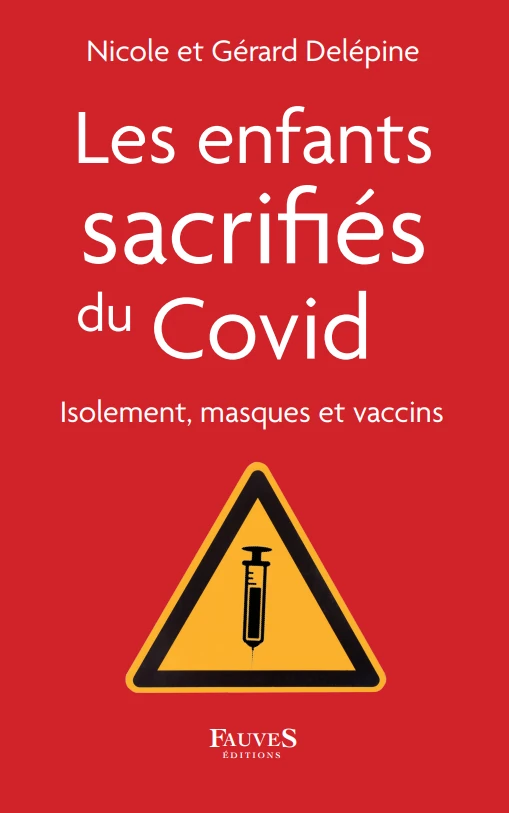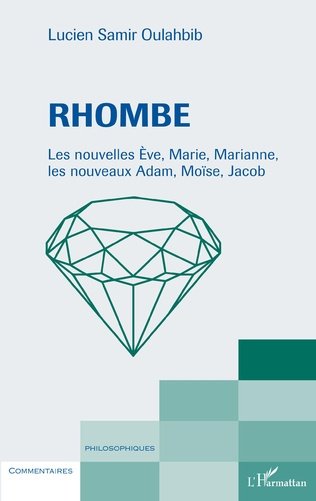06/09/2022 (2022-09-06)
Par Xavier Azalbert, en collaboration avec un groupe de Juristes, et en partenariat avec les associations Bonsens.org, AIMSIB et le collectif Santé Justice France

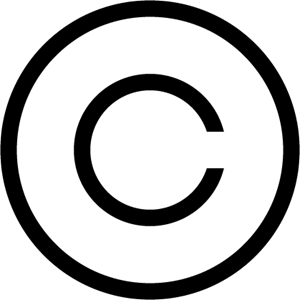 DR
DRENTRETIEN – Dans cet entretien, Me Virginie de Araujo-Recchia revient sur la genèse juridique de la liberté d’expression depuis sa proclamation dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789, puis analyse les ressorts de sa protection chez les médecins, chercheurs et enseignants-chercheurs dans un contexte de crise sanitaire. Dès lors que les médecins respectent le code de la déontologie médicale non seulement bénéficient-ils de cette liberté fondamentale, mais ils ont même un devoir d’expression, souligne l’avocate. Un droit et un devoir qui s’appliquent également aux enseignants et enseignants-chercheurs : « Il est de leur devoir de dire la vérité que la réalité des faits leur donne à voir ». Restreindre de manière illégale leur liberté d’expression porte ainsi atteinte à un droit fondamental, mais viole également celui de leurs concitoyens, puisqu’ils se retrouvent de facto privés d’une information ou d’un savoir crucial.
[Note de Joseph : dans la pratique, voit-on le gouvernement français tenir compte des textes évoqués ?]
FranceSoir : Qu’en est-il de la liberté d’expression en temps de « crise » sanitaire ? Médecins, enseignants, chercheurs peuvent-ils encore s’exprimer en toute liberté ?
VDAR : Anodine il y a encore deux ans et demi, la question posée en titre de cet article est devenue aiguë aujourd’hui. Ceci, du fait des attaques, et le mot n’est certainement pas trop fort eu égard à l’importance de la liberté d’expression dans une société démocratique, que subissent les médecins de ville comme les praticiens hospitaliers, les chercheurs ou les enseignants-chercheurs qui osent afficher une opinion dissidente de celle des « autorités sanitaires » au sujet de la gestion de la « crise » sanitaire.
Malheureusement, comme vous en avez déjà donné l’alerte dans vos pages, ces médecins, chercheurs ou enseignants-chercheurs font l’objet de poursuites de la part de leurs ordres professionnels ou de leurs établissements de rattachement, de censures diverses pour avoir exprimé leur avis informé. Pouvaient-ils le faire ? Devaient-ils le faire ? Voici quelques éléments de réponse.
Il est indispensable, au préalable, de poser le décor : la liberté d’expression, puisque c’est elle qui est en jeu, n’est pas une liberté publique parmi d’autres. Tout au contraire, elle est le socle même de la démocratie et du pluralisme qui la caractérise.
Expliquons-nous : la liberté d’expression prend ses racines juridiques dans un texte fondamental, s’il en est, de notre droit, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dont l’article 10 pose en principe que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Un principe qui revêt une valeur constitutionnelle, c’est-à-dire supérieure aux lois et aux règlements (décrets, arrêtés). Ce n’est pas un hasard !
Proclamée dans l’ensemble des États démocratiques, elle est également protégée à l’échelle internationale par différentes conventions internationales qui, ayant été ratifiées par la France, sont partie intégrante de notre droit, certaines ayant toutefois une force juridique plus grande pour nous. Tel est le cas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. Cette dernière prévoit ainsi, dans son article 10 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ».
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne réserve, elle aussi, une place particulière à la liberté d’expression, dans son article 10. On pourrait aussi citer la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 10 décembre 1948 et son article 19. Sans surprise, le Conseil d’État français voit dans « le caractère pluraliste des courants de pensée » une liberté fondamentale qui justifie le recours à une procédure d’urgence (référé-liberté) pour la mettre à l’abri des atteintes qui y seraient portées (CE, ordonnance du 4 avril 2019, n°429370). De façon plus vigoureuse, le Code pénal réprime, quant à lui, « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression » (article 431-1 du Code pénal).
À y regarder de plus près, après des évènements politiques majeurs et souvent dramatiques, la Révolution française ou la Seconde Guerre mondiale, les rescapés ont jugé nécessaire de rappeler à leurs concitoyens le caractère essentiel, au sens premier du terme, de la liberté d’expression. Pourquoi ? Parce que la liberté d’expression précède et permet l’exercice des autres libertés publiques et droits politiques. Elle est la « condition de la liberté de la pensée, elle exprime l’identité et l’autonomie intellectuelle des individus ».
Cette idée est exprimée de façon limpide par le préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 avec des mots tellement justes : « Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements ». Transposé à la question qui nous intéresse, « l’oubli ou le mépris » de la liberté d’expression ouvre la voie au piétinement de tous nos autres droits. La même idée est reprise par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dont la mission est d’appliquer, à l’égard des États signataires, la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans ce sens, « toute restriction, même anodine, apportée aux libertés d’opinion et d’expression peut (…) traduire un glissement vers l’autoritarisme, voire le totalitarisme ».
FS : Doit-on comprendre que la liberté d’expression est inconditionnée ?
VDAR : Il va de soi que, comme toute liberté, fût-elle fondamentale, la liberté d’expression doit être conciliée avec d’autres libertés et d’autres principes juridiques. Chacun connaît l’adage selon lequel, « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». En d’autres termes, le droit est une affaire de conciliation, de nuances et de mesures, mais toujours, et c’est certainement ce que l’on a oublié ces derniers temps, dans le respect de l’humain.
Il faut cependant tenir compte, dans cette perspective, de ce que l’on nomme la hiérarchie des normes, à savoir que certaines règles de droit priment sur d’autres et ont une valeur juridique supérieure à d’autres. Tel est le cas de la liberté d’expression qui, du fait de sa valeur constitutionnelle, prime sur la loi et sur les textes réglementaires. Il en résulte que les limitations de la liberté d’expression doivent résulter de la loi (article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958) ou d’un principe général que le juge aurait élevé au même rang que la loi. En outre, des limitations à cette liberté ne sont admissibles que si, pour reprendre les termes l’article 10 de la DDHC, elles « constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique », ce que la CEDH a qualifié, dans un arrêt du 7 septembre 1976, de « besoin social impérieux ».
Il ne peut donc s’agir que d’aménagements limités de la liberté d’expression, résultant de la loi et répondant à une exigence sociale supérieure. S’agissant de la liberté d’expression, il faut distinguer les limitations générales, des limitations propres à certaines situations. Tout d’abord, tout citoyen bénéficie, certes, de la liberté d’expression, celle-ci ne l’autorise toutefois pas à inciter son prochain à la haine, à l’injurier ou à le diffamer.
Ensuite, certaines professions posent des règles de bienséance entre confrères (avocats, médecins, notamment), de même que d’autres soumettent leurs membres à un devoir de réserve (magistrats, fonctionnaires de police, notamment). Ces dernières limitations ne doivent cependant pas être surinterprétées, la liberté d’expression ayant une valeur constitutionnelle, donc supérieure aux dispositions réglementaires ou d’ordre déontologique. Si le juge national et la CEDH admettent que sa portée soit restreinte, c’est avec force circonspection.
FS : Qu’en est-il des médecins ?
VDAR : Comme tous citoyens, les médecins bénéficient de la liberté d’expression. Si besoin était, cela a été récemment rappelé par la CEDH, dans un arrêt du 16 février 2021. Non seulement les règles encadrant l’exercice de leur profession ne sauraient en rien diminuer ou entamer cette liberté, même si le code de déontologie médicale précise qu’une honnêteté scientifique et une certaine bienséance entre confrères sont de mise, mais, à certains égards, les médecins ont, pourrait-on dire, un devoir d’expression.
Ce qu’il importe de comprendre est que les juridictions ordinales ne sont pas les juges de la liberté d’expression des médecins, seules le sont les juridictions judiciaires, administratives, pénales et certaines juridictions internationales (CEDH, en particulier). Leur intervention doit se limiter à s’assurer que les modalités d’exercice de cette liberté par leurs membres ne dépassent les limites déontologiques. Le Conseil d’État rappelait au sujet de l’ordre des experts-comptables, dès 1950, soit 10 ans à peine après la création des ordres professionnels par le régime de Vichy, de façon solennelle « qu’il n’a pas été dans les intentions du législateur (…) de priver les membres de l’ordre de la faculté d’émettre, verbalement ou de toute autre façon, et même par la voie de la presse, leur appréciation (…), sous réserve que leurs critiques ne présentent pas des faits allégués une version matériellement inexacte et qu’elles ne contreviennent pas à la bonne foi ou à la correction qu’il est dans la fonction même de l’ordre d’instituer et de maintenir dans les rapports entre ses ressortissants » (CE, arrêt du 29 juillet 1950).
Le code de déontologie médicale prévoit ainsi que le médecin doit s’abstenir de déconsidérer la profession (article R. 4127-31 du Code de la santé publique), qu’il doit entretenir des rapports de bonne confraternité avec ses confrères (article R. 4127-56 du Code de la santé publique) et qu’il doit s’appuyer sur des « données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public » (article R. 4127-13 du Code de la santé publique). Bien entendu, toute forme de publicité commerciale pour lui-même ou pour des produits de santé est prohibée (article R. 4127-13 du Code de la santé publique).
Les poursuites disciplinaires qui visent, en substance, la liberté d’expression d’un médecin se placent le plus souvent sur le terrain du manquement à la confraternité. Le Conseil d’État, qui est juge en dernière instance des poursuites disciplinaires médicales, pose toutefois des bornes assez étroites aux juridictions ordinales. Ainsi, un médecin peut critiquer, fût-ce en termes vifs, l’organisation du service hospitalier auquel il appartient (CE, 5 mai 2003, n°240010), préférer la pédiatrie à la médecine générale (CE, 4 mai 2016, n°373232) ou être hostile à tel traitement médical (CE, 4 janvier 1952, n°9329). Deux critères d’analyse peuvent en être dégagés : le Conseil d’État prend en considération le caractère personnel ou, au contraire, général de la critique, ainsi que son destinataire : le médecin s’adresse-t-il à son cercle professionnel ou au public en général ? On note cependant un récent durcissement du Conseil d’État qui a pu considérer, dans un arrêt du 24 juillet 2019, que la virulence d’une critique publique des vaccins contre les papillomavirus pouvait relever d’un manquement à l’obligation de prudence. Mais, on peut penser que cet arrêt, peu en phase avec la position plus libérale de la CEDH, ne fera pas jurisprudence.
FS : Qu’en est-il des enseignants-chercheurs et des chercheurs ?
VDAR : Les chercheurs et les enseignants-chercheurs peuvent, comme tout autre citoyen, se prévaloir de la liberté d’expression, cela va de soi. Cependant, cette dernière prend un relief particulier dans l’exercice de leur mission professionnelle. En effet, la liberté d’expression, qui est l’une des manifestations de la liberté de penser, est de l’essence même des métiers d’enseignant et de chercheur. Il faut en effet toujours garder à l’esprit que la liberté de la recherche, qui est l’une des déclinaisons de la liberté de penser, est précisément ce qui permet la formation de la pensée.
L’enseignement et la recherche sont, par conséquent, indissociables dans une société démocratique de la liberté d’expression et des autres libertés dont elle est porteuse. Il n’est, dès lors, pas surprenant que les libertés académiques bénéficient de la protection constitutionnelle, comme la liberté d’expression elle-même, ce qu’a posé le Conseil constitutionnel de façon spécialement solennelle : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions » (Cons. const., 20 janv. 1984, n°83-165 DC).
Ainsi, l’Université doit garantir aux enseignants-chercheurs les « conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle » (article L. 123-9 du Code de l’éducation), ces derniers bénéficiant « d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositifs » (article L. 952-2 du Code de l’éducation).
La CEDH souligne, dans le même ordre d’idées, « l’importance de la liberté académique, qui autorise notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l’institution ou le système au sein duquel ils travaillent ainsi qu’à diffuser sans restriction le savoir et la vérité » (CEDH, 3 avril 2012, n°41723/06). Par ces mots, la CEDH évoque ce qu’il est d’usage d’appeler le principe de tolérance et d’objectivité, qui relève de la coutume universitaire.
On pourrait relever que, les chercheurs et les enseignants-chercheurs étant des fonctionnaires ou, de plus en plus souvent, des contractuels de la fonction publique, ils sont tenus à un devoir de réserve. Cependant, à la différence des fonctionnaires de police ou des magistrats, celui-ci relève plus, dans leur cas, de la bienséance à l’égard de l’institution que d’une réelle obligation. Comme tout fonctionnaire, ils sont aussi soumis à une obligation de neutralité. Celle-ci s’efface toutefois largement devant le très large droit de critique qui leur est reconnu. En réalité, la menace vient certainement beaucoup plus d’un État toujours plus intrusif dans l’organisation, parfois même dans le contenu de l’enseignement et de la recherche, sans parler de la question brûlante des conflits d’intérêts avec le secteur privé.
En somme, et le contentieux est d’ailleurs assez rare en la matière, la liberté d’expression des chercheurs et des enseignants-chercheurs s’arrête lorsque leurs propos constituent une infraction pénale, telle que le négationnisme (CE, 28 septembre 1998, n°159236) ou qu’ils portent atteinte à la dignité des étudiants (pour des propos à caractère sexuel, CE, 21 juin 2019, n°424582)
FS : Les médecins, les enseignants-chercheurs et les chercheurs pouvaient-ils dès lors dire leur réserve, voire leur opposition aux mesures liées à la « crise » sanitaire ?
VDAR : Comme nous l’avons évoqué, non seulement les enseignants-chercheurs et les chercheurs le peuvent, mais il est de leur devoir de dire la vérité que la réalité des faits leur donne à voir. Inévitablement, cette quête emporte débats, voire polémiques. Mais n’est-ce pas ainsi que progresse le savoir ? La CEDH, l’ayant compris, affirme que la liberté académique emporte « la possibilité pour les universitaires d’exprimer librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence » (CEDH 27 mai 2014, n°364/04 et 39779/04).
Prenons la question autrement : si l’on restreint de manière illégale la liberté d’expression d’une personne, spécialement lorsque cette dernière détient un savoir ou une information qui pourrait être crucial pour ses concitoyens, on ne porte pas uniquement atteinte à ses droits : on viole par la même occasion le droit de ses concitoyens d’avoir accès à ce savoir ou à cette information.
Cette impérieuse nécessité de « faire savoir » se traduit par ce que les juristes qualifient de fait justificatif du débat d’intérêt général ou d’intérêt public qui étend encore la liberté d’expression à laquelle, dans ce cas, on ne peut plus opposer la diffamation ou la protection de la vie privée, par exemple. Ainsi, « des propos portant sur un sujet d’intérêt général, même diffamatoires au sens (de la loi sur la presse), ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard des objectifs (de l’article 10 de la DDHC) » (Cour de cassation, 29 mars 2011, n°10-85.887).
Au contraire, de par son importance même, une information de cette nature doit être portée à la connaissance du public, quitte à s’écarter du droit en vigueur. La CEDH l’a, de longue date, explicité de façon claire à propos de la liberté d’expression des médias, mais son raisonnement peut être généralisé à toute forme de liberté d’expression : il leur incombe « de communiquer des informations et des idées sur les questions (…) qui concernent (les) secteurs d’intérêt public » et qu’à « leur fonction consistant à (…) communiquer (de l’information) s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir » (CEDH, 26 avril 1979, n° 6538/74).
Ceci doit être rappelé à l’heure où l’on prétend museler médecins, chercheurs et enseignants-chercheurs que l’on classe publiquement parmi les « complotistes », et sur qui les autorités font pleuvoir sanctions disciplinaires et poursuites diverses.
En termes plus contemporains, on pourrait dire que les courageux qui s’obstinent à rechercher et à faire connaître la vérité sont des lanceurs d’alerte. On peut penser à Brook Jackson, qui a dénoncé les manquements de la société Ventavia, un sous-traitant de Pfizer dans les essais cliniques, où elle travaillait alors. Mais, on ne peut que déplorer le fait que, contrairement au système juridique nord-américain, le droit français ne fait pas grand cas des lanceurs d’alerte, à qui il n’accorde qu’une très faible protection. La récente réforme du statut de lanceur d’alerte par une loi du 21 mars 2022 n’a rien d’une révolution, même si on peut interpréter un arrêt du 30 juin 2016 de la Cour de cassation qui annule le licenciement d’un lanceur d’alerte de bonne foi comme le signe d’une évolution.
Néanmoins, il n’est pas totalement inutile de demander auprès du Défenseur des droits d’être « certifié » comme lanceur d’alerte, même si le droit français est assez restrictif et circonscrit à la relation de travail. Le lanceur d’alerte est, selon les textes, « une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ». Lorsque ces informations révèlent un « danger grave et imminent », elles peuvent être rendues publiques. Le point important est que, révélées dans ces conditions, celui qui divulgue ces informations bénéficie de l’irresponsabilité pénale (article 122-9 du Code pénal), de même que sont interdites les mesures de représailles (licenciement, suspension, intimidation, harcèlement, etc.). Une provision pour frais de justice pourra lui être accordée pour sa défense.
En conclusion, il faut tout de même remarquer le « deux poids, deux mesures ». Ainsi, pour prendre l’exemple des médecins, l’Ordre des médecins se refuse à engager des poursuites contre les médecins qui se répandent dans les médias au sujet d’une thérapie expérimentale toujours en phase d’essai, alors même que le Code de la santé publique leur impose de ne pas communiquer sur un « procédé nouveau (de) traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent » (article R. 4127-14 du Code de la santé publique), violant ainsi allègrement le Code de la santé publique, mais n’hésite pas un instant à le faire contre ceux qui nous alertent des risques pour notre santé et celle de nos enfants…
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.