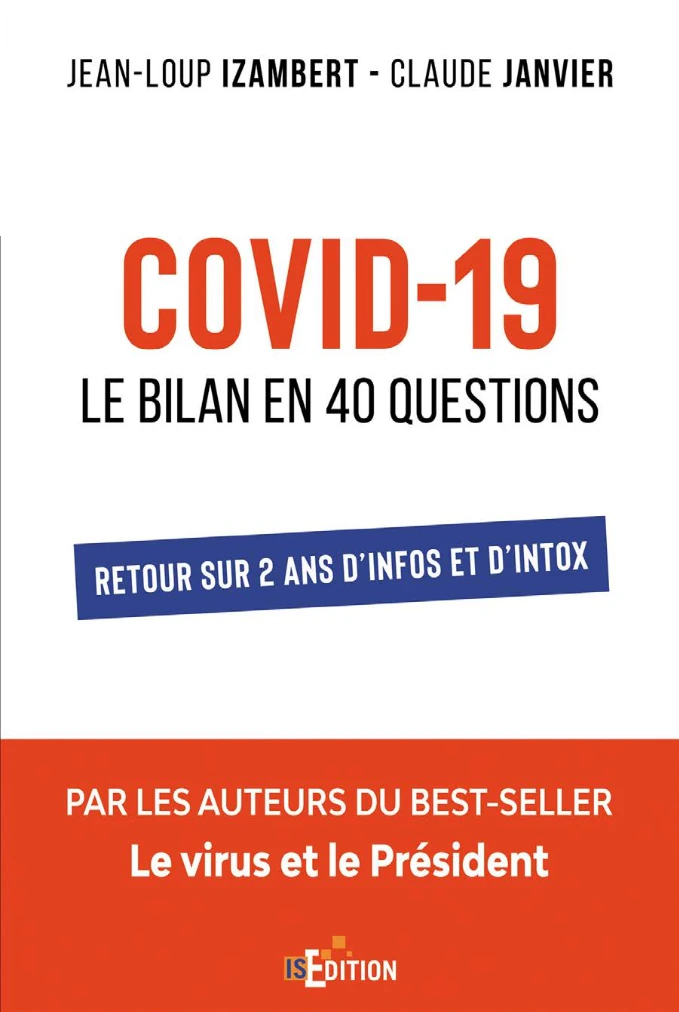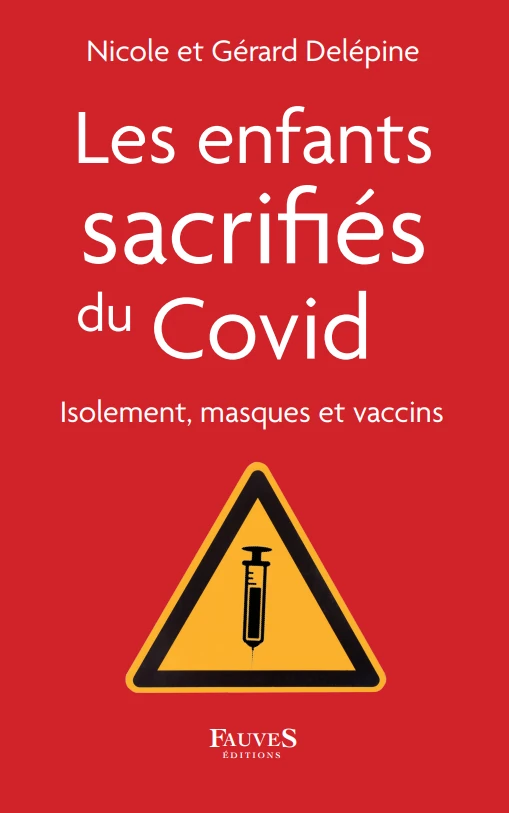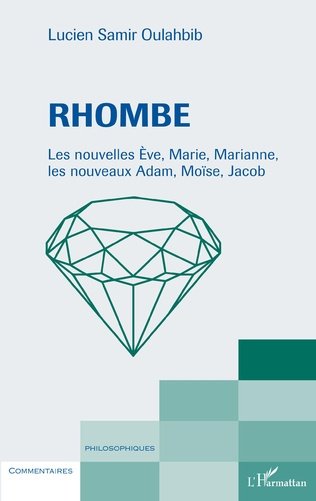14/05/2024 (2024-05-14)
Par Jacques Robert professeur émérite de cancérologie
Commentaires sur l’Avis du Défenseur des droits en date du 6 mai 2024
Nous avons pris connaissance de l’avis n° 24-05 du Défenseur des droits portant sur la proposition de loi n° 435 (2023-2024) visant à « encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre, déposée au Sénat le 19 mars 2024 ».
Nous voudrions y signaler un certain nombre d’erreurs. Nous voulons croire que ces erreurs sont imputables à l’insuffisance de la documentation dont a pu disposer Mme Hédon pour rédiger cet Avis et par conséquent à son ignorance plus qu’à sa mauvaise foi. Il paraît surprenant que la Cass Review[1] n’y soit même pas mentionnée. Elle a pourtant été rendue publique un mois avant la publication de l’Avis du Défenseur des droits, le 10 avril 2024, après quatre ans de travail de recueil et d’analyse d’articles originaux, de méta-analyses et d’opinions d’experts. Elle totalise 388 pages et rassemble une centaine de références bibliographiques. Il apparaît en outre que l’Avis du Défenseur des droits utilise une terminologie qui n’est pas en accord avec la terminologie habituelle de la médecine, ce qui fait craindre qu’il n’ait pas été approuvé par une équipe médicale indépendante. Voici ce que l’on peut relever :
Dans l’introduction, Mme Hédon mentionne à juste titre que :
« L’intérêt supérieur de l’enfant est à la fois un objectif, une ligne de conduite, une notion guide, un principe procédural qui doit éclairer, habiter et irriguer toutes les normes, procédures et décisions concernant des enfants ».
Nous partageons pleinement ce point de vue, et la Cass Review le partage également ; on peut ajouter que le Dr Hilary Cass, ancienne présidente du Royal College of Paediatrics and Child Health, a mis en application son empathie pour les enfants et les adolescents en les soignant pendant toute sa longue carrière.
Dans son Avis, Mme Hédon affirme que le projet de loi déposé au Sénat par Mme Jacqueline Eustache-Brinio « entretient un flou qui nuit à la compréhension de l’objet de la proposition de loi ». Cela est inexact, car ces termes sont clairs, consensuels et d’usage courant dans le milieu de la médecine, en particulier celui de la pédopsychiatrie. Mme Hédon regrette « de ne pas avoir été auditionnée dans le cadre de cette mission concernant les mineurs, alors qu’elle représente l’institution en charge de la défense et de la promotion des droits de l’enfant » ; Mme Hédon aurait parfaitement pu être auditionnée si le rapport du Sénat avait été centré sur les droits de l’enfant, ce qui n’est pas le cas. Il n’empêche que des juristes d’avis opposés ont bien été auditionnés et ont donné leur avis sur des sujets qui sont aussi de la compétence de Mme Hédon.
Mme Hédon considère ensuite qu’il faut développer « une approche s’appuyant sur une conception non pathologique de la transidentité ». Certes, la dysphorie de genre a été retirée de la liste des pathologies mentales dans le DSM5, mais la dysphorie de genre ne correspond-elle pas à un trouble du fait de la demande d’interventions médicamenteuses et/ou chirurgicales devant être prises en charge par l’Assurance maladie ? Elle entre bien dans le champ de la médecine qui vise à traiter une maladie ou un trouble selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il y a un paradoxe à considérer que la dysphorie de genre n’est pas une pathologie, mais que ceux qui se déclarent dysphoriques ou souhaitent effectuer une transition de genre nécessiteraient des soins médicaux à vie, habituellement destinés aux maladies de longue durée.
Un très faible taux de mineurs transgenres sont concernés par les transitions médicales
Il est exact, comme le précise Mme Hédon, qu’un très faible taux de mineurs sont concernés par les transitions médicales. Il n’y a pas à ce jour de statistiques nationales, mais le nombre de services dédiés augmente dans toute la France. Est-ce une raison pour ne pas s’en préoccuper alors que tous les pays qui nous entourent signalent une augmentation croissante des demandes de changement de sexe ?
Très vite, Mme Hédon fait une confusion entre l’intersexuation (les enfants que l’on disait « intersexes » ou « intersexués » sont nommés aujourd’hui « sujets avec une variation du développement génital » ou VDG[2]) et la transidentité. Les premiers sont rarissimes et n’ont strictement rien à voir avec la situation des nouveau-nés déclarés filles ou garçons et qui, à un moment de leur développement, se déclarent « trans » et souhaitent changer de sexe. Le terme « assigné à la naissance » est imposé par les militants et n’a aucune réalité. La biologie nous dit qu’il n’existe aucune possibilité de changer de sexe ultérieurement, bien que l’on puisse changer d’apparence. Bien distinct des enfants nés avec une variation du développement génital sont les personnes qui, dès l’enfance ou plus tard, ont le sentiment d’appartenir à un sexe qui n’est pas le leur. Cette situation porte le nom de dysphorie de genre ou, mieux, d’angoisse de sexuation pubertaire, et elle doit être prise en charge avec la plus grande empathie, par des médecins et des psychologues qualifiés ayant l’expérience du développement physique et psychique des enfants lors du passage à l’adolescence.
Mme Hédon donne ensuite des indications sur le nombre des interventions médicales et chirurgicales réalisées au cours des années passées dans le cadre des consultations d’un service spécialisé ouvert à l’APHP, dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il n’y a pas lieu de contester ces chiffres, mais on peut remarquer que l’auteur de l’Avis glisse le terme de « torsoplastie », qui est un euphémisme pour « mammectomie bilatérale », seul terme médical consensuel pour désigner l’ablation des seins. Signalons par ailleurs que cet hôpital n’est pas le seul en France, et de loin, à prendre en charge les adolescents connaissant une telle angoisse de sexuation pubertaire.
Les transitions médicales constituent un enjeu pour la santé des mineurs transgenres
L’Avis du Défenseur des droits indique ensuite avec pertinence que :
« Les enfants et adolescents transgenres ont un risque plus élevé de troubles psychiatriques tels que les troubles anxieux et les troubles de l’humeur ».
C’est effectivement la constatation unanime des pédopsychiatres qui prennent en charge ces enfants et adolescents, mais il y a une euphémisation desdits « troubles psychiatriques » : ne sont pas mentionnés dans l’Avis les troubles plus graves, comme ceux relevant du spectre de l’autisme et ceux conduisant à des problèmes d’alimentation (boulimie, anorexie) correspondant également à un risque suicidaire élevé et préexistant à la dysphorie de genre. Par ailleurs, on note qu’une proportion relativement importante de ces adolescents ont subi des abus sexuels, et que d’autres découvrent leur homosexualité, ce qui est associé également à l’augmentation du risque suicidaire.
Pour appuyer ses dires, Mme Hédon cite des études ayant montré que le taux de suicide des adolescents transgenres était élevé « dans de nombreux pays ». Or les trois références qu’elle fournit concernent deux pays, les États-Unis et l’Inde, et l’article concernant la situation en Inde a été publié dans un journal, l’Indian Journal of Psychology and Medicine, qui ne figure pas dans la « liste des revues scientifiques recommandables » établie par le collège des doyens des facultés de médecine et celui des présidents des sections médicales du Conseil national des universités : cette revue doit a priori être considérée comme non fiable et on ne peut en tenir compte. En revanche, Mme Hédon ne cite pas d’autres articles plus récents répertoriés dans une série de méta-analyses spécialisées parues dans les Archives of Diseases in Childhood, une revue qui figure dans la liste des revues recommandables mentionnée ci-dessus. Nous voulons croire que cette restriction à une toute petite partie de la littérature relève de l’ignorance quant à la méthodologie de la documentation scientifique. Pour n’en citer qu’une, la conclusion d’une étude récente[3] saluée pour sa haute qualité par de nombreux professionnels dans plusieurs pays, mais que ne cite pas Mme Hédon, est que « la transition médicale n’a pas d’impact sur le risque suicidaire » et que le seul facteur prédictif de mortalité est la morbidité psychiatrique associée.
En ce qui concerne le nombre de personnes qui regrettent ultérieurement les interventions hormonales et/ou chirurgicales et souhaitent « détransitionner », le Défenseur des droits avance le chiffre de 1 %, habituellement brandi par des médecins du genre et les militants, mais qui ne se fonde que sur des études peu fiables. Nombre d’études montrent que ces retours à l’identité sexuée d’origine sont en augmentation : 7 à 10 % de détransitions sont observées dans l’étude du GIC[4], et ce chiffre est même sous-estimé d’après les auteurs : leur nombre devrait encore augmenter dans les prochaines années car, selon cette étude, il faut au moins 8 ans après le traitement pour évaluer le nombre de détransitions, alors qu’ils n’avaient que 16 mois de recul. Des chiffres de 20 %[5] à 30 %[6] d’arrêt de traitement sont observés par ailleurs ; si ces comportements ne sont pas à proprement parler des détransitions, ils en sont souvent les prémices. Un article de moins d’un an souligne que le taux de détransition est inconnu[7], mais tout converge pour penser qu’une augmentation importante des détransitions sera observée dans les prochaines années : le début de l’augmentation des demandes de transition date des années 2013 tandis que l’âge moyen des détransitionneuses est un peu inférieur à 25 ans.
Mme Hédon écrit ensuite que « les équipes de santé françaises qui accompagnent des jeunes trans constatent que la suppression de la puberté permet “aux adolescents, et à leurs parents, de prendre le temps psychique d’élaborer leur propre projet d’affirmation” et “rend possible l’expérimentation d’une transition sociale à l’école, auprès du groupe de pairs et dans la famille en limitant l’apparition de caractéristiques sexuelles secondaires, en réduisant l’isolement et le rejet social et scolaire, et en minorant les conséquences sur la santé” ». Ces considérations relèvent de l’opinion (des « constatations ») et non de données chiffrées s’appuyant sur une recherche validée. Les « opinions d’expert » sont tout en bas de l’échelle des preuves de l’evidence-based medicine. Ils ne peuvent être pris en compte dans la décision médicale que lorsque n’existent pas d’études de bonne qualité méthodologique, ce qui n’est pas le cas. Les autres affirmations présentes dans cette partie du rapport reposent sur très peu de publications scientifiques (l’une d’elles s’appuie même sur une communication à un congrès, et n’a donc pas été validée par peer review). Si l’on compare le nombre d’études citées par Mme Hédon au nombre de celles citées dans la partie « annexes » du rapport sénatorial et dans la Cass Review, on ne peut qu’être stupéfait de l’ignorance que reflète l’Avis du Défenseur des droits quant aux méthodes de l’analyse scientifique.
Les bloqueurs de puberté, nous dit ensuite le Défenseur des droits, « sont depuis longtemps utilisés chez les enfants présentant une puberté précoce et la littérature scientifique atteste depuis près de 40 ans du caractère réversible de leur action avec une reprise physiologique de la puberté à leur arrêt ». Il s’agit en fait deux situations différentes : les « bloqueurs de puberté » sont utilisés dans les cas de puberté précoce d’enfants de moins de 8 à 9 ans, alors que la demande majoritaire à l’heure actuelle concerne des enfants plus âgés chez lesquels la puberté est déjà bien entamée. Dans la puberté précoce, les jeunes sécrètent trop tôt les hormones qui vont déclencher leur puberté et altérer le rythme de leur croissance. Cette situation est pathologique et doit être traitée. Les jeunes « dysphoriques » sont en pleine santé physique. Les deux situations ne peuvent être comparées. Affirmer sans preuve leur caractère réversible et leur innocuité dans une situation bien distincte de celle ayant été utilisée (sans avoir été validée par une étude comparative) relève du parti pris ; il faut avouer que nous n’en savons rien. Par ailleurs, le retard apporté à la puberté supprime la fenêtre temporelle durant laquelle la maturation cérébrale s’effectue grâce à l’action des hormones sexuelles, entraînant un retard au développement psychosexuel des adolescents : il faut savoir que les hormones sexuelles ont également des récepteurs dans le cerveau, et pas seulement dans les tissus périphériques.
Quant aux hormones stéroïdes et à leurs dérivés, féminisantes ou masculinisantes, Mme Hédon les appelle aussi « thérapie hormonale substitutive — THS ». Substitutives de quoi ? Ce terme est évidemment erroné. Elle affirme ensuite que certaines personnes (Agnès Condat et David Cohen) « soulignent que le traitement d’affirmation de genre par les hormones sexuelles n’a que peu d’effets secondaires. En dehors du risque thromboembolique, qui n’est pas spécifique aux personnes transgenres, tous les autres risques sont très rares ». Cette phrase n’a pas de sens : le risque thromboembolique « n’est pas spécifique aux personnes transgenres », mais en dehors du traitement actuel de la dysphorie de genre, à qui prescrit-on des hormones sexuelles à l’adolescence ? Et les « autres risques sont très rares ». Certes, mais ces auteurs ont-ils conscience du risque de tumeurs hépatiques, y compris d’hépatocarcinomes, que font courir les androgènes ? Il existe sur ce sujet une abondante littérature (qui, nous en convenons, ne concerne pas encore les adolescents transgenres) que ces auteurs ont superbement ignorée, faisant bénéficier Mme Hédon de leur ignorance du risque de cancer, que l’on ne pourra connaître dans cette tranche d’âge que dans dix à quinze ans, le temps nécessaire pour que l’initiation d’un processus oncogénique parvienne à la constitution d’un cancer.
Il existe un risque d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à la santé et à sa vie privée
Mme Hédon prend délibérément le parti de faire d’un problème de santé publique concernant les mineurs, une question de droit. On ne peut pas ne pas noter que c’est l’argumentation des associations militantes.
Mme Hédon évoque dans son Avis la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui souligne « l’absolue nécessité de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination, lui garantit l’accès à tous soins nécessaires à son bien-être, le droit d’exprimer son opinion dans toute situation le concernant et le droit à la vie privée, ainsi que le droit d’être protégé contre les atteintes à sa vie privée ». Nous en sommes tous d’accord : l’enfant a le droit fondamental d’exprimer son opinion dans toute situation le concernant. Encore faut-il que l’enfant et l’adolescent soient informés correctement et puissent donner une opinion éclairée, comme toute personne doit donner un consentement éclairé à une situation la concernant.
Le problème est dans le savoir dont doivent bénéficier les enfants avant de pouvoir justifier leur « opinion ». L’expérience montre que l’information donnée par les médecins est souvent insuffisante en ce qui concerne les risques : combien d’entre eux parlent de l’absence, non seulement d’orgasme, mais encore de désir sexuel lorsqu’ils ont subi une castration chimique (terme médical euphémisé en « blocage de puberté »), du risque de stérilité induit par les hormones stéroïdes en général, du risque de survenue d’hépatocarcinome induit par les androgènes, etc. ? L’adolescent et même l’enfant est certes capable de prendre en compte les risques immédiats d’un changement de sexe, pas des risques à long terme, car il ne se projette pas dans l’avenir comme un adulte et surtout n’a encore aucune expérience sexuelle. Là encore, l’ignorance de Mme Hédon quant à la structuration du psychisme de l’adolescent est manifeste. Par ailleurs, sur le plan du droit, le problème du consentement doit entrer en résonance avec la loi du 21 avril 2021 « visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ». Le consentement d’un mineur de moins de 15 ans à un acte sexuel avec un majeur ne peut plus être allégué, mais son consentement à ces traitements exonérerait les professionnels prescripteurs de leur responsabilité à son égard ?
Par ailleurs, l’ignorance des simples faits biologiques des adolescents est consternante ; la jeune fille de 17 ans filmée par Claire Simon dans son documentaire intitulé Notre Corps (2023) le démontre amplement : alors que le médecin lui propose de conserver ses ovocytes au cas où elle souhaiterait porter ou faire porter un enfant à sa compagne, elle s’imagine qu’en réalisant une « transition de genre », elle pourra féconder sa compagne avec « son » spermatozoïde ! Cette ignorance résulte sans doute d’une part d’une flagrante inattention lors des cours de biologie qu’elle a reçus au lycée, et d’autre part de l’addiction à une source majeure « d’information » des adolescents : les réseaux sociaux comme Tik-Tok.
Il est bien évident que l’insistance de Mme Hédon sur la nécessaire prise en charge par l’Assurance maladie des troubles psychiatriques des adolescents (qu’elle ne nie pas) est justifiée : tout le monde est d’accord là-dessus. N’est-ce pas déjà le cas puisque les établissements publics de santé pour adolescents sont gratuits pour leurs usagers, notamment les CMP ? Mais que le parcours de soins soit « choisi » par la personne transgenre est contestable : il doit être proposé par l’équipe médicale en accord avec les responsables légaux des mineurs d’une part, et dans l’intérêt supérieur de ces derniers d’autre part, mineurs qui ne peuvent le déterminer que s’ils bénéficient d’une information complète et objective des risques encourus, et surtout de leur compréhension parfaite pour ce qui est des risques à long terme.
La Haute autorité de santé (HAS), mentionnée à plusieurs reprises dans l’Avis du Défenseur des droits, a jugé bon de ne pas divulguer la composition des membres du groupe de travail sur le sujet des personnes trans à partir de 16 ans en faisant état de pressions qui pourraient être exercées sur ses membres. La sénatrice Eustache-Brinio a demandé à la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) si la HAS devait communiquer ces noms et la CADA a approuvé cette demande.
Il existe un risque discriminatoire
L’Avis officiel du Défenseur des droits évoque ensuite la « discrimination » dont seraient victimes les adolescents souhaitant changer de sexe par rapport à ceux qui ne le souhaitent pas, en ce qui concerne l’accès aux bloqueurs de puberté ; là encore, on peut légitimement s’interroger sur les sources de Mme Hédon. Passons sur le fait qu’elle dénomme les jeunes respectivement de « transgenres » et « cisgenres » alors qu’à l’âge de 12 ou 13 ans rien ne permet de les catégoriser ainsi de façon essentialiste. Mais surtout, lesdits bloqueurs de puberté ont obtenu une autorisation de mise sur le marché pour traiter une puberté précoce, survenant avant l’âge de 8 ans pour les filles et de 9 ans pour les garçons, et non pour remédier au désir de changer de sexe vers 12 ou 13 ans : il n’y a pas d’AMM dans cette indication. De même, la prescription d’une chirurgie plastique pour hypertrophie mammaire chez les jeunes filles ou gynécomastie chez les garçons doit être distinguée d’une mastectomie bilatérale ne reposant pas sur les mêmes indications.
En suivant ce raisonnement juridique, on aboutirait à une absurdité : ces « bloqueurs de puberté », comme la triptoréline appartenant à la famille des agonistes de la gonadolibérine, sont aussi utilisés dans le traitement des cancers de la prostate : si on ne les prescrit qu’aux hommes atteints d’un cancer de la prostate et pas aux adolescents en souffrance psychologique, on ferait une discrimination, cette fois en fonction de l’âge ? Bien des médicaments sont utilisés dans une indication précise, pour une pathologie donnée, et pas dans une autre parce que leur activité n’y a pas été prouvée ou que les risques d’intolérance ne le justifient pas, eu égard au risque encouru du fait de la pathologie. Il n’y a là aucune discrimination. C’est seulement une personnalisation de la médecine qui est mise en œuvre dans ce cas comme dans bien d’autres — en cancérologie par exemple, où certains médicaments des cancers du sein sont prescrits après la ménopause et ne sont pas indiqués avant celle-ci. Nous voulons croire que les craintes du Défenseur des droits quant aux risques de discrimination en fonction de l’âge des jeunes patients ne résultent que de l’ignorance de ce qu’est la médecine personnalisée au xxie siècle.
On voit à quelles absurdités peut aboutir cette confusion : la médecine n’est pas le droit ! Il n’y a pas de discrimination ni d’inégalité de traitement à propos des bloqueurs de puberté ou des hormones croisées. La question est de savoir si ces jeunes en souffrance ont accès à des soins dont l’utilisation repose sur des preuves. Dans l’état actuel des études de haut niveau, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas un autre domaine médical où l’on accepterait que des mineurs reçoivent des traitements n’ayant pas fait la preuve de leur innocuité et de leurs bénéfices.
Mme Hédon a tenu à rappeler dans son rapport que « toute thérapie ayant pour finalité la répression de l’identité de genre du patient pourrait être caractérisée de “thérapie de conversion” et donc pénalement répréhensible au regard de la loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne ». Mais de quoi parle-t-elle ? Il n’a jamais été question, en limitant les interventions médicales aux approches psychologiques et psychiatriques chez les adolescents transgenres, de chercher à modifier leur « identité de genre » ! Cette identité, à l’âge de l’adolescence, est fluctuante et il n’est question que de les aider à ne pas aller trop précocement vers des thérapies agressives dont l’innocuité n’est pas garantie, donc à laisser ouvertes toutes les options possibles. Ce sont précisément les traitements, hormonaux et/ou chirurgicaux, qui représentent les véritables « thérapies de conversion » dont certains effets sont irréversibles.
Enfin, nous voudrions rappeler au moins deux scandales sanitaires dont Mme Hédon ne semble pas avoir gardé le souvenir. Il s’agit : (1) du scandale du sang contaminé ; les hémophiles étaient demandeurs de transfusions à tout prix, et certains transfuseurs qui refusaient d’utiliser du sang non chauffé ont été conspués par des associations de patients qui ne parvenaient pas à comprendre le risque d’infection virale qu’ils croyaient minime ; (2) du scandale des extraits hypophysaires ; dans ce cas, les parents demandeurs d’hormone de croissance ont fait pression sur les médecins qui se sont laissé fléchir et ont prescrit, bien à tort, des extraits hypophysaires à des enfants qui ont contracté la maladie de Creutzfeld-Jacob. Dans les deux cas, l’innocuité des traitements n’avait pas été démontrée et les conséquences en ont été dramatiques. Nous souhaitons ardemment que l’on ne s’engage dans l’administration de traitements dont l’innocuité à long terme n’est pas évaluée que dans le cadre de programmes de recherche à long terme, conduits par des médecins et des méthodologistes aux compétences reconnues.
Appendice
Nous voudrions ajouter à notre réponse au Défenseur des droits qu’un certain nombre d’associations médicales et de sociétés savantes européennes ont émis des recommandations :
Europe[8] : l’ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) a publié le 27 avril un article sur le « besoin urgent de sauvegarder les normes cliniques, scientifiques et éthiques pour la prise en charge des enfants et adolescents atteints de dysphorie de genre » ;
Royaume-Uni[9] : Le NHS (National Health Service, Royaume-Uni) a publié des Conseils de mise en œuvre de la Cass Review ;
Finlande[10] : Le Conseil pour les choix en soins de santé de l’Autorité finlandaise de santé (PALKO/COHERE) a publié des recommandations pour la prise en charge des adolescents atteints de dysphorie de genre, qui vont dans le sens de la plus grande prudence ;
Suède[11] : Le Conseil national de la santé et de la protection sociale a également souhaité la plus grande prudence, en soulignant que « Une bonne prise en charge psychosociale est fondamentale, et que les données scientifiques sont insuffisantes pour évaluer les effets des traitements hormonaux inhibiteurs de la puberté et antisexe chez les enfants et les jeunes » ;
Danemark[12] : le Journal de l’Association médicale danoise rapporte que ce pays « a mis en place une approche plus prudente en matière d’hormonothérapie jusqu’à ce que davantage de preuves soient disponibles sur ses effets bénéfiques. En particulier, on manque de connaissances sur la proportion croissante de jeunes souffrant de dysphorie de genre après la puberté et sur la proportion vraisemblablement croissante de troubles mentaux, car de nouvelles études indiquent que les effets positifs ne se retrouvent pas dans ce groupe ».
Allemagne[13] : Le 128e Congrès médical allemand a émis le 10 mai 2024 deux résolutions visant à limiter à des essais cliniques contrôlés les bloqueurs de puberté, les hormones de sexe opposé et les interventions chirurgicales pour les jeunes dysphoriques de moins de 18 ans ; et d’autre part, a demandé de limiter la Loi sur l’autodétermination aux personnes de plus de 18 ans. Tout porte à croire que la médicalisation de ces enfants relève d’une expérimentation sur les enfants. En ce sens, elle représente un scandale médical, éthique et scientifique.
Ce document a été rédigé par Jacques Robert, professeur émérite de cancérologie, université de Bordeaux
Il a été signé par :
- 1. Fabienne Ankaoua, psychanalyste
- 2. Nicole Athéa, gynécologue endocrinologue
- 3. Sophie Audugé, spécialiste des politiques et des systèmes d’éducatifs
- 4. Patrick Belamich, psychiatre, psychanalyste
- 5. Martine Benoit, professeur à l’université de Lille
- 6. Albert Bensman, professeur honoraire de pédiatrie à la faculté de médecine Paris-Sorbonne, Ancien chef du service de néphrologie pédiatrique à l’hôpital Trousseau, Paris
- 7. Maurice Berger, pédopsychiatre, ex-Professeur associé de psychopathologie de l’enfant
- 8. Anne-Laure Boch, neurochirurgien, praticien hospitalier
- 9. Jean-Philippe Boulenger, professeur émérite de psychiatrie d’adultes à la faculté de médecine de Montpellier. Ancien directeur de recherche à l’INSERM
- 10. Michel Bruno, psychologue-psychanalyste
- 11. Dominique Crestinu, gynécologue
- 12. Sophie Dechêne, pédopsychiatre
- 13. Thierry Delcourt, pédopsychiatre
- 14. Paul Denis, neuropsychiatre, pédopsychiatre, Membre de la Société psychanalytique de Paris
- 15. Albert Doja, professeur d’anthropologie, Université de Lille
- 16. Nicole Einaudi, pédopsychiatre
- 17. Caroline Eliacheff, pédopsychiatre, psychanalyste.
- 18. Gilles Falavigna, sémiologue et essayiste
- 19. Bernard Ferry, psychanalyste
- 20. Christian Flavigny, pédopsychiatre
- 21. Jean Giot, professeur émérite des Universités
- 22. Eva-Marie Golder, docteur en psychologie, psychologue psychanalyste
- 23. Christian Godin, philosophe
- 24. Pamela Grignon, psychologue TCC
- 25. Claude Habib, professeur émérite de littérature à l’Université Sorbonne Nouvelle
- 26. Nathalie Heinich, sociologue, directrice de recherche honoraire CNRS
- 27. Catherine Jongen, sexothérapeute
- 28. Beryl Koener, pédopsychiatre
- 29. Gilles Lacan, juriste
- 30. Jean-Daniel Lalau, professeur des universités, praticien hospitalier, nutrition-endocrinologie, CHU d’Amiens
- 31. Louise L. Lambrichs, essayiste, romancière, poète, critique, Officier des Arts et Lettres
- 32. Laurent Lantieri, professeur de chirurgie, chef de service de chirurgie plastique et reconstructive, hôpital européen Georges-Pompidou
- 33. Marie-Laure Leandri, psychologue
- 34. Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste
- 35. Jean-Paul Leclercq, psychologue clinicien
- 36. Manuel Maidenberg, pédiatre
- 37. Nathanaël Majster, ancien magistrat, avocat à la cour
- 38. Céline Masson, professeur des universités en psycho-pathologie de l’enfant
- 39. Patrick Miller, psychiatre, psychanalyste, membre fondateur de l’Association Psychanalytique Internationale.
- 40. Israël Nisand,
- 41. Laetitia Petit, MCF-HDR en psychologie clinique
- 42. Magali Pignard, co-fondatrice deux associations de personnes autistes
- 43. Brigitte Poitrenaud Lamesi, MCF-HDR émérite en études italiennes, Université de Caen Normandie
- 44. François Rastier, directeur de recherches CNRS honoraire, linguiste
- 45. Claudio Rubiliani, biologiste
- 46. Anne Santagostini, psychiatre
- 47. Olivia Sarton, juriste
- 48. Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne à l’Université Paris Cité
- 49. Claire Squires, psychiatre, Maître de conférences honoraire de l’Université Paris Cité
- 50. Luc Vandecasteele, médecin généraliste à Gand (BE)
- 51. Pierre Vermeren, historien, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- 52. Nicole Yvert, psychanalyste
- 53. Jean-Pierre Winter, psychanalyste
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.