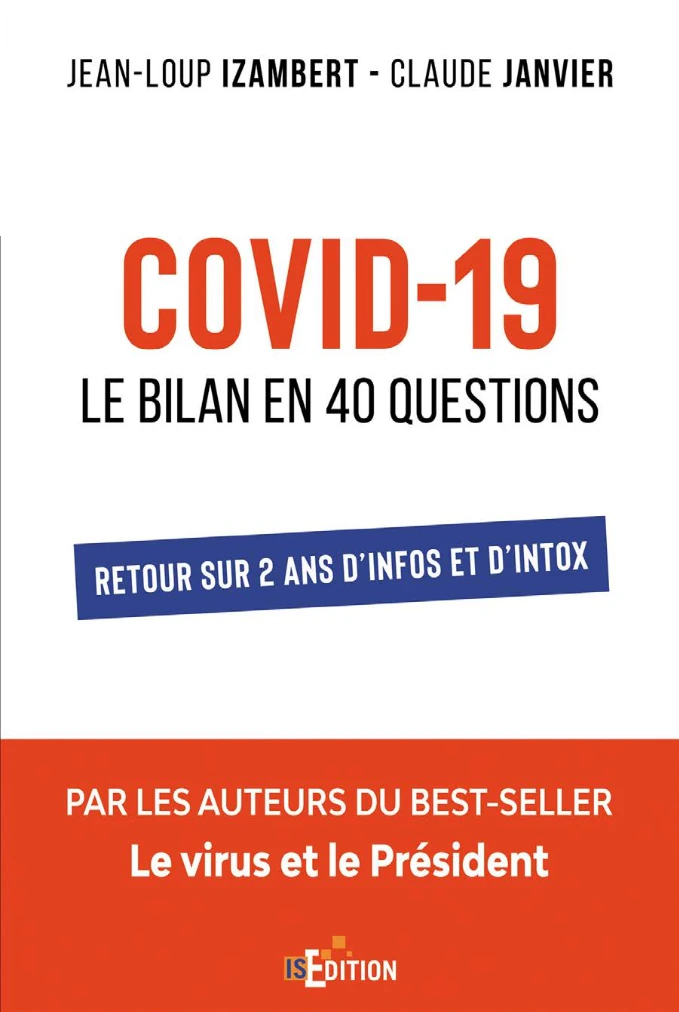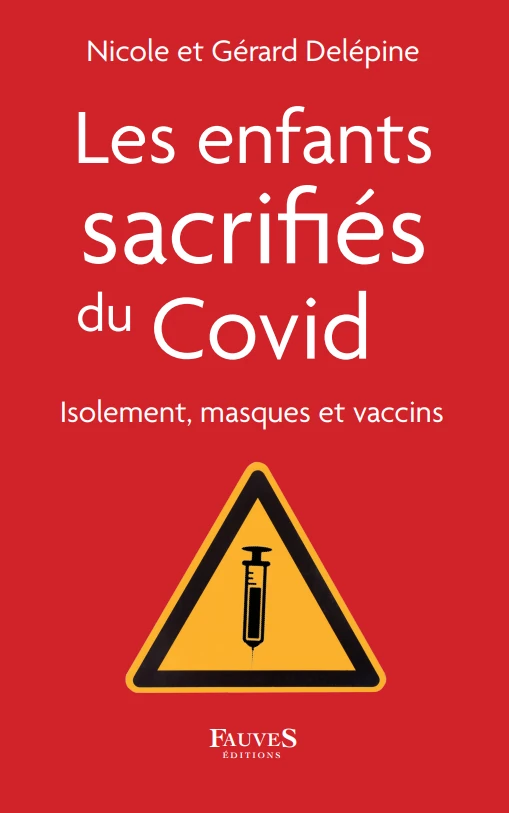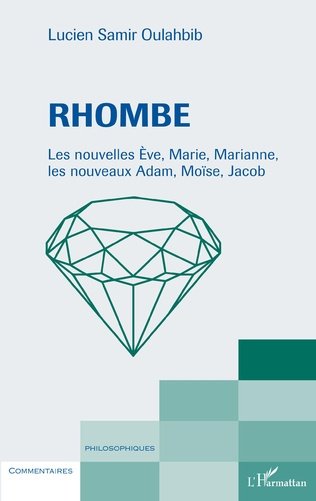03/11/2023 (2023-11-03)
Par Nicolas Bonnal
Watzlawick avait écrit un passionnant guide anticonformiste de l’usage de l’Amérique. Il a été publié en allemand, mais pas en anglais, et on comprend vite pourquoi tant ce grand lecteur de Gheorghiu, de Tocqueville ou de Dostoïevski a été choqué par les caractères monstrueux de la matrice américaine qui achève de nous engloutir aujourd’hui. Toute la civilisation US était programmée pour se/nous mener à la catastrophe : on sent pointer cet aspect dans des livres comme « Comment réussir à échouer » ou « Faites vous-même votre malheur » — tous publiés au Seuil — qui finalement expliquent comment le projet occidental capote : par culte du perfectionnisme et de la solution qui crée le problème. Il est clair du reste que cet échec va être le nôtre et qu’il nous exterminera — tout comme il tourmente les victimes de ce culte de la solution. Qu’il s’agisse du carbone, du vaccin, de la sécurité numérique, tout est mis en œuvre pour nous liquider dans un lit de bonnes intentions.
J’adore ce passage sur le père impossible en Amérique (on n’y est pas un son of a bitch pour rien) :
« Au début de son traité The American People, devenu un classique, l’anthropologue britannique Geoffrey Gorer analyse le phénomène typiquement américain du rejet du père, et l’attribue à la nécessité, qui s’imposait pratiquement à chacun des trente millions d’Européens qui émigrèrent aux États-Unis entre 1860 et 1930, de s’adapter aussi vite que possible à la situation économique américaine. Mais, en s’efforçant de faire de ses enfants (généralement nés aux États-Unis) de “vrais” Américains, il devint, pour ces derniers, un objet de rejet et de dérision. Ses traditions, ses connaissances insuffisantes de la langue et surtout ses valeurs constituaient une source de gêne sociale pour la jeune génération qui fut, à son tour, victime de la réprobation de ses enfants. Ce rejet du père comme symbole du passé va de pair avec la surestimation des valeurs nouvelles et donc de la jeunesse. »
Le culte de la jeunesse c’est celui de la marchandise nouvelle qui chasse l’autre, a dit Debord. Ici aussi :
« Ce rejet du père comme symbole du passé va de pair avec la surestimation des valeurs nouvelles et donc de la jeunesse. Le trentième anniversaire est cette date fatidique qui vous met au rebut du jour au lendemain, et mieux vaut ne pas parler du quarantième. Il en va de même avec l’engouement pour tout ce qui est nouveau, et tire sa qualité de cette nouveauté, même s’il s’agit d’une vieillerie sortie tout droit du magasin de friperie. »
La liquidation du père est générale : Lipovetsky avait décrit le déclin du père musulman en France dès les années 1980 en France (relisez l’imposante Ère du vide) ; elle a été facilitée par les modes, la création/manipulation de la sous-culture et la musique destinée à la jeunesse — et aujourd’hui par la technologie qui crée des barrières infranchissables entre technophiles et « petits vieux » de quarante ans. Smart-siphonnés et Tik toqués sont dans leur monde.
Mais ce n’est pas tout. Watzlawick rappelle que ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on constate une prodigieuse inculture et une prodigieuse sous-information américaine (et maintenant en France et en Europe). Les Américains sont pauvres en informations (allez, Tocqueville écrit la même chose !) :
« Volontairement, et d’une manière spontanée, les Américains ont atteint un degré d’appauvrissement de l’information et une conformité d’opinions qui feraient pâlir d’envie les gouvernements de démocraties populaires, soucieux d’insuffler leur ligne de pensée à leurs sujets récalcitrants. Je ne peux émettre qu’en dilettante des considérations théoriques sur la manière par laquelle on en est arrivé là, mais vous vous rendrez compte, très rapidement, qu’il en est vraiment ainsi. La liberté d’opinion et de presse américaine, tant vantée, existe, cela ne fait aucun doute. »
On a vendu écrit le maître cette liberté pour « le plat de lentilles de la conformité » (Macluhan remarque aussi qu’en Amérique on a cent chaînes qui crachent toutes la même chose) :
« Personne ne prescrit au citoyen ce qu’il doit penser, croire ou éprouver. Mais, soit les Américains ont vendu cette liberté pour le plat de lentilles de la conformité, si bienfaisante, soit ils n’en ont jamais fait usage. Dans un cas comme dans l’autre, le résultat est le même : le moindre quotidien de province de l’Europe à l’ouest du rideau de fer vous donne plus d’informations sur la situation mondiale qu’il n’est possible d’en obtenir aux États-Unis. »
On voit ce qui se passe mondialement : chasse au virus, puis chasse au russe, puis chasse au Palestinien — et au « pro-palestinien » (rebaptisé « pro-Hamas » pour faire court) qui trouverait que huit mille femmes et enfants tués cela ferait beaucoup — en attendant le million de déportés qui enchantera le bloc bourgeois de Lordon.
Watzlawick explique comment tout cela fonctionne, cette information, comment tout cela se transmet, comme une banale et dégueulasse bouffe de fastfood :
« Aux États-Unis, le journal que vous lisez importe peu, car leurs nouvelles, mâchées et livrées sous un emballage aseptique de cellophane métaphorique, paraissent toutes sortir d’un même et unique supermarché de l’information. Même le style reste largement identique, et de méchantes langues prétendent que la formation d’un journaliste se limite à l’apprentissage de trois règles : 1.Tell them what you are going to tell them. 2.Tell them. 3.Tell them what you have just told them.(En français, du fait des différents sens de tell, cela donne :1.An-nonce-leur (c’est-à-dire aux lecteurs) ce que tu vas leur dire. 2. Dis-le-leur. 3.Explique-leur ce que tu viens de leur dire.) »
Après on rabâche comme à la télé avec des chroniqueurs et des commentateurs (c’est Jean-Luc Godard qui disait que BHL n’était ni un écrivain ni un cinéaste, mais un éditorialiste : de fait nous sommes assiégés d’éditorialistes-répétiteurs) :
« Ces produits font ensuite l’objet d’un développement subjectif dans les élucubrations de chroniqueurs appelés columnists qui, tous les jours de l’année, sur la même page du journal, minimisent avec humour certains événements ou les commentent de manière à les rendre édifiants pour tout lecteur ayant un Q.I. de 85. »
Sur la radio Watzlawick écrit des lignes terribles (on repense au début de Citizen Kane — ou à des dessins animés de Tex Avery) :
« Les innombrables stations de radio américaines appartiennent au secteur privé et vivent d’émissions publicitaires. Leurs fonctions récréatives ne possèdent plus, à l’ère de la télévision, beaucoup d’importance, et elles servent uniquement de bruit de fond. Certaines d’entre elles semblent entièrement automatisées et, s’il arrive un incident avec un disque ou une bande magnétique, l’appareil tourne à vide jusqu’à ce que quelqu’un s’en rende compte. »
Comme le froncé de Macron (cf. mon texte sur le « peuple nouveau »), l’américain de Watzlawick ne veut que se fondre dans la masse, vivre et penser comme tout le monde (Tocqueville ou Francis Parker Yockey ont écrit des lignes flamboyantes à ce sujet, comme Georges Duhamel) :
« Alors qu’un Européen ne supporte pas d’être pris pour Monsieur Tout-le-Monde, le souci majeur d’un Américain est de ne pas dévier des normes du groupe. La différence entraîne l’expulsion du groupe, la mise au ban. D’où, probablement, sa répugnance à se retrouver tout seul au restaurant, car cela laisse supposer que personne ne l’aime. »
Watzlawick appuie aussi sur un point important : l’américain a droit au bonheur — c’est dans sa constitution et c’est une erreur de Jefferson dit le maître. Cette chasse folle et obligatoire au bonheur va précipiter les catastrophes.
« Peut-être cette exigence du droit au bonheur est-elle liée à cette rage de psychologie et de thérapie des Américains : personne ne cache qu’il est en analyse depuis des années, bien au contraire, cela fait partie, en quelque sorte, de son prestige social. »
La chasse au bonheur nécessite un couple parfait ; un couple parfait nécessite discussions et règlements de comptes ; et là Watzlawick cite un chercheur français très oublié :
« Ce procédé n’est, semble-t-il, pas nouveau, mais redécouvert, car en 1938 déjà le journaliste français Raoul de Roussy de Sales décrivit, dans son essai Love in America, ce culte de la “sincérité ravageuse” :
« Les époux semblent perdre d’innombrables heures du jour et de la nuit à l’analyse des failles qui entachent leur liaison. Ils sont convaincus qu’il faut — selon les préceptes de la plupart des psychologues et pédagogues modernes — affronter résolument la vérité (…) Quel que soit l’attrait de cette théorie, sa mise en pratique s’avère généralement lourde de conséquences, et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, la vérité est un explosif qu’il faut manipuler avec précaution, surtout dans la vie conjugale. Il n’est pas nécessaire de mentir, mais jongler avec des grenades à main à seule fin de prouver son intrépidité ne rime pas à grand-chose. Deuxièmement, la théorie préconisant une sincérité absolue part du principe qu’un amour qui ne résiste pas à des assauts permanents ne mérite pas, de toute façon, d’être entretenu. Il y a, en effet, des gens qui prennent leur vie amoureuse pour une éternelle bataille de Verdun. Et, une fois que le système de défense est irrémédiablement détérioré, l’un ou même les deux partenaires invoquent une incompatibilité d’humeur désespérée. À la suite de quoi on divorce et l’on choisit quelqu’un d’autre, avec qui l’on sera de nouveau d’une sincérité sans ménagement, le temps d’une saison. »
On a l’impression d’une comédie screwball ou les mariés/fiancés/partenaires ne sont que deux acteurs qui parlent vite en se/nous cassant les oreilles : on reverra les classiques casse-têtes de Howard Hawks à ce sujet qui célèbrent des couples d’acteurs-amants-bateleurs sans enfants.
Tout cela est aussi lié au goût de la chicane qui est si américain (voyez ce passage de Robert Reich qui explique que dans un patelin il faut être deux avocats pour faire fortune) :
« Les Américains en général, et les Californiens en particulier, sont les gens les plus chicaneurs de la terre », constata, dès 1977, le conseiller juridique du gouverneur de Californie, qui semble bien placé pour le savoir. Il existe, en Californie, 62 000 avocats, auxquels s’ajoutent 5 000 nouvelles recrues par an. Sur l’ensemble du territoire fédéral, le nombre des avocats grimpa de 250 000 en 1960 à plus de 622 000 en 1984 et on estime qu’ils seront plus d’un million vers 1995. Comment peut-on résister, devant une telle offre, à porter n’importe quelle vétille devant les tribunaux ? »
La déclaration d’indépendance fut une drôle de date : la fin de l’humanité et son remplacement par l’anormalité.
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.