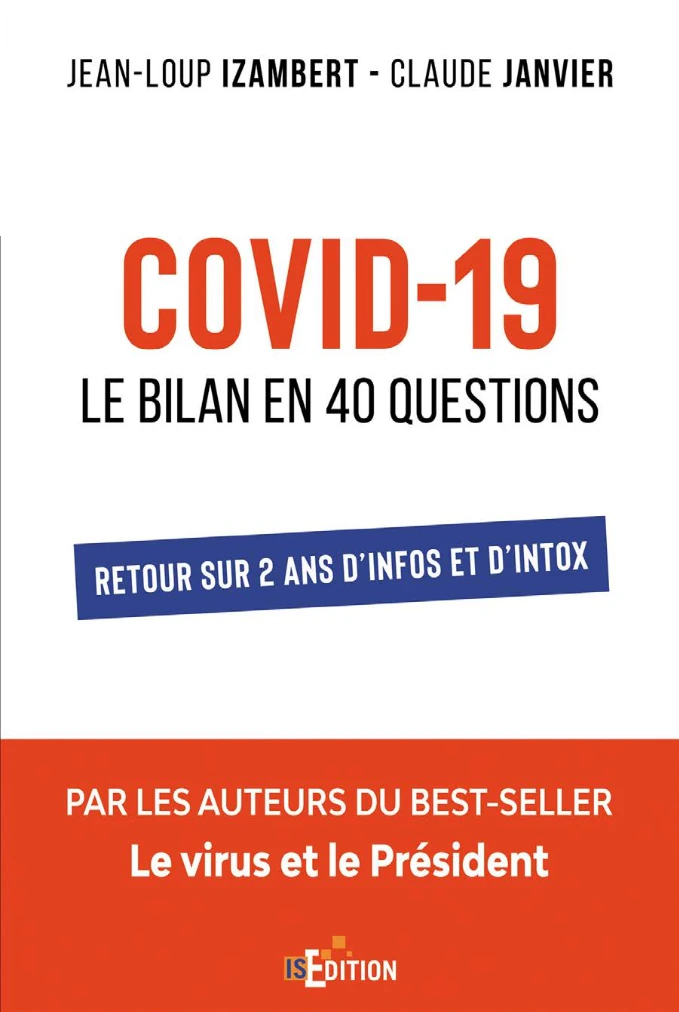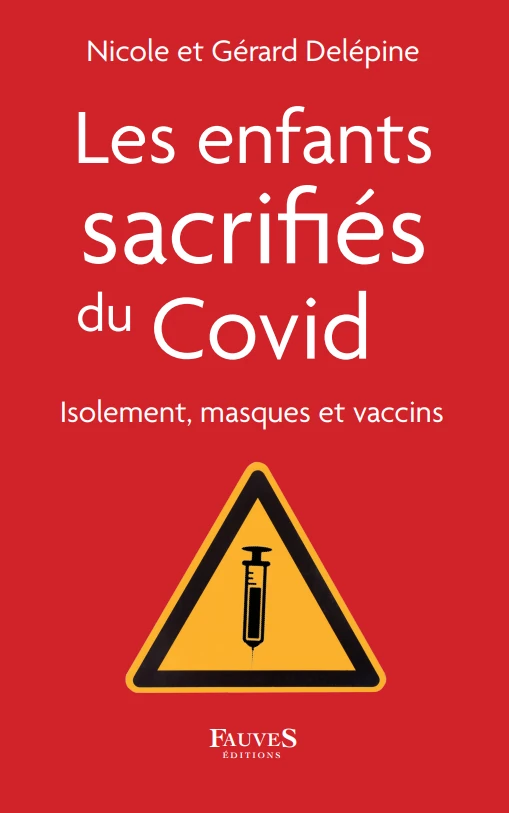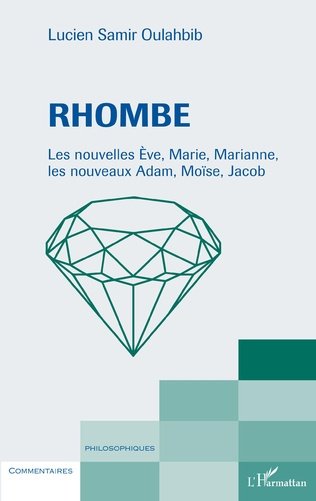07/07/2019 (2019-07-07)
[Source : Basta]
par Olivier Favier

CC James Gaither
Quand Stefano Mancuso fonde le laboratoire de neurobiologie végétale en 2005, parler d’« intelligence des plantes » scandalise encore une large part de la communauté scientifique. Pour ce botaniste, tout dépend de la définition du mot : les plantes n’ont pas de système nerveux central, mais ont une « capacité à résoudre des problèmes ». L’animal réagit aux difficultés en changeant d’environnement, la plante doit les surmonter. En étudiant ces stratégies, Stefano Mancuso veut non seulement changer notre regard sur les plantes, mais aussi utiliser ces connaissances pour stimuler l’innovation et résoudre des problèmes qui menacent désormais l’humanité entière.
Basta ! : Je voudrais revenir sur une première expérience que vous proposez durant vos conférences. Vous projetez la photographie d’une forêt et demandez au public ce qu’il voit. Il indique alors invariablement l’animal qu’on aperçoit dans l’image : un cheval, un lion, un singe. Si vous présentez en revanche une forêt sans animal, le public répond aussitôt qu’il n’y a rien à voir. Par cet exemple, vous montrez que nous ne sommes pas habitués à considérer les plantes. Elles représentent pourtant 85 % de la biomasse de la planète. Mais leur organisation est complètement différente de la nôtre, qui est pyramidale, avec un cerveau qui commande…
Stefano Mancuso : Tout ce que nous construisons au niveau de nos organisations sociales est bâti sur le modèle du corps animal. Or les animaux – humains compris – ne représentent que 0,3 % de la vie sur la terre, bien moins que les trois autres catégories que sont les végétaux, les champignons et les êtres monocellulaires. L’écrasante majorité des êtres vivants utilise des modèles différents du nôtre, qui est très fragile. Il suffit d’enlever la tête et toute l’organisation s’écroule. Il y a eu des empires, comme ceux des Aztèques et des Incas, des civilisations très avancées, dont l’organisation reposait exclusivement sur l’Empereur. Il a suffi aux Espagnols de s’attaquer à ce dernier pour que tout le système s’écroule instantanément.
Par son organisation horizontale, une plante survit même si, par exemple, un animal mange ou détruit une partie de son corps, quand un animal meurt dès qu’un de ses organes vitaux ou son cerveau sont ôtés ou détruits. Comment ce modèle peut nous inspirer dans l’organisation des sociétés humaines ?
Dans le modèle du corps animal, le lieu où le problème doit être résolu est très éloigné de celui où les décisions sont prises. Imaginons par exemple une organisation mondiale, il y en a beaucoup aujourd’hui. Disons qu’elle a son siège aux Nations-Unies. Elle doit prendre une décision sur un problème en Europe ou en Asie. Les informations qu’elle aura seront nécessairement partielles, et elles n’auront jamais ce degré de détail des informations obtenues sur place. Gardons toujours l’exemple de cette organisation mondiale, où toutes les décisions sont prises par un conseil d’administration d’une dizaine de personnes. Cela n’arrive jamais dans la nature. Si en revanche toutes les personnes qui travaillent dans cette organisation ont la possibilité de proposer des solutions, celles-ci seront nécessairement plus justes.
C’est ce que racontait déjà le « théorème du jury » de Condorcet, mathématicien et homme politique français, à la fin du 18ème siècle à propos de la décision à prendre pour un condamné. Selon Condorcet, plus grand est le nombre des personnes qui composent le jury, plus grande est la probabilité que la décision prise soit correcte. Nous ne parlons pas de politique ou d’éthique, mais de mathématiques. C’est pourquoi dans la nature toutes les organisations sont faites de manière à ce que tous ses membres participent à la décision.
Pourrions-nous penser à construire nos modèles ainsi ?
Bien sûr. C’est parfois le cas. La structure physique d’internet est conçue comme une plante. Prenons l’exemple de Wikipédia : dans les encyclopédies classiques, il y a la direction générale, puis celles des différents secteurs, puis des spécialistes pour chaque sous-secteur, bref une pyramide de personnes. Ces encyclopédies produisent en général un volume tous les deux ou trois ans. Wikipédia en anglais a produit en dix ans l’équivalent de 38 000 volumes de l’Encyclopædia britannica. On pourrait penser que la qualité des informations s’en ressent, mais c’est faux. Une étude comparative a montré que les informations sont plus détaillées, approfondies et mises à jour que dans l’encyclopédie papier.
C’est une organisation complètement décentralisée qui bénéficie d’un contrôle mutuel permanent. Je ne connais rien en physique, et je pourrais écrire que les ondes gravitationnelles sont les soupirs des fées. Personne ne m’empêche de le faire. Une minute plus tard cependant, mille physiciens effaceront mon apport et écriront ce qu’est vraiment une onde gravitationnelle. Un chef n’est pas nécessaire pour dire que ce qui est écrit est faux. C’est un jeu continuel de la démocratie.
On peut utiliser cela aussi dans le domaine économique. Prenons le cas de la Morning Star Company, qui transforme environ un quart des tomates produites en Californie et répond à 40 % de la demande étasunienne dans ce secteur. Elle n’a pas de manager. En moyenne, dans les entreprises, le management représente 30 % des dépenses ; et le reste des effectifs est appelé employés, ou même dipendenti en italien, ce qui veut dire qu’elles dépendent de ceux qui sont au-dessus d’eux. C’est une terminologie qui détermine le caractère subalterne du travailleur. Dans le cas de la Morning Star Company, le terme utilisé est celui de « collègue ». Cela ne veut pas dire que dans cette entreprise toute le monde a le même salaire. Il n’y a simplement pas d’échelle de rémunérations en fonction d’une hiérarchie des postes, mais selon une évaluation publique des capacités. En d’autres termes il y a des règles mais elles sont différentes.Je lis, j’aime, je vous soutiens
Dans votre livre L’intelligence des plantes, publié en français en 2018, vous évoquez Darwin, que vous considérez comme l’un des plus grands savants de l’Histoire. Vous expliquez que son intérêt pour les plantes est aussi considérable que méconnu. De lui, à la fin du 19ème siècle, on se souvient d’une lecture partiale et controversée : le darwinisme social. À cette théorie, Pierre Kropotkine répond par le concept d’ « entraide », lui aussi facteur d’évolution. Comment s’opère l’évolution chez les plantes ? S’agit-il seulement de sélection, ou retrouvons-nous différents mécanismes, parmi lesquels une forme de solidarité ?
En général, nous croyons que l’évolution est une sorte de lutte pour la sélection du meilleur. C’est une lecture inventée par les darwinistes sociaux, qui va donner naissance à toute une série d’horreurs, comme l’eugénisme. Pour Darwin, le processus de l’évolution sélectionne non le meilleur mais le plus adapté, ce qui est complètement différent. Kropotkine, qui était un théoricien de l’anarchisme mais aussi un grand biologiste, écrit un livre pour réfuter les stupidités du darwinisme social. Ce qu’il appelle « l’entraide » est une des formes fondamentales de l’évolution. Il avait raison, même si nous lui donnons un autre nom, par exemple la « symbiose ».
On a découvert que la « symbiose », c’est-à-dire ce processus par lequel deux êtres vivants s’unissent pour tirer profit l’un de l’autre est l’un des grands moteurs de l’évolution : la cellule est née de la symbiose entre deux bactéries. L’union, la communauté, est une force beaucoup plus puissante que toute autre forme d’évolution.
De ce point de vue, les plantes sont extraordinaires. Elles ne peuvent pas se déplacer. Quand tu as des racines, tous ceux qui sont autour de toi sont fondamentaux. Une plante seule ne peut survivre, elle a besoin de communauté, mais aussi d’autres organismes. La plante entre en symbiose avec tous : bactéries, champignons, insectes, et même avec nous les hommes, par exemple quand nous mangeons du maïs et que nous emmenons cette plante partout dans le monde. La vie se fonde sur la création d’une communauté, non sur la sélection d’un meilleur hypothétique.
Parallèlement à votre laboratoire, vous avez créé une start-up, PNAT (acronyme pour Project nature), avec d’autres chercheurs. Ce think tank se définit comme « inspiré par les plantes ». Qu’est-ce que cela signifie ?
Cette start-up produit des solutions technologiques qui sont en effet toutes inspirées par les plantes. Nous prenons des solutions végétales et nous les transposons. C’est le cas du plantoïde qui est un robot utilisé pour explorer le sous-sol. Au lieu de s’inspirer du modèle animal, il utilise des sortes de racines, car rien n’est aussi efficace pour la mission qu’il doit remplir. Celles-ci peuvent se déplacer en fonction des stimuli envoyés par les capteurs placés à leurs extrémités et contourner de la sorte une pierre ou une zone polluée. Les feuilles peuvent mesurer les différents paramètres de l’air ambiant. On imagine sans peine les applications qu’une telle machine peut avoir pour l’agriculture, la surveillance et la cartographie des terres.
Nous avons créé aussi la Jellyfish Barge, qui est une sorte de serre flottante, totalement autosuffisante, elle n’a pas besoin d’eau douce parce qu’elle dessale l’eau de mer, elle n’utilise pas le sol parce qu’elle flotte, et pour toute énergie elle n’a besoin que de l’énergie du soleil. Elle permet de produire suffisamment de fruits et de légumes pour huit personnes. La Jellyfish Barge a été primée à l’Expo de Milan en 2015, mais elle n’a pas encore inspiré d’applications concrètes hors de nos expériences.
Actuellement nous travaillons sur la purification de l’air à l’intérieur des espaces de vie. Nous passons 80% de notre temps dans des édifices dont la qualité de l’air est quatre ou cinq fois pire que celle du dehors. Pour purifier cet air, les plantes sont fondamentales.
Dans La Révolution des plantes, votre deuxième livre traduit en français, qui vient d’être publié chez Albin Michel, vous démontrez que les plantes sont non seulement intelligentes, mais aussi dotées de mémoire et d’une capacité d’apprentissage [1]. Ce sont toutes ces découvertes et redécouvertes qui vous ont inspiré le concept de « droits des plantes ». Mais dans une époque où les droits de tant de catégories de personnes sont niés ou remis en cause – je pense notamment à ceux des migrants – pourquoi jugez-vous important d’ouvrir ce nouveau front ?
Évidemment, parler du droit des plantes quand tant de personnes dans le monde n’ont pas de droits peut sembler une abomination. Pourtant, je crois que le processus des droits suit précisément celui de l’évolution. Au temps des Romains, le père de famille était le seul être vivant qui avait des droits. L’épouse et les enfants, pour ne rien dire des esclaves, étaient la propriété du père de famille. Puis certains pensèrent qu’on pouvait donner des droits au fils aîné et cela créa un scandale. Chaque fois qu’on parle d’élargir les droits à d’autres êtres vivants, la première réaction que nous avons est la stupeur. Mais comment ? Même les plantes ? N’exagérons pas.
Depuis lors, les droits se sont élargis aux femmes, pour les personnes d’origine différente, puis, en-dehors de la sphère humaine, pour les animaux. Je suis donc certain que nous donnerons aussi des droits aux plantes.
Pourquoi est-ce fondamental ? Parce que ce sont des êtres vivants et que tous les êtres vivants devraient avoir des droits. Par ailleurs, ce sont des plantes que dépend la vie des autres êtres vivants. Si de nombreuses espèces animales disparaissent, c’est infiniment regrettable, mais la survie de l’homme n’est pas compromise. Mais si les forêts disparaissent, nous risquons de disparaître nous aussi. Donner des droits aux plantes revient à donner des droits aux êtres humains.
Qu’est-ce que vous entendez par « droits des plantes » ?
Par exemple, les forêts devraient être déclarées intouchables. Elles devraient être considérées comme des lieux naturels de vie des plantes. Un autre droit que je considère fondamental est celui de ne pas les considérer comme des moyens de production. On dit que la façon dont nous élevons certains animaux est inhumaine, et que l’élevage industriel devrait être interdit. C’est juste. De la même manière, l’agriculture intensive et industrielle devrait être interdite. Si nous parvenions à cela, le bénéfice serait énorme. L’agriculture industrielle représente probablement 40% de l’impact humain sur l’environnement, plus que les transports par exemple, et nous n’en avons guère conscience. Quand on élargit les droits, tous les êtres vivants en profitent, sans exception.
Vous faites souvent référence au Club de Rome, qui, en 1972, décrivait avec précision le problème d’une société dont le modèle de croissance reposait sur une exploitation toujours plus importante de ressources limitées. En ce qui concerne la décroissance, la lenteur, le besoin de créer un autre rapport avec notre planète, il semble que l’Italie ait été capable de produire un discours radicalement nouveau, il y a cinquante ans, à travers certains intellectuels ou écrivains [2]. Pensez-vous que le discours que vous portez sur les plantes prolonge d’une part ces idées, et de l’autre fasse partie de ce grand laboratoire italien, dont on parle si souvent ?
Je pense que toute la partie qui concerne le fait de s’inspirer des plantes suit la même ligne de la grande discussion qui a commencé en Italie au début des années 1970 et qu’on nomme aujourd’hui le problème environnemental.
À l’époque, ce problème était d’ailleurs interprété de manière beaucoup plus correcte qu’aujourd’hui comme un véritable problème politique. Ce n’est pas une question qui regarde une frange de personnes qui aiment la nature. Non, l’environnement est l’unique question politique, une question très sérieuse dont dépendent toutes les autres. Il est clair qu’un modèle de croissance qui prévoit une consommation de ressources toujours plus importante n’est pas durable. C’est une idée d’une telle évidence et d’une telle banalité qu’elle fait douter de la capacité logique des hommes.
Je souhaite que le laboratoire italien qui a fonctionné comme avant-garde d’atrocités mais aussi de nouveautés intéressantes au cours du siècle dernier puisse cette fois encore avoir une prise réelle sur le reste du monde. Les chiffres sont très clairs : le protocole de Kyoto, les Cop 21 et 22 n’ont eu aucune influence sur la production croissante de dioxyde de carbone. Je pense que la seule possibilité sérieuse que nous ayons d’inverser cette courbe, c’est d’utiliser les plantes de manière correcte, par exemple en en recouvrant les villes. Le dioxyde de carbone est produit en ville, et c’est là que les plantes doivent l’absorber. Nos villes seraient aussi plus belles, plus saines, et cela aurait un impact positif sur la santé et la psyché des êtres humains. Il n’y a donc aucune raison de ne pas le faire.
Propos recueillis par Olivier Favier
Notes
[1] A ce sujet, Stefano Mancuso cite une expérience réalisée sur le mimosa pudique au 18e siècle par un élève du naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck. Cette plante, qui replie ses feuilles devant un danger, cesse de le faire si le stimulus est répété sans être accompagné d’une réelle agression. Si l’expérience est répétée après quelques mois, le mimosa conserve son comportement acquis et fait ainsi l’économie d’une réaction extrêmement coûteuse pour elle en énergie.
[2] Voir par exemple la lecture que fait Pier Paolo Pasolini du nazisme comme totalitarisme consumériste dans son film Salò (1975) et sur sa banalisation dans notre société. Sur ce dernier point, il rejoint les lectures de Goffredo Parise et de Nicola Chiaromonte, toujours inaccessibles en français. On ne peut que mettre leurs lectures en parallèle avec celles produites ailleurs en Europe et aux États-Unis par l’école de Francfort, Herbert Marcuse, Jacques Ellul, Ivan Illich, Jean Baudrillard ou bien sûr Guy Debord, toutes visant à prolonger la critique classique du capitalisme par des concepts tels que « société de consommation », « société du spectacle », « productivisme ». Un mot enfin pour saluer le rôle fondamental joué dans le Club de Rome par son fondateur Aurelio Peccei. Le rapport de 1972 ne prônait pas la décroissance – concept créé la même année par André Gorz – mais « la croissance zéro » pour les pays riches.
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.