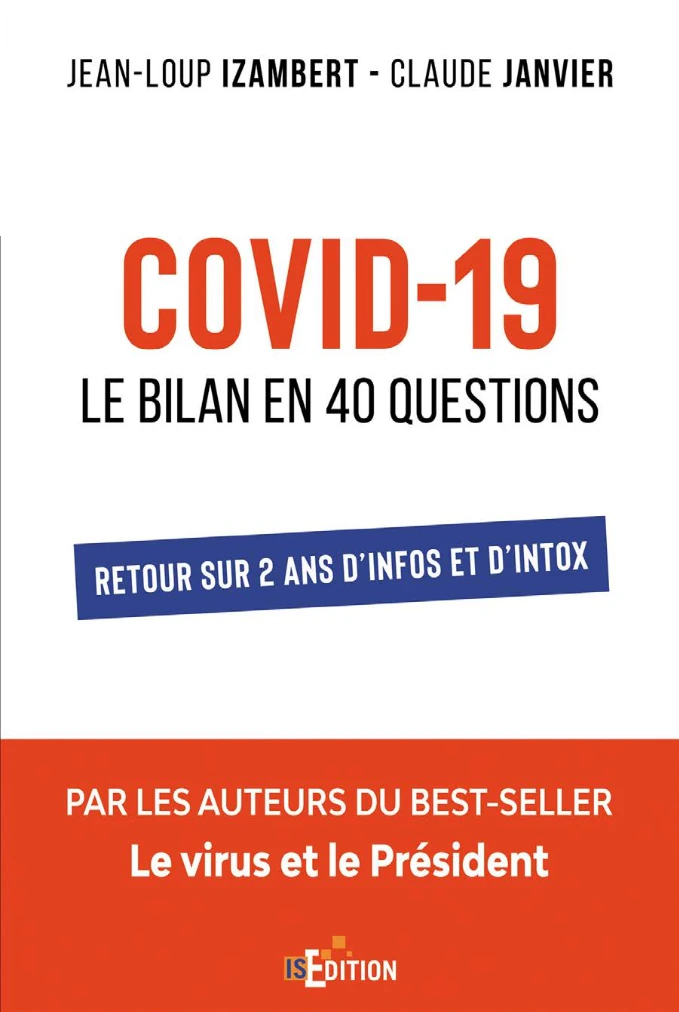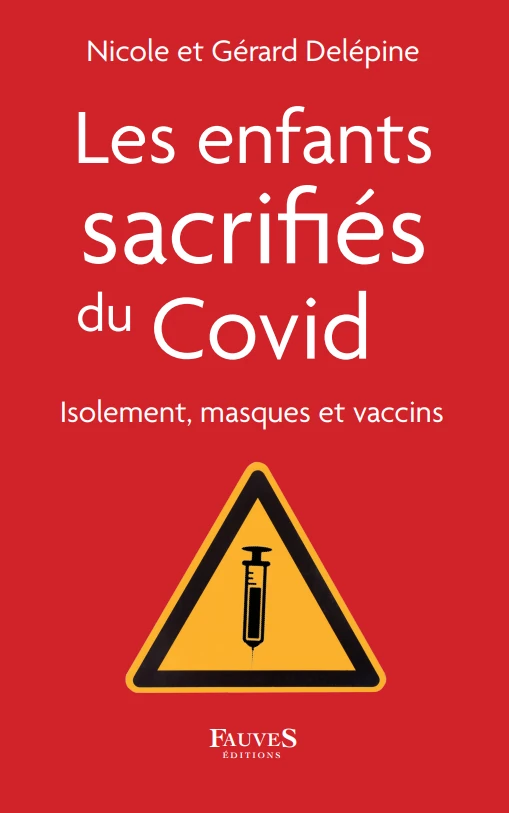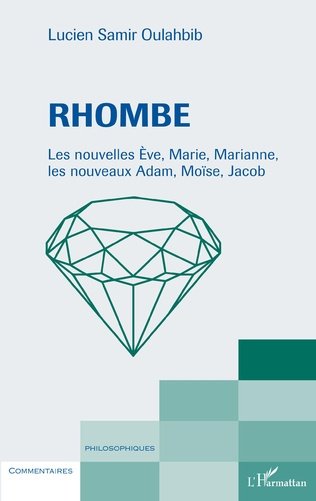26/02/2023 (2023-02-26)
[Source : elucid.media]
Par Myret Zaki
L’impact planétaire des actions poursuivies par de richissimes fondations, comme Gates ou Soros, nécessite un contrôle démocratique. Sans quoi, des intérêts spécifiques pourraient phagocyter l’intérêt général. Aux États de jouer leur rôle d’ultime gardien des démocraties.
Aujourd’hui, les grandes fondations philanthropiques, créées par des milliardaires, financent de nombreux aspects de la vie des citoyens, se substituant aux fonds publics. Cette puissance exercée par des entités privées soulève d’importantes questions de responsabilité sociale, qui sont loin de recevoir l’attention nécessaire. En effet, bien que ces structures pèsent de plus en plus lourd sur le devenir de l’économie, de la santé, de la culture, de la recherche scientifique et académique, ou de l’information, elles ne rendent pas de comptes au public et ne sont pas élues démocratiquement pour assumer une telle responsabilité. Il n’existe en effet pas d’audits indépendants de leurs activités, en dehors d’instances comme la Cour des comptes en France.
Quels impacts sociaux et/ou économiques ont-elles eus à travers leurs financements ? Quelles améliorations concrètes ont-elles apportées à la société ? Quels ont été les effets indésirables pour le bien commun ou pour la démocratie ? On en sait très peu à ce sujet. Pourtant, des fondations comme celles de Bill Gates, de George Soros, ou de Louis Vuitton affectent en partie — sans partir dans des délires conspirationnistes — les informations que nous lisons, la culture que nous consommons, les médicaments que nous prenons, la recherche académique que nous étudions, ou les décisions d’instances comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Or, ces fondations philanthropiques, qu’elles soient américaines ou européennes, ne sont pas responsables devant les citoyens et contribuent selon leur bon vouloir, contrairement aux élus qui allouent des fonds publics à différents domaines d’intérêt général. Bref, les responsabilités des fondations ne sont pas à la hauteur de l’impact qu’elles exercent.
Secteur de la santé publique
Si l’on prend l’exemple de la Fondation philanthropique Bill & Melinda Gates, créée il y a 23 ans par le fondateur de Microsoft et son épouse, elle est dotée de plus de 50 milliards de dollars et représente aujourd’hui le premier donateur privé de l’OMS, avec 10 % du budget, ce qui lui confère un pouvoir démesuré sur cette agence de l’ONU. Cette dépendance excessive envers des fonds privés n’est pas sans problèmes. Elle risque d’obliger l’OMS à faire siennes les priorités de son donateur.
[Voir aussi :
►Le « traité pandémique » de l’OMS mettra fin à la liberté telle que nous la connaissons et remettra les « clés du pouvoir » à son plus grand bailleur de fonds privé, M. Bill Gates
►Une lanceuse d’alerte de l’OMS : « Nous vivons une pandémie de mensonges – Bill Gates est aux commandes »
►Vaccins, puçage, réseau d’influence, OMS : Bill Gates est-il le roi du monde ?
►L’OMS, Bill Gates et les vaccins
►Les responsables de la santé admettent que Bill Gates dirige le monde
►Le projet maléfique de Gates s’appuie sur la corruption. 319 millions déversés dans les médias]
L’essentiel du financement fourni par la Fondation Gates est lié aux agendas spécifiques de la fondation, comme l’explique à Swissinfo un professeur à l’Université de Georgetown, également directeur à l’OMS. Cela signifie, d’après lui, que l’OMS ne peut pas vraiment décider des priorités en matière de santé globale, et qu’elle est tributaire des priorités d’un acteur privé qui ne rend compte qu’à lui-même. Comme la Fondation Gates l’explique elle-même, il lui faut opérer des choix quant à ce qu’elle finance ; par exemple, elle se concentre sur l’éradication de la poliomyélite ou sur les questions d’immunité.
La préférence des philanthropes privés tend à aller vers des objectifs mesurables et réalisables à court terme, car cela leur permet d’afficher des résultats concrets et d’assurer une bonne réputation pour la philanthropie privée. C’est du moins l’idée exposée par Linsey McGoey, professeure de sociologie à l’Université d’Essex et auteure du livre « Il n’y a pas de cadeau gratuit : la Fondation Gates et le prix de la philanthropie » (No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy). En revanche, renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement est un objectif moins aisément mesurable, plus désintéressé, au long cours, et qui se retrouve dès lors délaissé et sous-financé.

D’autres critiques ont souligné le refus de la Fondation Gates de soutenir une levée momentanée des brevets sur les vaccins anti-Covid, qui aurait permis aux pays en développement de produire des vaccins pour leur population. La Fondation favorisait ainsi la défense des intérêts du secteur pharmaceutique aux dépens de ceux du plus grand nombre, contrairement à sa vocation proclamée. Mais au final, peu de critiques se sont élevées au sein de l’OMS. Fin 2020, le New York Times a appelé cette autocensure « The Bill Chill ». On arrive au cœur du problème de gouvernance : livrer des causes publiques aux mains d’acteurs privés ne permet pas de les questionner démocratiquement, et peut difficilement garantir une protection des intérêts du plus grand nombre.
Le secteur de l’information
Dans le monde de l’information aussi, les fondations philanthropiques ont acquis un poids important. Nombre de médias ont dû se tourner vers ces institutions, faute de recettes suffisantes des lecteurs et des annonceurs. Cela soulève des risques évidents pour l’indépendance de l’information. Un journal soutenu par une fondation ne publiera pas d’enquêtes négatives sur cette dernière et sur les milliardaires qu’elle représente. Les dons ou mécénats de fondations milliardaires peuvent influencer la ligne éditoriale des médias bénéficiaires. Ce risque pour la liberté d’information n’est pas suffisamment pris en compte.
Les mêmes problèmes de gouvernance précités se posent, avec cette fois, une acuité particulière. Car l’indépendance de l’information est le pilier central des démocraties. Une saine distance doit être maintenue entre les organes d’information et les classes les plus aisées de la société, qui ont l’impact le plus important sur le monde politique, scientifique, culturel, économique et environnemental. Ce problème relève de la gouvernance des fondations. L’autonomie qui leur est laissée n’est plus adaptée à leur importance.
En France, le quotidien Libération appartient désormais à un « Fonds de dotation pour une presse indépendante », mis en place par le milliardaire Patrick Drahi. La rédaction est-elle indépendante pour autant ? La question du contrôle s’avère primordiale ici, comme l’explique Julia Cagé, économiste des médias. L’auteure a expliqué dans son ouvrage (L’information est un bien public) que ce n’est pas un fonds de dotation qui garantit, en soi, l’indépendance d’un journal, mais la gouvernance démocratique du fonds, qui doit inclure les salariés et les journalistes.
Or, dans le cas de Libération, ces derniers ne sont pas impliqués dans les prises de décision. Le fonds de dotation n’offre donc pas une garantie d’indépendance aux journalistes, pas plus que s’ils travaillaient au Washington Post, détenu en direct par le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. De même, si Jeff Bezos avait créé une « fondation Bezos pour les médias », mais qu’il avait nommé lui-même tous les membres du conseil d’administration, il n’y aurait pas plus de gain en termes d’indépendance.

et le patron d’Altice France, Alain Weill (D), assistent à l’inauguration du Campus Altice à Paris,
le 9 octobre 2018 — Eric Piermont — @AFP
D’autres fondations ne rachètent pas directement des journaux, mais agissent comme des mécènes réguliers pour nombre d’entre eux. Là aussi, un positionnement de mécène permanent pour le secteur des médias ne facilite pas une couverture médiatique critique des activités de ce mécène. Citons l’exemple de l’Open Society Foundation, la fondation philanthropique du milliardaire George Soros, le spéculateur qui s’est enrichi dans les années 90 en pariant contre la Banque d’Angleterre. Sa Fondation, dotée de 20 milliards de dollars, aide de très nombreux titres à travers le monde, parfois à coup de centaines de milliers de dollars par an, en poussant, à l’intérieur des États-Unis comme partout dans le monde, une idéologie atlantiste, pro-américaine et pro-démocrate.
Parmi ses bénéficiaires, le Consortium international de journalistes d’investigation, qui a obtenu 3,2 millions de dollars de dons entre 2017 et 2021, d’après le site de l’Open Society. Un montant conséquent. Imaginons maintenant qu’une fuite des paradis fiscaux couverte par le Consortium concerne des comptes non déclarés par George Soros. Que se passera-t-il ? On voit ici la difficulté d’enquêter sans complaisance sur une entité qui fournit 3,2 millions de dollars d’aides. Entre 2016 et 2018, George Soros n’a payé aucun impôt fédéral aux États-Unis. Le site ProPublica, qui a reçu 1,45 million de dollars de dons de la Fondation Open Society entre 2017 et 2019, a certes dévoilé l’information, mais son article excusait le milliardaire en citant ses représentants, qui justifiaient le non-paiement d’impôts par des pertes financières.
Il en allait autrement de la couverture du Wall Street Journal. Peut-être parce qu’il est indépendant de Soros, le WSJ a révélé en 2017 que le milliardaire a transféré pas moins de 18 milliards de sa fortune dans ses fondations, dirigées par son fils Alexander, ce qui lui a permis de défiscaliser cet énorme montant, et de déduire 20 % de cette valeur de son revenu personnel. Moins complaisant, le journal s’étonne que personne, dans la classe politique, n’ait levé un sourcil à ce sujet. Peut-être parce que George Soros finance aussi massivement les campagnes politiques ?
Sur le site de l’Open Society, on peut constater que les donations en faveur des médias sont massives. Elles se concentrent largement sur les médias d’Europe de l’Est et jusqu’aux frontières de la Russie. Quel est l’impact de ces financements sur les contenus ? Ces financements sont-ils conditionnels à certains contenus ? Quels types de messages sont délivrés par les médias financés ? Ont-ils une ligne idéologique proche de celle de leur donateur ? Exercent-ils un impact politique sur l’opinion publique de ces pays ? Des informations transparentes à ce sujet seraient d’un intérêt public évident, car les lecteurs qui lisent ces publications n’ont pas toujours conscience des bailleurs de fonds qui sont derrière. Les fondations qui financent les médias dans de telles proportions ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité sociale dans la formation des opinions à l’échelle planétaire, tout comme Twitter et Facebook sont aujourd’hui lourdement responsabilisés par les États.

Comme l’Open Society, la Fondation Bill & Melinda Gates soutient certains titres, comme le journal britannique The Guardian. En 2010, ce quotidien a lancé une rubrique « développement global » sponsorisée par la fondation. Le contenu, axé sur l’Afrique, est-il complet et indépendant ? On a pu constater en 2021 que les informations critiques liées aux activités de Bill Gates en Afrique sont absentes du journal. Fin mars 2021, le média Reporterre publie une enquête fouillée. Elle montrait comment la Fondation Gates avait mené un lobbying intensif à Bruxelles, versant 1,3 million d’euros pour exercer des pressions sur la Commission européenne, afin de déréguler les « nouveaux OGM ». Objectif : inciter l’Afrique à suivre la voie de l’UE et accepter cette nouvelle variété d’OGM, dans laquelle Bill Gates a beaucoup investi en Afrique. Sans grande surprise, l’information n’a pas été reprise par le Guardian.
En 2014, l’ONG Grain, a révélé que sur 3 milliards de dollars consacrés par la Fondation Gates au développement agricole en Afrique entre 2003 et 2014, seuls 4 % étaient allés directement au continent africain, dont la moitié à des organisations internationales. La part du lion, elle, aurait financé des laboratoires américains. Selon le rapport de Grain, « pas un centime de la Fondation n’est allé à des programmes de développement conduits par des agriculteurs africains, même si ces derniers fournissent toujours 90 % des semences du continent ». Certes, cette information a été reprise par le Guardian, mais c’est l’exception qui confirme la règle. Une liste des points de vue critiques sur le travail de la Fondation Gates en Afrique est fournie ici par l’ONG « U.S. right to know », et un coup d’œil rapide permet de voir que ce sont à 99 % des ONG et des médias indépendants qui font le travail critique.
Dans d’autres cas, ce sont les conflits d’intérêts qui peuvent être hautement problématiques. Ainsi, la Fondation Gates a été couverte, pendant des années, par deux chroniqueurs du New York Times, David Bornstein et Tina Rosenberg, qui avaient un conflit d’intérêts majeur : ils travaillaient en même temps pour un groupe lourdement financé par la Fondation : Solutions Journalism Network. C’est ainsi que des années durant, le NYT, un des journaux qui influencent le plus l’opinion mondiale, a publié des articles complaisants et orientés à propos des projets de la Fondation Gates.
L’idée d’un journal qui est la « voix de son maître » n’est donc pas une caricature. Dans l’absolu démocratique, le maître doit être le citoyen. Pour ce faire, la forme juridique adéquate de la propriété d’un média doit garantir son indépendance, et le capital propre du média doit être irrévocable et inaliénable, contrôlé par la rédaction. Avec les exemples de mécénat précités, les conditions d’une véritable indépendance dans le secteur de l’information ne sont pas remplies.
Le secteur de la culture
Dans le secteur de la culture, le mécénat d’entreprise s’avère souvent imbriqué avec des objectifs de marketing et d’image, mais aussi d’optimisation fiscale, qui sont devenus communs aux grandes fondations philanthropiques. Prenons l’exemple de la Fondation Louis Vuitton. L’institution parisienne a bénéficié des profits records engrangés ces dernières années par le groupe LVMH, qui ont fait de Bernard Arnault et sa famille la première fortune mondiale, devant Elon Musk. Le géant du luxe, qui détient notamment les marques Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Moët & Chandon et Givenchy, a créé cette fondation en 2005, comme réponse à la création de la Fondation Pinault, qui possède le groupe rival Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga…).

5 juin 2018 — Frederic Legrand — COMEO — @Shutterstock
Le musée de la Fondation Vuitton, inauguré en 2014, a coûté près de 800 millions d’euros, a révélé Marianne en 2017, soit huit fois le coût initialement estimé. Mais surtout, « grâce aux avantages fiscaux et divers tours de passe-passe, LVMH a réussi à faire payer par l’État 80 % de ce montant, soit plus de 610 millions d’euros ». Des faits confirmés en 2018 par la Cour des comptes. Bernard Arnault, qui avait proclamé sa volonté de « faire un cadeau à la France » avec ce bâtiment, l’a donc fait payer à 80 % par les Français. LVMH avait mis à profit la loi Aillagon de 2003 sur le mécénat fiscal, qui permet aux entreprises de déduire 60 % des donations de leur impôt sur les sociétés. Cela signifie que pour une somme de 10 000 € dédiée au mécénat, une entreprise ne paiera, après déduction fiscale, que 4 000 €. À cette déduction se sont ajoutées quelques astuces annexes pour réduire encore la facture fiscale de LVMH.
Relativement récent en France, l’essor du mécénat des entreprises, « bénéficie de conditions fiscales particulièrement avantageuses, au risque de soulever de légitimes interrogations quand ces opérations servent de support à de gigantesques actions de communication », écrivait Jean-Michel Tobelem, spécialiste du mécénat et professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans les colonnes du Monde en 2014. Tout en bénéficiant d’arrangements fiscaux depuis sa création, la Fondation Louis Vuitton a rendu payantes les visites de son musée, malgré son caractère culturel relevant de l’intérêt général. Sur le site de la Fondation, l’entrée est à 16 euros le plein tarif (en hausse par rapport aux 14 euros de 2014). Un choix qui tranche même avec les grands mécènes américains, dont l’entrée aux musées est gratuite. Jean-Michel Tobelem note que la fondation Vuitton est une sorte d’émanation marketing de l’entreprise LVMH :
« C’est là le sens de la création de la fondation : forger une alliance imaginaire entre une multinationale gourmande de profits et des “actifs” capables d’apporter une précieuse valeur ajoutée à ses produits : Paris, le patrimoine, la culture et l’art de vivre à la française. »
Le groupe LVMH, qui « dispose de relais politiques et médiatiques sans équivalent en raison de l’énormité de ses dépenses publicitaires, tenait déjà à distance les discours critiques ». Avec la Fondation, un pas supplémentaire était franchi. Selon le professeur Tobelem, Bernard Arnault devenait alors « par la magie du mécénat, un protecteur admiré et désintéressé des arts et de la culture ». Or, constatait-il, « l’entreprise se situe dans une perspective d’optimisation fiscale et fait payer par l’ensemble des Français plus de la moitié du coût de la fondation ».
De même, la Fondation Cartier, admirée pour son soutien aux artistes, a reçu peu de critiques. Mais pour Tobelem, là aussi, la démarche relève d’abord d’un désir de marketing raffiné des produits du célèbre joaillier :
« L’instrumentalisation des artistes — les mêmes que l’on trouve dans tous les musées et centres d’art du monde — vise à lutter contre la banalisation de produits qui n’ont souvent d’artisanal que leur réputation. »
Quand le mécénat devient sponsoring
Les fondations françaises ont engagé 12 milliards d’euros en 2020. Elles détiennent 32 milliards d’euros d’actifs, d’après le think tank Terra Nova. Les cas précités nous permettent d’identifier deux problèmes. Premièrement, celui de la responsabilité sociale engagée lors du financement de domaines d’activité qui relèvent de l’intérêt général, comme la santé publique ou l’information. Deuxièmement, celui de la confusion entre les intérêts spécifiques de l’entreprise (marketing, optimisation fiscale) et le véritable engagement pour le bien commun. À l’occasion du rapport sur LVMH, puis dans un rapport de 2021, la Cour des comptes a souligné que la frontière devenait « de plus en plus floue entre mécénat et sponsoring ». Elle a mis en garde contre les risques de confusion entre intérêt général et intérêts privés. Les frontières sont en effet devenues ténues entre responsabilité sociale de l’entreprise (qui ne justifie pas de déduction fiscale), mécénat (qui justifie une déduction fiscale) et dépenses en vue du développement commercial.
Par ailleurs, on trouve les mêmes dirigeants aux manettes de la fondation et de l’entreprise fondatrice. Ce ne sont pas toujours des bénévoles. « Cette situation va à l’encontre du critère de la gestion désintéressée », note le rapport. À cet égard, l’une des faiblesses identifiées par Terra Nova est la tentation des fondations de se « construire une image moralement avantageuse du philanthrope ou de l’entreprise mécène, construction qui peut être jugée comme du social washing, de l’ethical washing ou du greenwashing ». Le think tank recommande principalement de favoriser une « gouvernance plurielle » des fondations, en intégrant plus systématiquement les bénéficiaires (directs, ou porteurs de projets financés par les fondations distributrices) dans les processus de sélection des projets, dans l’accompagnement, la mise en œuvre et l’évaluation.
Rendre des comptes : une impérieuse nécessité
Toutefois, une gouvernance plus inclusive ne suffit pas. La notion d’accountability (responsabilité, reddition de comptes) est encore plus centrale. Lorsque des institutions atteignent un poids et un impact comparables à celui de collectivités publiques, elles doivent être régulées comme telles. Washington et Bruxelles ont par exemple considéré que les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram), bien qu’ils soient des entreprises commerciales privées, avaient pris une telle importance dans la formation de l’opinion et du débat public, qu’ils devaient être régulés comme tels et coopérer avec les autorités dans la lutte contre la désinformation. Dans chaque pays, les autorités leur ont demandé de rendre des comptes pour les contenus qu’ils hébergent et les supervisent bien au-delà de ce que prévoit la loi pour des entités de droit privé.
Selon le même modèle, et de manière encore plus justifiée, il s’agit d’établir le constat que les fondations philanthropiques, bien que ce soient des entités privées, ont un impact social majeur qui ne permet plus d’ignorer leur activité ou la laisser évoluer dans l’opacité, et qui incite à les considérer comme des entités politiquement responsables. Reconnaître cette qualité revient à mettre en place la gouvernance adéquate. Les grandes fondations philanthropiques devraient rendre des comptes, audités de manière indépendante, dans les pays où elles opèrent le plus intensément, en divulguant des rapports transparents sur les bénéficiaires de leurs aides, sur les choix opérés, sur la nature des actions menées, sur la pertinence des buts et des missions poursuivis, sous l’angle de l’intérêt général, et sur leurs impacts, tant positifs que négatifs, sur l’ensemble des bénéficiaires et des parties prenantes concernées.
C’est à cette condition que les fondations de milliardaires seront adéquatement contrôlées par des contre-pouvoirs démocratiques, qui éviteront qu’une accumulation d’intérêts spécifiques ne phagocyte l’intérêt général, par démission de l’État. Les caisses des États sont peut-être vides, mais il leur reste un dernier pouvoir, celui de réguler. Sans se faire acheter.
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.