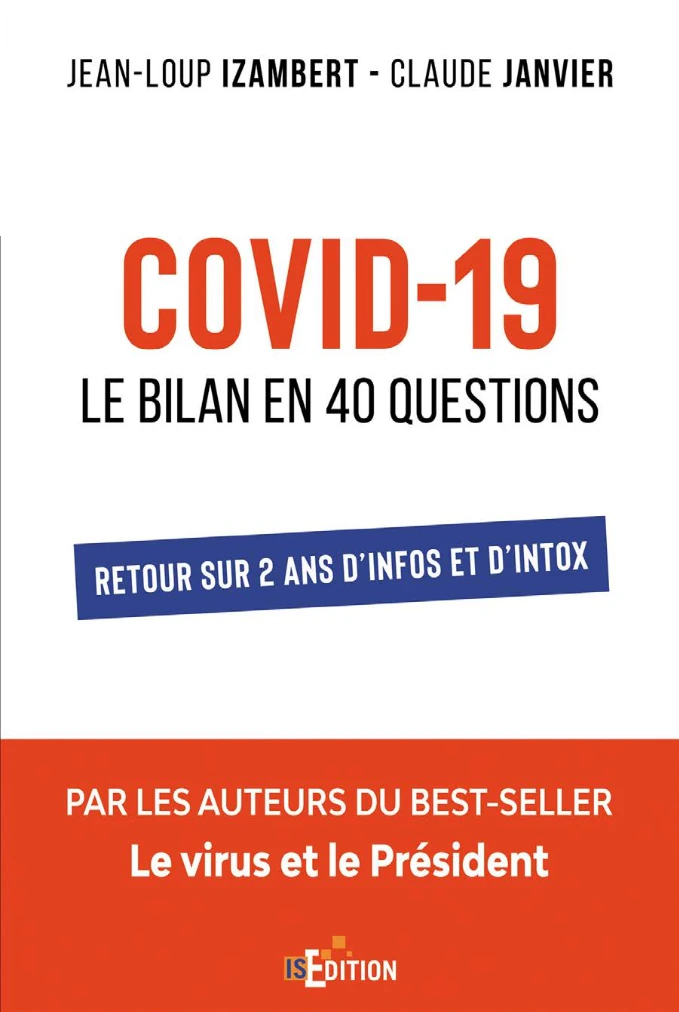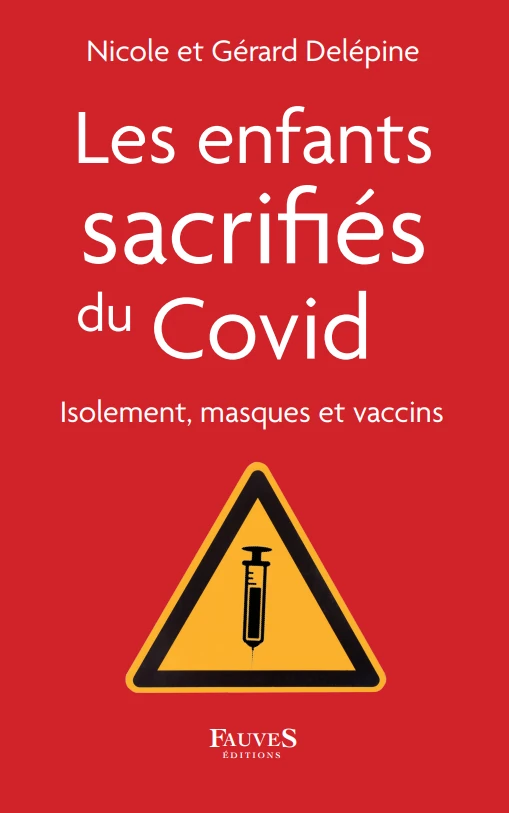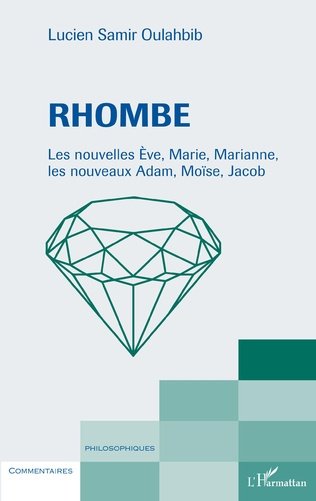22/09/2022 (2022-09-22)
[Source : aubedigitale.com]
L’un des principaux mythes du XXe siècle est le rôle bénin joué par les institutions internationales dirigées par les Américains après la Seconde Guerre mondiale. Les libéraux/progressistes américains, qui venaient d’imposer le New Deal dans les années 30 et de planifier et diriger une guerre mondiale, se sont tournés vers les affaires internationales : les États-Unis avaient une mission historique mondiale aux proportions messianiques — faire entrer les pays en développement dans la modernité en les refaisant (et tous les autres pays, d’ailleurs) à l’image de l’Amérique.
L’époque de la guerre froide a été marquée par de nombreux projets et organisations visant à concrétiser cette vision, de Bretton Woods et du Fonds monétaire international (FMI) dans le domaine de la finance internationale à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans le domaine militaire, en passant par le Congress for Cultural Freedom, financé par la CIA et utilisé pour diffuser une propagande progressiste et favorable aux États-Unis. Ces organisations ont toutes eu des influences principalement délétères — j’ai déjà indiqué comment Bretton Woods et le système financier international moderne peuvent être décrits comme de l’impérialisme financier — mais dans un domaine, l’interventionnisme américain est à ce jour universellement reconnu comme bénin : la révolution verte.
L’histoire officielle de la révolution écologique
La croissance démographique était considérée comme un problème majeur dans les années soixante. Paul Ehrlich, de l’université de Stanford, dans son ouvrage Population Bomb publié en 1968, prédisait une famine généralisée dès les années 70 et préconisait une action immédiate pour limiter la croissance démographique. Le monde ne pouvait tout simplement pas nourrir une population humaine plus nombreuse. Bien qu’il soit principalement axé sur les dommages environnementaux causés par l’utilisation de pesticides, le célèbre livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, publié en 1962, présente des arguments similaires. La population humaine est vouée à continuer de croître, ce qui entraînera des souffrances indicibles et des dommages environnementaux.
Dans les années 1960, l’Inde représentait un danger majeur et imminent : toujours au bord de la famine, seules les importations massives de blé américain tenaient le spectre de décès en masse à l’écart. Puis, en 1965, la catastrophe a frappé : la sécheresse qui a sévi dans la majeure partie du sous-continent a fait échouer la récolte indienne. La sécheresse se prolongeant les deux années suivantes, il semble que les prédictions d’Ehrlich et des autres néo-malthusiens se soient réalisées.
Puis, un miracle s’est produit : un homme est apparu, un véritable demi-dieu, à en juger par le culte qui lui est rendu par les normies [adeptes de Norman Borlaug] contemporains. Norman E. Borlaug, le père de la Révolution verte, menait depuis les années 40 des recherches et sélectionnait de nouvelles variétés de blé au Mexique, initialement financées par la Fondation Rockefeller et, après 1964, en tant que responsable du Centre international d’amélioration du maïs et du blé (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, initialement financé par les Fondations Rockefeller et Ford et le gouvernement mexicain).
Borlaug a créé des variétés de blé nain à haut rendement, largement adaptées à différents environnements écologiques. Depuis le début des années 60, il travaillait avec M.S. Swaminathan, de l’Institut indien de recherche agricole, et ensemble, ils ont planté les nouvelles variétés de blé nain de Borlaug dans le nord de l’Inde. Le succès fut immédiat : L’année 1968 a été marquée par une récolte exceptionnelle, les nouveaux rendements de blé étant les plus élevés jamais enregistrés en Inde.
Il semble que les prophètes de malheur en matière de population aient eu tort. C’est ce que dit Borlaug lui-même lorsqu’il reçoit le prix Nobel de la paix en 1970 : dans son discours d’acceptation, il proclame la victoire dans la guerre perpétuelle entre « deux forces opposées, le pouvoir scientifique de la production alimentaire et le pouvoir biologique de la reproduction humaine ». Mais la guerre n’est pas terminée, a-t-il averti, et seul un financement continu de la recherche technologique sur la production alimentaire et les limites de la reproduction peut éviter le désastre.
Les gouvernements et les philanthropes ont relevé le défi et les capitaux ont afflué dans la recherche agricole de type borlaugien, tandis que de nouveaux instituts internationaux étaient créés pour poursuivre le travail que Borlaug avait commencé au Mexique et en collaboration avec l’Institut international de recherche sur le riz aux Philippines (fondé en 1960). La révolution verte a éradiqué le fléau de la famine et, comme l’agriculture utilisant la technologie Borlaugian avait des rendements bien plus élevés, des masses de terres ont été libérées de l’usage agricole et rendues à la nature. Une étude publiée en 2021 dans le Journal of Political Economy estime que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans les pays en développement aurait été jusqu’à 50 % inférieur sans l’intervention de Borlaug, Swaminathan et des autres brahmanes internationaux prêts à guider les masses de paysans ignorants.
Ce récit de l’histoire de l’agriculture pose un double problème : il est fondé sur de mauvais principes économiques et son lien avec l’histoire réelle de l’agriculture indienne est, au mieux, tangentiel.
La mauvaise économie des révolutionnaires verts
La célébration de la révolution verte repose sur deux erreurs fondamentales du raisonnement économique : le malthusianisme et une mauvaise compréhension de l’économie agricole.
Le malthusianisme est la croyance erronée selon laquelle la population humaine augmentera plus vite que les réserves alimentaires ; selon la formulation de Thomas Malthus, la croissance de la population suit une progression géométrique (2, 4, 8, 16…) et les réserves alimentaires une progression arithmétique (2, 3, 4, 5…). Par conséquent, l’humanité est destinée, sauf pendant de brèves périodes, à vivre à la limite de la subsistance : seules les maladies, les guerres et les famines limiteront la croissance démographique.
Le problème du malthusianisme est qu’il est complètement faux, tant sur le plan théorique que sur le plan historique. Tout d’abord, la production alimentaire et la croissance démographique ne sont manifestement pas des variables indépendantes, puisque le travail humain est un facteur clé de la production alimentaire, comme l’a souligné Joseph A. Schumpeter. Plus fondamentalement, comme l’a expliqué Ludwig von Mises, la loi malthusienne de la population n’est qu’une loi biologique — elle est vraie pour toutes les espèces animales, mais les hommes ne sont pas de simples animaux. Avec l’usage de la raison, ils peuvent s’abstenir d’une activité procréatrice irréfléchie, et ils le feront s’ils doivent eux-mêmes supporter le résultat de cette activité. Malthus lui-même l’a bien vu et a modifié sa théorie dans la deuxième édition et les suivantes de son célèbre Essai sur le principe de population (Frédéric Bastiat, comme à son habitude, a une bien meilleure et plus optimiste explication du principe de population).
Les technophiles ne comprennent pas non plus l’économie de l’agriculture et de la production alimentaire. Ester Boserup, qui est une source d’inspiration essentielle pour la brève explication qui suit, a développé une compréhension correcte de cette question dans les années 1960, après avoir étudié l’agriculture indienne. L’ignorance de Borlaug et de sa compagnie, ainsi que de leurs supporters d’hier et d’aujourd’hui, est donc difficilement excusable : après tout, ce sont exactement les mêmes conditions historiques qu’ils considéraient comme « malthusiennes » qui ont inspiré Boserup à exposer la compréhension correcte de la question.
Lorsque la population augmente, l’offre de main-d’œuvre s’accroît, et davantage de main-d’œuvre est appliquée aux parcelles agricoles. Le rendement de la terre augmente donc, bien que le rendement de la main-d’œuvre supplémentaire diminue, conformément à la loi des rendements. Lorsque le rendement du travail supplémentaire est insuffisant pour le justifier, de nouvelles terres sont mises en culture, et une fois la terre défrichée, la productivité physique du travail augmente. Étant donné que le défrichage de nouvelles terres nécessite un certain effort supplémentaire, les agriculteurs doivent toujours mettre en balance le rendement potentiel des nouvelles terres et le rendement d’une culture plus intensive des terres déjà défrichées.
Nous pouvons le voir clairement en termes monétaires : plus la main-d’œuvre est appliquée au travail de la terre, plus les salaires baissent et plus les loyers fonciers augmentent. Comme les loyers et la valeur des terres augmentent, la valeur potentielle des terres non défrichées augmente, et comme les salaires diminuent, les dépenses nécessaires pour défricher les terres diminuent. Lorsque le rendement attendu des nouvelles terres est supérieur au coût estimé de leur mise en culture, la main-d’œuvre sera affectée au défrichage de nouvelles terres. La rente foncière diminue alors et les salaires augmentent jusqu’à ce que la mise en culture de nouvelles terres ne soit plus jugée rentable.
Ainsi, la population et la production alimentaire augmentent à l’unisson, parfois grâce à une culture plus intensive, parfois grâce à une augmentation de la surface cultivée. La même analyse s’applique dans des conditions plus capitalistes (c’est-à-dire lorsque les agriculteurs disposent de plus d’outils et d’autres biens d’équipement) : le rendement de l’utilisation de biens d’équipement supplémentaires sur les terres actuelles est comparé au rendement potentiel de l’utilisation de biens d’équipement pour accroître la superficie des terres cultivées. Même la forme la plus primitive de l’agriculture est, bien sûr, capitaliste, car l’agriculture est un processus de production détourné, dans lequel l’effort productif est largement séparé dans le temps de la production utile.
L’agriculture indienne des années 1960 fonctionnait bien, sauf lorsqu’elle était entravée par l’ingérence du gouvernement et les barrières institutionnelles. Ces ingérences peuvent être extrêmement destructrices, comme Mao Zedong l’avait montré en Chine quelques années auparavant, lors du Grand Bond en avant. Cependant, cet épisode n’avait rien de malthusien, pas plus que, comme nous le verrons, la prétendue famine en Inde dans les années 1960.
La famine indienne des années 1960 : Une mauvaise histoire
La famine des années 1960 en Inde a lancé la Révolution verte et la renommée internationale de son principal protagoniste, Norman Borlaug. Dès le départ, cependant, le récit a été faussé par des considérations politiques.
L’agriculture américaine a été fortement subventionnée dans les années 60, ce qui a entraîné un énorme excédent de production. Cet excédent ne pouvait être vendu au prix du marché, du moins pas sans mettre les agriculteurs américains en faillite. Selon la logique interventionniste typique, le gouvernement américain est intervenu pour subventionner l’exportation des produits agricoles américains afin de maintenir un prix artificiellement élevé sur le marché intérieur.
L’Inde a ainsi été inondée de blé américain bon marché au début des années 60, mais, comme l’écrit G.D. Stone, cela n’a pas atténué les pénuries alimentaires de l’Inde, mais les a provoquées. Dans un cas simple d’ajustement des agriculteurs à leur avantage comparatif, les Indiens ont réorienté leur production vers des cultures de rente (comme la canne à sucre et le jute) destinées à l’exportation et ont ainsi financé leurs importations de blé américain bon marché.
La sécheresse de 1965 et des années suivantes est bien réelle, mais son impact ne se limite pas à l’échec des cultures vivrières. Les cultures de jute et de canne à sucre ont souffert, entraînant de réelles difficultés pour les ouvriers agricoles. Mais ces difficultés ne se sont jamais traduites par une famine généralisée. En 1965, le président américain, Lyndon B. Johnson, tentait de faire approuver par le Congrès une nouvelle loi agricole prévoyant des subventions accrues pour les exportations agricoles et une aide étrangère sous la forme du plan « Food for Peace ». Les rapports sur la sécheresse en Inde sont une aubaine : face à un Congrès récalcitrant, Johnson joue le spectre de la sécheresse et de la famine massive. Sa législation est dûment adoptée et encore plus de céréales américaines sont expédiées en Inde, ce qui a sans aucun doute contribué à soulager certaines difficultés à court terme.
L’exagération de la situation catastrophique de l’Inde a naturellement aussi servi les intérêts de Borlaug et de sa société. Les variétés spéciales de blé sélectionnées au Mexique ont été largement introduites dans tout le nord de l’Inde, et comme la sécheresse a opportunément pris fin, la première récolte a donné un rendement massif. Borlaug s’en est attribué le mérite, sans se préoccuper de la coïncidence avec le fait que presque toutes les récoltes atteignaient des niveaux records en Inde et dans la Chine voisine. Le prétendu succès de la technocratie américaine a également joué dans le récit politique plus large du leadership progressiste américain sur le « monde libre » : en 1968, l’administrateur de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), William Gaud, s’est adressé à la Société pour le développement international à Washington, DC, affirmant que l’aide étrangère et les politiques agricoles judicieuses avaient favorisé « une nouvelle révolution ». Il ne s’agit pas d’une révolution rouge violente comme celle des Soviétiques, ni d’une révolution blanche comme celle du Shah d’Iran. Je l’appelle la Révolution verte ».
La révolution verte, menée par les technocrates du gouvernement et des ONG et financée principalement par les agences de développement occidentales, était lancée. La sélection de variétés hybrides de riz et de blé par l’Institut international de recherche sur le riz et le CIMMYT, respectivement, était le fleuron de la modernité en agriculture. Mais même dans ses propres termes, cette affirmation est au mieux trompeuse. Ce qui s’est passé, c’est que l’agriculture du monde développé et de l’Occident s’est orientée vers une culture très intensive qui nécessitait beaucoup de capitaux. Les variétés de blé de Borlaug en sont un bon exemple, comme le souligne Stone : ce n’est que lorsque de grandes quantités d’engrais ont été appliquées que ces variétés ont dépassé les grands blés indiens indigènes. Il s’avère que les technologies ne sont pas des forces exogènes qui s’imposent simplement et remodèlent l’environnement. Les populations locales avaient développé des cultures et des techniques adaptées à leur situation, et il est peu probable que le blé de Borlaug aurait été largement utilisé si le gouvernement indien (et les organismes d’aide étrangers) n’avait pas, au même moment, massivement subventionné l’utilisation d’engrais et la construction de nouveaux systèmes d’irrigation.
La réalité de la révolution verte
Une dernière ligne de défense pour les partisans des bienfaits de la révolution verte est qu’elle a permis une production alimentaire efficace, qu’elle a libéré la main-d’œuvre pour des travaux non agricoles et que nous pouvons maintenant continuer à utiliser les technologies génétiques modernes pour augmenter la qualité des aliments et éviter la malnutrition. Ainsi, par exemple, des personnes autrement sensées comme Bjorn Lomborg ont longtemps défendu l’introduction du « riz doré » – une variété de riz génétiquement modifiée pour être riche en vitamine A – comme solution à la malnutrition dans les pays producteurs de riz.
Mais les technocrates et leurs supporters oublient de mentionner ou ignorent le fait que la révolution verte a elle-même été une cause de malnutrition. Lorsque les rendements du blé ont augmenté en Inde selon Stone, par exemple, le prix relatif du blé a baissé, et le blé a ainsi supplanté d’autres sources alimentaires riches en protéines et en micronutriments. Les taux de malnutrition en Inde ont donc augmenté, conséquence directe de la révolution verte. Une évolution similaire s’est produite dans les pays développés, pour des raisons différentes mais analogues.
En ce qui concerne la technologie qui libère la main-d’œuvre, ce qui s’est réellement passé, c’est que le surinvestissement en capital dans l’agriculture a réduit la demande de main-d’œuvre agricole, mais cela n’a pas augmenté la demande de main-d’œuvre ailleurs. Au contraire, puisque moins de capital est disponible pour l’investissement dans les secteurs non agricoles, la demande de main-d’œuvre et de salaires n’a pas augmenté ailleurs. Ainsi, la révolution verte a largement contribué à la croissance des bidonvilles du tiers-monde, où les gens subsistent grâce à des emplois mal payés et à l’aide de l’État.
En somme, comme on doit s’y attendre lorsqu’on a affaire à des technocrates poussés par l’orgueil progressiste à intervenir dans le développement naturel de l’économie, la révolution verte n’a pas été une bénédiction, la victoire de sages scientifiques sur la propension de paysans stupides à se reproduire de manière incontrôlée. Au contraire, elle a été un désastre écologique, nutritionnel et social. [incluant la destruction des sols, leur empoisonnement par les pesticides, et la destruction des lacs à cause des engrais chimiques qui s’y retrouvent.]
Traduction du Mises Institute par Aube Digitale
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.