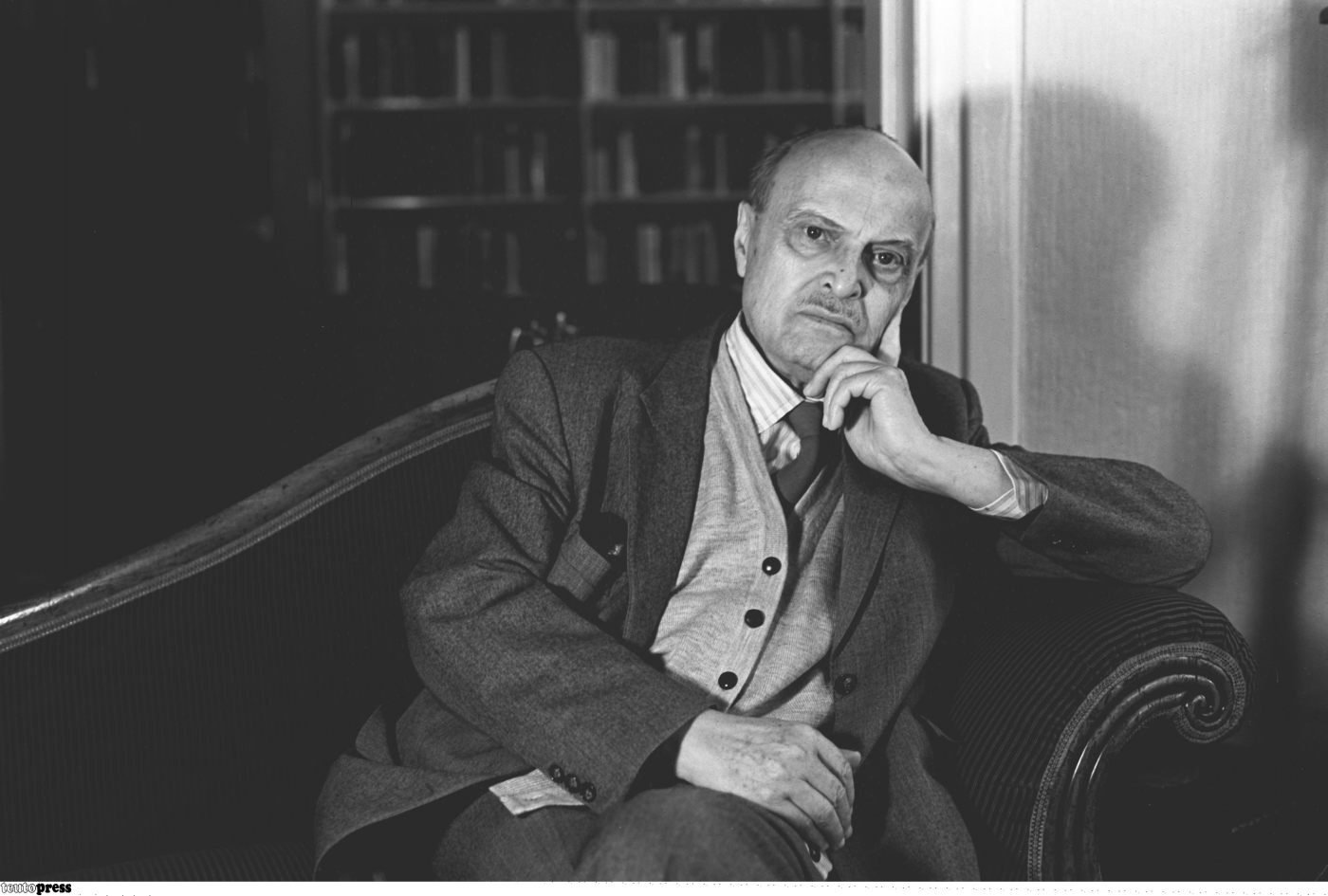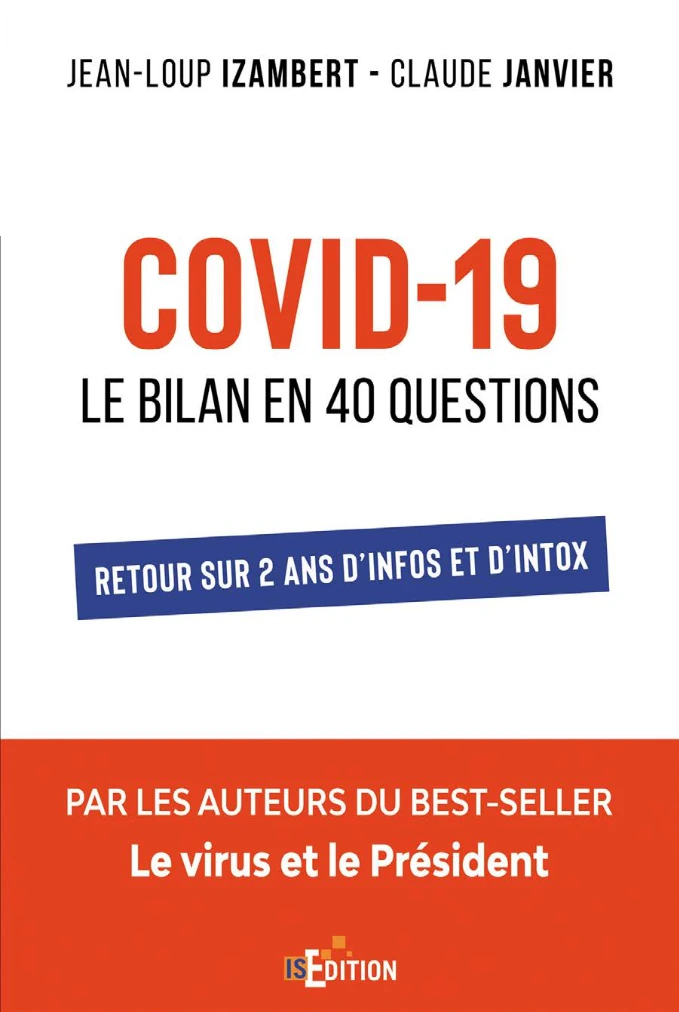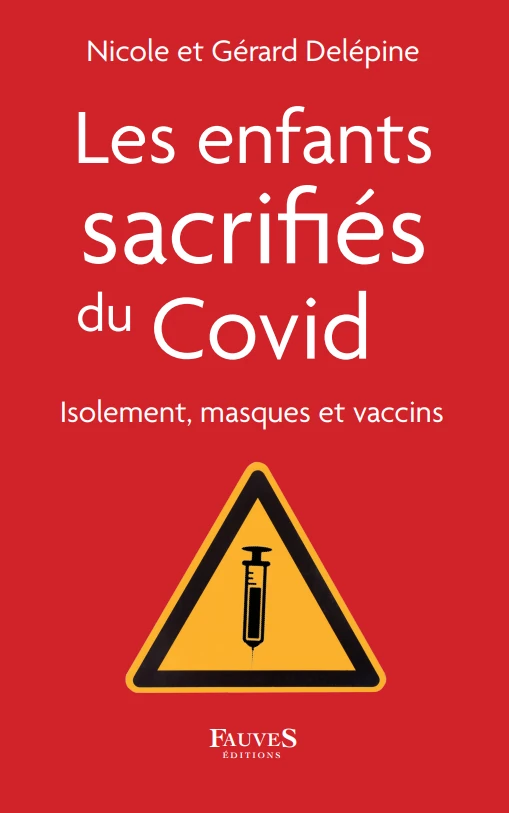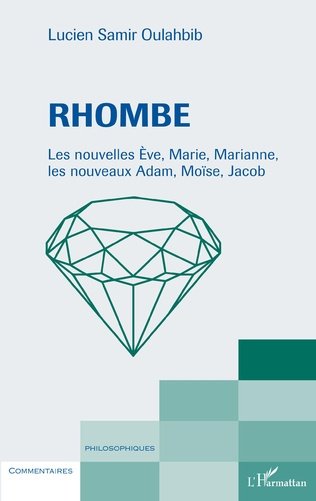28/07/2021 (2021-07-28)
[Source : Sott.net]
En passant… Et en lisant Sebastian Haffner – Allemagne, mars 1933
Source de la retranscription numérique
[Photo : Sebastian Haffner en 1984]
Voici un extrait « éclairant » du chapitre « La révolution », extrait de l’ouvrage de Sebastian Haffner, Histoire d’un Allemand — Souvenirs (1914-1933), paru aux Éditions Babel.
Qu’est-ce qu’une révolution ?
Les spécialistes du droit public répondent : la modification d’une constitution par d’autres moyens que ceux qu’elle prévoit. Si l’on souscrit à cette sèche définition, la « révolution » nazie de mars 1933 n’en était pas une. Car tout se passa dans la stricte légalité, avec les moyens prévus par la constitution : d’abord des « décrets-lois » du président et enfin une résolution qui transférait au gouvernement la totalité du pouvoir législatif, résolution votée par le Parlement à la majorité des deux tiers exigée pour les changements constitutionnels.
C’est là une imposture manifeste. Mais quand on voit les choses comme elles ont vraiment été, on peut encore se demander si ce qui s’est joué en mars mérite vraiment le nom de révolution. Pour le sens commun, l’essentiel d’une révolution semble résider dans le fait que des gens attaquent par la violence l’ordre existant et ses représentants : police, armée, etc., et l’emportent sur lui. Ce n’est pas toujours forcément magnifique et enthousiasmant, et cela peut fort bien être associé à des débordements, des violences, des brutalités de populace déchaînée ; on peut piller, tuer, brûler. Ce qu’on attend des gens qui se prétendent des révolutionnaires, c’est au moins qu’ils attaquent, fassent preuve de courage, mettent leur vie en jeu. Les barricades sont peut-être un peu démodées, mais une forme quelconque de spontanéité — insurrection, prise de risque, émeute — semble inhérente à l’essence de la révolution.
Rien de tel en mars 1933. Les événements étaient une décoction des ingrédients les plus bizarres, mais on aurait vainement attendu un acte de courage, de bravoure, d’audace de quelque côté que ce fût. Ce mois de mars produisit quatre choses qui auraient pour résultat final la domination incontestée des nazis : la terreur, des fêtes et des déclamations, la trahison, et pour finir un collapsus collectif — plusieurs millions d’individus s’effondrant simultanément. Beaucoup d’États européens, la plupart même, ont eu une naissance plus sanglante. Mais il n’en existe aucun dont la naissance eût été à ce point répugnante.
L’histoire européenne connaît deux formes de terreur : l’une est l’ivresse sanguinaire effrénée d’une masse révolutionnaire déchaînée, grisée par sa victoire ; l’autre est la cruauté froide, délibérée, d’un appareil étatique triomphant qui cherche à intimider, à manifester son pouvoir. Ces deux formes sont normalement réparties entre révolution et répression. La première est révolutionnaire ; elle s’excuse par l’émotion et la rage du moment, par l’emportement. La deuxième est répressive ; elle s’excuse par les représailles à l’encontre des atrocités de la révolution.
Les nazis ont eu le privilège de combiner les deux d’une façon qui n’admet aucune excuse. La terreur de 1933 fut bien exercée par une tourbe ivre de sang (à savoir les SA, les SS ne jouant pas encore le rôle qui serait le leur), mais les SA se présentaient comme une « police auxiliaire » ; ils agissaient sans la moindre émotion, sans la moindre spontanéité, et surtout sans prendre le moindre risque — mais bel et bien en toute sécurité, sur ordre et avec discipline. Le tableau externe était celui de la terreur révolutionnaire : populace hirsute pénétrant par effraction la nuit dans les maisons et traînant des gens sans défense dans une cave pour les torturer. Le processus interne était celui de la terreur répressive : gestion administrative froidement calculée, couverture policière et militaire totale. L’ensemble ne découlait pas de cette excitation qui suit la victoire, un grand danger auquel on a survécu — rien de tel ne s’était produit. Ce n’étaient pas non plus des représailles à l’encontre d’atrocités exercées par le parti adverse — il n’y en avait eu aucune. Ce qui se produisait, c’était l’inversion cauchemardesque des notions normales : brigands et assassins dans le rôle de la police, revêtus du pouvoir souverain ; leurs victimes traitées comme des criminels, proscrites, condamnées d’avance à mort. Un cas exemplaire, rendu public en raison des proportions prises : une nuit, un responsable syndical social-démocrate de Köpenick1 se défendit, aidé de ses fils, contre une patrouille de SA qui avait pénétré chez lui et abattit, en état de légitime défense évidente, deux SA. Sur quoi, cette même nuit, ses fils et lui furent maîtrisés par une seconde patrouille plus nombreuse et pendus dans la remise de leur maison. Mais le jour suivant, en bon ordre, des SA en service commandé pénétrèrent chez tous les habitants de Köpenick connus pour être des sociaux-démocrates et les abattirent sur place. On n’a jamais su le nombre de morts.
Cette sorte de terreur avait un avantage : selon les cas, on pouvait hausser des épaules navrées en parlant des « inévitables conséquences fâcheuses de toute révolution » — c’était l’excuse de la terreur révolutionnaire — ou se référer à la rigueur de la discipline en démontrant que l’ordre et le calme régnaient, que seules avaient lieu les descentes de police indispensables, et que c’était précisément cela qui épargnait à l’Allemagne les troubles révolutionnaires — c’était l’excuse de la terreur répressive. Et les deux étaient effectivement invoquées à tour de rôle, suivant le public concerné.
Cette forme de publicité a contribué, et contribue toujours, à rendre la terreur nazie plus repoussante qu’aucune autre terreur connue dans l’histoire européenne. La cruauté elle-même peut avoir une ombre de grandeur quand elle s’affiche avec la grandiloquence d’une détermination suprême, quand ceux qui l’exercent revendiquent fougueusement leurs actes comme ce fut le cas lors de la Révolution française et des guerres civiles russe et espagnole. Les nazis, en revanche, n’ont jamais affiché autre chose que le rictus blême, lâche et craintif du meurtrier niant ses crimes. Tandis qu’ils torturaient et assassinaient systématiquement des êtres sans défense, ils affirmaient tous les jours avec des accents nobles et touchants qu’ils ne faisaient de mal à personne, et que jamais révolution ne s’était déroulée de façon aussi humaine et pacifique. Et quelques semaines après l’institution de l’épouvante, une loi menaçait d’une lourde peine quiconque affirmait, fût-ce entre ses quatre murs, qu’il se passait des choses atroces.
Il va de soi que cela n’avait pas pour but de tenir secrètes les horreurs. Car alors elles n’auraient pu atteindre leur but, qui était de provoquer chez tous crainte, effroi, soumission. Ce secret tendait au contraire à renforcer l’effet de la terreur par le danger qu’il y avait ne serait-ce qu’à en parler. L’exposition publique — par exemple à la tribune de l’orateur ou dans les journaux — de ce qui se passait dans les caves de la SA et dans les camps de concentration aurait peut-être pu provoquer même en Allemagne une riposte désespérée. Les nouvelles épouvantables chuchotées sous le manteau — « Faites bien attention, voisin ! Savez-vous ce qui est arrivé à X ? » — brisaient bien plus sûrement toutes les résistances.
D’autant plus qu’on était au même instant occupé et distrait par une série interminable de fêtes, de solennités, de célébrations nationales. On commença par fêter la victoire en grand avant les élections, le 4 mars, jour du « Réveil national ». Marches gigantesques et feux d’artifice, tambours, trompettes, orchestres et drapeaux dans toute l’Allemagne, des milliers de haut-parleurs diffusant la voix de Hitler, serments et promesses — et tout cela alors qu’il n’était pas certain que les nazis n’allaient pas prendre une veste électorale. De fait, c’est bien ce qui se produisit ces élections, les dernières à se dérouler en Allemagne, n’apportèrent aux nazis que quarante-quatre pour cent des voix (auparavant ils en avaient obtenu trente-sept) — la majorité votait toujours contre eux. Si l’on songe que la terreur battait déjà son plein, que les partis de gauche avaient été muselés dès la semaine décisive qui précédait le scrutin, il faut dire que le peuple allemand dans son ensemble s’est assez bien comporté. Mais les nazis n’en eurent cure. La défaite fut tout simplement célébrée comme une victoire, la terreur renforcée, les fêtes se multiplièrent. Quinze jours durant, les fenêtres restèrent pavoisées. Une semaine plus tard, Hindenburg abolissait les anciennes couleurs, et le drapeau à la croix gammée devenait, avec le noir-blanc-rouge, le « pavillon provisoire du Reich ». Et chaque jour des défilés, des célébrations géantes, des manifestations de gratitude pour la libération nationale, de la musique militaire du matin au soir, honneurs rendus aux héros, consécration des couleurs, enfin, pour couronner le tout, la mise en scène boursouflée de la « journée de Potsdam », avec ce vieux félon de Hindenburg se recueillant sur la tombe de Frédéric le Grand, Hitler jurant pour la énième fois fidélité à je ne sais quoi, cloches sonnant à toute volée, cortège solennel des députés vers l’église, parade militaire, sabres au clair, enfants agitant des petits drapeaux, retraites aux flambeaux.
L’ineptie, l’absurdité sans bornes de ces manifestations continuelles étaient, selon toute vraisemblance, parfaitement concertées. Il fallait habituer la population à se réjouir et à se « réveiller », même si elle n’en voyait pas vraiment la raison. Chaque jour, chaque nuit, des gens qui s’abstenaient trop ostensiblement de participer — chut ! — étaient torturés à mort à coups de drille ou de fouet d’acier, et c’était déjà une raison suffisante. Réjouissons-nous donc, et hurlons avec les loups, Heil, Heil ! Et on finissait par y trouver goût. En mars 1933, il faisait un temps magnifique. N’était-ce pas beau, sous le soleil printanier, de se mêler à une foule en liesse sur une place pavoisée, prêtant l’oreille. à des propos sublimes où revenaient les mots de patrie et de liberté, de réveil et d’engagement sacré ? (En tout cas, cela valait mieux que de se retrouver à huis clos dans une caserne de SA, à se faire remplir d’eau les intestins).
On se mit à participer — d’abord par crainte. Puis, s’étant mis à participer, on ne voulut plus que cela fût par crainte, motivation vile et méprisable. Si bien qu’on adopta après coup l’état d’esprit convenable. C’est là le schéma mental de la victoire de la révolution national-socialiste.
Pour la parachever, toutefois, une chose était indispensable : la lâche trahison de tous les chefs de partis et d’organisations auxquels s’étaient confiés les cinquante-six pour cent d’Allemands qui, le 5 mars 1933, avaient voté contre les nazis. Le monde n’a pratiquement pas pris conscience de cette évolution historique terrible et décisive. Les nazis n’avaient pas intérêt à la souligner, parce qu’elle ne pouvait que dévaluer considérablement leur « victoire » ; quant aux traîtres eux-mêmes, ils avaient tout intérêt à se taire. Pourtant, seule cette trahison explique le fait apparemment inexplicable qu’un grand peuple, qui ne se compose quand même pas exclusivement de poltrons, ait pu sombrer dans l’infamie sans résistance.
La trahison fut totale, générale et sans exception, de la gauche à la droite. J’ai déjà dit que les communistes, derrière les rodomontades de façade qui exaltaient leur « détermination » et mentionnaient des préparatifs de guerre civile, préparaient en vérité l’exil de leurs hauts fonctionnaires avant qu’il ne fût trop tard.
En ce qui concerne les cadres de la social-démocratie, à qui des millions de braves petites gens fidèles accordaient une confiance aveugle et loyale, ils avaient commencé de les trahir dès le 20 juillet 1932, quand Severing et Grzesinski s’étaient « inclinés devant la force ». Les sociaux-démocrates s’étaient déjà terriblement humiliés au cours de la campagne électorale de 1933 en courant après les slogans des nazis pour souligner qu’ils étaient, eux aussi, de bons « nationaux ». Le 4 mars, veille du scrutin, Otto Braun,2 leur « homme fort », chef du gouvernement prussien, passa en automobile la frontière suisse ; il avait pris soin d’acquérir une maisonnette dans le Tessin. En mai, un mois avant la dissolution de leur parti, les députés sociaux-démocrates en étaient à accorder massivement leur confiance au gouvernement Hitler et à chanter le Horst-Wessel-Lied.3 (Le compte rendu des débats parlementaires note : « Applaudissements sans fin dans la salle et sur les tribunes. Le chancelier lui-même, tourné vers les sociaux-démocrates, applaudit »).
Le centre, ce grand parti bourgeois catholique qui, dans les dernières années, avait rallié une part de plus en plus importante de la bourgeoisie protestante, avait atteint ce stade dès le mois de mars. Ses voix assurèrent à Hitler la majorité des deux tiers qui lui confiait « légalement » la dictature. Il agissait sous la houlette de l’ancien chancelier Brüning. L’étranger l’a généralement oublié aujourd’hui, et Brüning y passe encore largement pour le possible successeur de Hitler. Mais qu’on me fasse confiance : les Allemands, eux, ne l’ont pas oublié. Un homme qui croyait encore, le 23 mars 1933, pouvoir inféoder à Hitler : dans un vote d’importance vitale, le parti qui lui était confié, n’aura plus jamais la moindre chance en Allemagne.
Enfin, le parti national, la droite conservatrice qui revendiquait carrément « l’honneur et l’héroïsme » comme programme — Dieu ! qu’il était lâche et déshonorant, le spectacle que ses chefs infligèrent à leurs partisans en 1933 et par la suite ! Une fois déçue leur attente du 30 janvier, alors qu’ils espéraient avoir « mis les nazis dans leur poche » pour les « empêcher de nuire », on attendait au moins qu’ils « freinent » pour « éviter le pire ». Que non ; ils participèrent à tout : à la terreur, aux pogromes, aux persécutions contre les chrétiens ; ils ne se laissèrent même pas émouvoir par l’interdiction de leur parti et l’arrestation de leurs partisans. Il est déjà navrant de voir des fonctionnaires socialistes s’enfuir en plantant là leurs électeurs et leurs sympathisants. Mais que dire d’officiers nobles qui, voyant fusiller leurs amis et leurs collaborateurs les plus proches — comme M. von Papen —, restent en place en criant Heil Hitler ? Tels partis, telles fédérations. Il existait une Fédération des anciens combattants communistes, et, en ce qui concernait le Parti démocratique allemand, une Reichsbanner schwarz-rot-gold, organisée militairement, non dépourvue d’armes, comptant des millions d’adhérents destinés expressément à tenir les SA en échec si le besoin s’en faisait sentir. Durant tout ce temps, on ne perçut rien de son existence, absolument rien, pas la moindre chose. Elle disparut sans laisser de trace, comme si elle n’avait jamais existé. Dans toute l’Allemagne, la résistance prenait tout au plus la forme d’un acte individuel désespéré — comme celui du syndicaliste de Köpenick. Les officiers de la Reichsbanner ne firent même pas mine de riposter quand les SA « reprirent » leurs locaux. Le Stahlhelm, l’armée des nationalistes, se laissa mettre au pas, puis dissoudre peu à peu, en récriminant, mais sans résister. Il n’y eut pas un seul exemple d’énergie défensive, de vaillance, de tenue. Il n’y eut que panique, fuite éperdue, apostasie. En mars 1933, des millions de personnes étaient encore prêtes au combat. Du jour au lendemain, elles se retrouvèrent sans chefs, sans armes, trahies. Une partie d’entre elles cherchèrent encore désespérément à rallier le Stahlhelm et les nationalistes quand il s’avéra que les autres ne se battaient pas. Le nombre de leurs adhérents enfla démesurément en l’espace de quelques semaines. Puis ils furent dissous eux aussi — et se rendirent sans combat.
Cette terrible capitulation morale des chefs de l’opposition est un trait fondamental de la « révolution » de mars 1933. Grâce à elle, les nazis eurent le triomphe facile. Il est vrai qu’en même temps elle remet en cause la valeur et la solidité de leur victoire. La croix gammée n’a pas été imprimée dans la masse allemande comme dans une matière récalcitrante, mais ferme et compacte. Elle l’a été comme dans une substance amorphe, élastique et pâteuse. Le jour venu, cette pâte est susceptible de prendre une autre forme, avec autant de facilité et sans plus de résistance. Il est vrai que depuis mars 1933 subsiste une question sans réponse : vaut-elle vraiment la peine d’être formée ? Car l’Allemagne a manifesté alors une faiblesse morale trop monstrueuse pour que l’histoire n’en tire pas un jour les conséquences.
Ailleurs, toute révolution, même si elle a laissé le peuple momentanément exsangue et affaibli, a toujours amené une remarquable potentialisation des énergies dans les deux camps en présence — aboutissant, à long terme, à l’émergence d’une nation considérablement plus forte. Qu’on considère la formidable quantité d’héroïsme, d’intrépidité, de grandeur humaine — mêlée sans doute à des débordements, des cruautés, des violences — qu’ont déployée dans la France révolutionnaire jacobins et royalistes, dans l’Espagne contemporaine franquistes et républicains ! Quelle que soit l’issue, la bravoure avec laquelle on a combattu demeure dans la conscience de la nation comme une inépuisable source d’énergie. À l’endroit où cette source devrait jaillir, les Allemands d’aujourd’hui n’ont que le souvenir de l’infamie, de la lâcheté, de la faiblesse. Cela ne peut manquer d’avoir des conséquences qui se manifesteront un jour, peut-être dans la dissolution de la nation allemande et de sa forme politique.
Le Troisième Reich est né de cette trahison de ses adversaires et du sentiment de désarroi, de faiblesse et de dégoût qu’elle a suscité. Le 5 mars, les nazis étaient encore minoritaires. Si de nouvelles élections avaient eu lieu trois semaines plus tard, ils auraient vraisemblablement eu la majorité. Ce n’était pas seulement l’effet de la terreur, ni de l’ivresse engendrée par les fêtes (les Allemands aiment à s’enivrer de fêtes patriotiques). L’élément décisif, c’est que la colère et le dégoût provoqués par la lâcheté et la traîtrise des chefs de l’opposition l’emportaient momentanément sur la colère et la haine à l’encontre du véritable ennemi. Dans le courant du mois de mars 1933, d’anciens opposants au parti nazi s’y rallièrent par centaines de milliers — les « victimes de mars », suspectées et méprisées par les nazis eux-mêmes. Surtout, pour la première fois, même des centaines de milliers d’ouvriers quittèrent leurs organisations sociales-démocrates ou communistes pour s’inscrire clans les « cellules » nazies ou s’enrôler dans la SA. Ils y étaient poussés par diverses raisons, et souvent plusieurs à la fois. Mais on aurait beau chercher longtemps, on n’en trouverait pas une seule dans le lot qui soit bonne, valable, inattaquable et positive — pas une seule de présentable. Le phénomène manifestait dans chaque cas particulier tous les symptômes d’une dépression brutale.
La raison la plus simple, qui s’avérait presque toujours, quand on creusait, la plus intime, c’était la peur. Frapper avec les bourreaux, pour ne pas être frappé. Ensuite, une ivresse mal définie, ivresse de l’unité, magnétisme de la masse. Puis, chez beaucoup, dégoût et ressentiment envers ceux qui les avaient laissés tomber. Puis un syllogisme étrange, typiquement allemand, qui déduisait : « Les adversaires des nazis se sont trompés dans toutes leurs prévisions. Ils ont affirmé que les nazis allaient perdre. Or, les nazis ont gagné. Donc, leurs adversaires avaient tort. Donc, les nazis ont raison. » Puis, chez quelques-uns (en particulier chez les intellectuels), la conviction de pouvoir encore changer le visage du parti nazi et l’infléchir dans leur direction en y adhérant eux-mêmes. Ensuite, bien entendu, la soumission pure et simple, l’opportunisme. Enfin, chez les plus primitifs, les plus frustes, dominés par l’instinct grégaire, un phénomène tel qu’il a pu s’en produire dans les temps mythologiques, quand une tribu vaincue abjurait son dieu tutélaire manifestement infidèle pour se mettre sous la protection du dieu de la tribu victorieuse. On avait cru en saint Marx, il n’avait pas secouru ses fidèles. Saint Hitler était manifestement plus puissant. Brisons donc les statues de saint Marx placées sur les autels pour consacrer ceux-ci à saint Hitler. Apprenons à prier : « C’est la faute aux juifs », au lieu de : « C’est la faute au capitalisme. » Peut-être est-ce là notre salut.
Comme on le voit, ce phénomène n’a rien que d’assez naturel ; il relève tout à fait du fonctionnement psychologique normal, et cela explique presque parfaitement ce qui semble inexplicable. La seule chose qui subsiste, c’est l’absence totale de ce qu’on nomme, chez un peuple comme chez un individu, de la « race » : à savoir un noyau dur, que les pressions et les tiraillements extérieurs ne parviennent pas à ébranler, une forme de noble fermeté, une réserve de fierté, de force d’âme, d’assurance, de dignité, cachée au plus intime de l’être et que l’on ne peut, précisément, mobiliser qu’à l’heure de l’épreuve. Cela, les Allemands ne le possèdent pas. Ils forment une nation inconstante, molle, dépourvue de squelette. Le mois de mars 1933 en a fourni la preuve. À l’instant du défi, quand les peuples de race se lèvent spontanément comme un seul homme, les Allemands, comme un seul homme, se sont effondrés ; ils ont molli, cédé, capitulé — bref : ils ont sombré par millions dans la dépression.
Le résultat de cette dépression généralisée fut le peuple uni, prêt à tout, qui est aujourd’hui le cauchemar du monde entier.
Tel est le processus évident, clair et bien délimité qui se présente aujourd’hui, avec le recul, à l’observateur. Tandis qu’il se déroulait, il m’était bien sûr impossible de le voir dans son ensemble. Je sentais bien, et c’était assez terrible, que tout cela était écœurant jusqu’à la nausée, mais j’étais incapable d’en saisir et d’en classer les éléments. Chaque fois qu’on essayait de comprendre, on voyait s’interposer comme un voile ces discussions infiniment oiseuses et stériles, toujours recommencées, au cours desquelles on s’efforçait de faire entrer les choses dans un système de notions politiques obsolètes qui ne leur était plus adapté. Comme ces discussions paraissent inconsistantes aujourd’hui, quand un caprice de la mémoire en fait remonter à la surface des bribes et des lambeaux ! Avec toute notre culture historique bourgeoise, nous étions intellectuellement démunis devant cette évolution qui ne s’était jamais produite dans tout ce que nous avions appris. Les explications étaient absurdes, les tentatives de justification parfaitement stupides — mais les constructions de fortune que la raison tentait d’édifier autour de ce sentiment d’effroi et de dégoût qui ne trompait pas étaient aussi désespérément superficielles. Tous les -ismes qu’on mobilisait étaient d’une inanité qui me fait frissonner quand j’y pense.
En outre, la vie quotidienne était un obstacle à l’analyse lucide — la vie qui continuait, encore que définitivement irréelle et spectrale, chaque jour tournée en dérision par les événements dans lesquels elle s’inscrivait. J’allais encore au tribunal, comme avant ; on y disait toujours le droit, comme si ce mot signifiait encore quelque chose, et le conseiller juif qui faisait partie de ma chambre siégeait toujours tranquillement en toge derrière la barre. Il est vrai que ses collègues le traitaient déjà avec cette délicatesse pleine de doigté qu’on témoigne aux grands malades. Je continuais d’appeler au téléphone mon amie Charlie, nous allions au cinéma, buvions du chianti dans un bistrot à vin, allions danser quelque part. Je continuais à voir des amis, à discuter avec des camarades, à fêter des anniversaires en famille — mais alors qu’en février on pouvait encore se demander si tout cela ne signifiait pas le triomphe de la vraie vie, de la réalité indestructible sur les agissements des nazis, on devait désormais admettre que ce n’était plus, au contraire, qu’un mécanisme automatique et creux qui démontrait à chaque instant le triomphe des puissances ennemies qui le submergeaient de toute part.
Et pourtant, curieusement, c’était entre autres choses la poursuite machinale de la vie quotidienne qui s’opposait à une quelconque réaction énergique et vitale contre la monstruosité. J’ai déjà dit comment la trahison et la lâcheté de leurs chefs avaient empêché les équipes des autres groupes politiques de se mobiliser contre les nazis. Cela n’explique pas pourquoi il n’y eut pas, ici, là ou ailleurs, un individu pour se dresser et se défendre spontanément, sinon contre l’ensemble, du moins contre quelque injustice particulière, quelque scandale survenu non loin de lui. (Je n’ignore pas que cette question inclut un reproche à l’égard de moi-même).
À cela s’opposait précisément le mécanisme de la vie courante. Il est probable que les révolutions, et l’histoire dans son ensemble, se dérouleraient bien différemment si les hommes étaient aujourd’hui encore ce qu’ils étaient peut-être dans l’antique cité d’Athènes : des êtres autonomes avec une relation à l’ensemble, au lieu d’être livrés pieds et poings liés à leur profession et à leur emploi du temps, dépendant d’une foule de choses qui les dépassent, éléments d’un mécanisme qu’ils ne contrôlent pas, marchant pour ainsi dire sur des rails et désemparés quand ils déraillent. La sécurité, la durée ne se trouvent que dans la routine quotidienne. A côté, c’est tout de suite la jungle. Tout Européen du XXe siècle le ressent confusément avec angoisse. C’est pourquoi il hésite à entreprendre quoi que ce soit qui pourrait le faire dérailler — une action hardie, inhabituelle, dont lui seul aurait pris l’initiative. D’où la possibilité de ces immenses catastrophes affectant la civilisation, telle que la domination nazie en Allemagne.
Certes, j’écumais de rage en ce mois de mars 1933. Certes, je faisais peur à ma famille avec des projets désordonnés : quitter la fonction publique, m’exiler, me convertir avec ostentation au judaïsme. Mais je me contentais de formuler ces intentions. Mon père, riche de l’expérience, point adaptée aux nouveaux événements, d’une vie qui s’était déroulée entre 1870 et 1933, minimisait, dédramatisait, tentait de contrer mes propos emphatiques par une discrète ironie. Il faut dire que j’étais habitué à son autorité, et pas encore très sûr de moi. En outre, le scepticisme tranquille m’a toujours convaincu davantage qu’une grandiloquence péremptoire ; j’ai mis longtemps à comprendre que dans ce cas particulier mon instinct de jeune homme avait effectivement raison contre la sagesse et l’expérience de mon père, et qu’il existe des choses que le scepticisme tranquille est impuissant à maîtriser. À l’époque, j’étais encore trop timide pour tirer les conséquences de mes intuitions.
Peut-être, n’est-ce pas, avais-je effectivement une vision déformée de la situation. Peut-être fallait-il l’endurer, laisser passer les choses. C’est seulement dans mon travail, protégé par les articles du Code civil et du Code de procédure civile, que je me sentais sûr de moi et mûr. Ces articles étaient toujours debout. Le palais de justice aussi. Son activité pouvait pour l’heure paraître vide de sens, mais elle ne s’était en rien modifiée. Peut-être qu’en fin de compte tout cela finirait par s’avérer durable et l’emporterait.
Donc, accomplir la routine quotidienne dans une expectative incertaine. Ravaler sa rage et son effroi ou les épancher à la table familiale en éclats stériles du plus haut comique. Vivant dans la même apathie que des millions d’autres individus, je laissais venir les choses.
Elles vinrent.
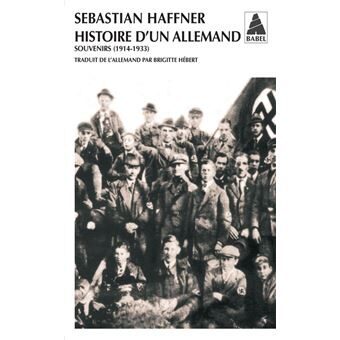
Voir aussi notre [de Sott.net] article « Histoire d’un Allemand — Souvenirs (1914-1933) », de Sebastian Haffner ou quand l’histoire se répète… à l’échelle mondiale
[Voir aussi :
►De la démocratie à la tyrannie
►La bureaucratie contre la liberté
►Fabrice Di Vizio: « Un gouvernement qui utilise un pouvoir arbitraire et absolu, ça s’appelle une tyrannie »
►Surveillance, numérisation et traçage permanent
►Le vrai fascisme : nous y sommes en plein dedans !
►Société libre ?
►De la servitude moderne
►Pass politico-sanitaire obligé : sommes-nous/glissons-nous en dictature ou pas du tout ?…
►Le Forum Économique mondial de Davos promeut un contrôle total de l’information mondiale par les Big Tech
►Le « Great Reset » n’est pas du complotisme
►En France, les libertés associatives de plus en plus entravées]
Notes
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.
- [1] Faubourg de Berlin.[↩]
- [2] Otto Braun (1872-1955), social-démocrate, à la tête du parti depuis 1911, ministre-président de Prusse entre 1925 et 1933.[↩]
- [3] Chant de marche de la SA écrit sur une mélodie existante par le jeune Sturmführer (lieutenant) Horst Wessel (1907-1930). Celui-ci ayant trouvé la mort au cours d’une bagarre avec des communistes dans des circonstances mal élucidées, les nazis firent de lui un martyr et de son œuvre l’hymne officiel du parti.[↩]