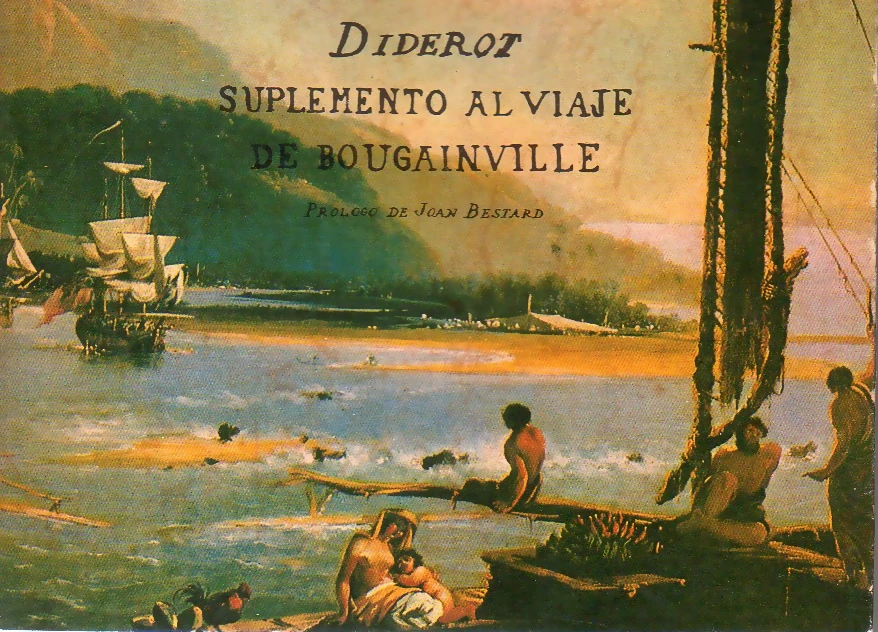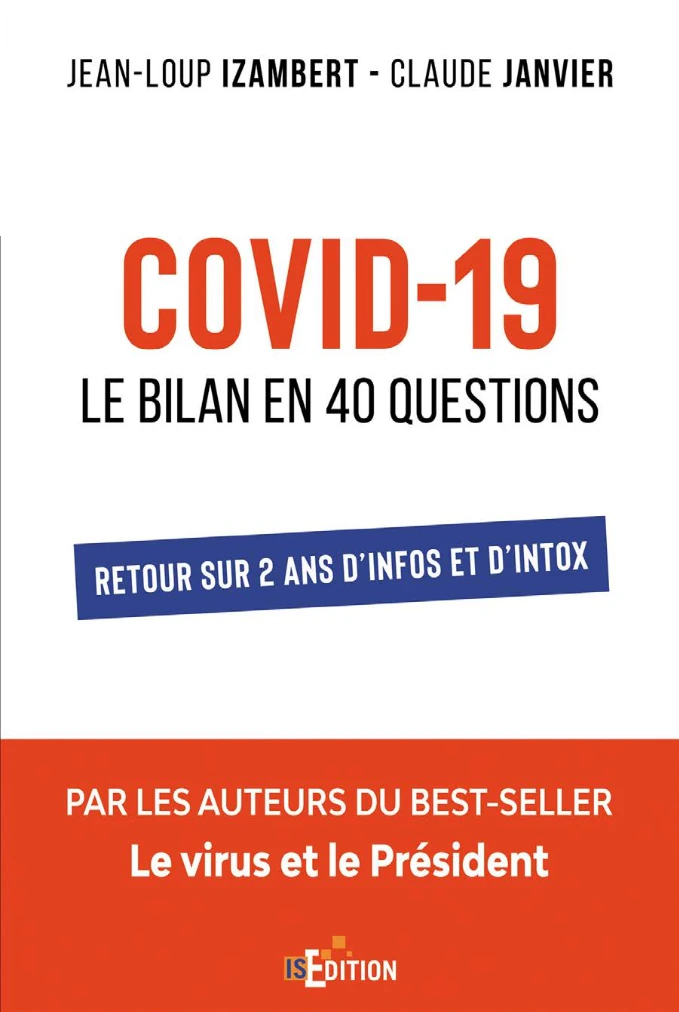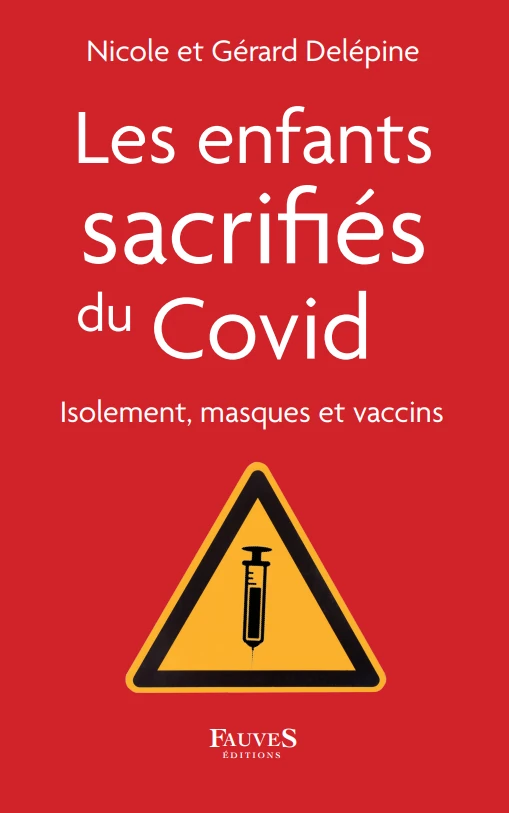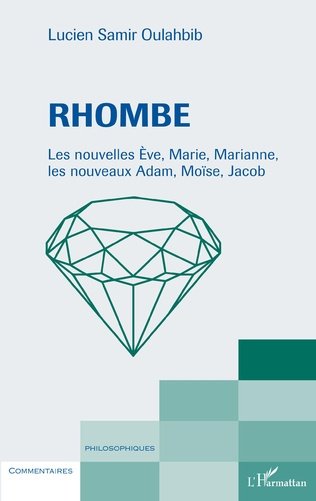01/01/2024 (2024-01-01)
Par Nicolas Bonnal
« Si tout y est ordonné comme ce que tu m’en dis, vous êtes plus barbares que nous. »
De Gaza en Ukraine, de Bruxelles à Berlin, et de Paris à Washington jamais on n’a eu autant des preuves déplorables et de démonstrations de la malignité ontologique de l’homme blanc, dont l’élite kabbalistique et friquée rêve maintenant de zigouiller tout le monde à partir de Rome (du club ou du feint-siège) et de Davos. Occasion pour nous de relire les retouches au voyage de Bougainville dont ma formation de catho de droite et de français de souche m’avait fait perdre les finesses et les vérités. Je recommande aussi le voyage de notre navigateur serein, disponible sur archive.org.
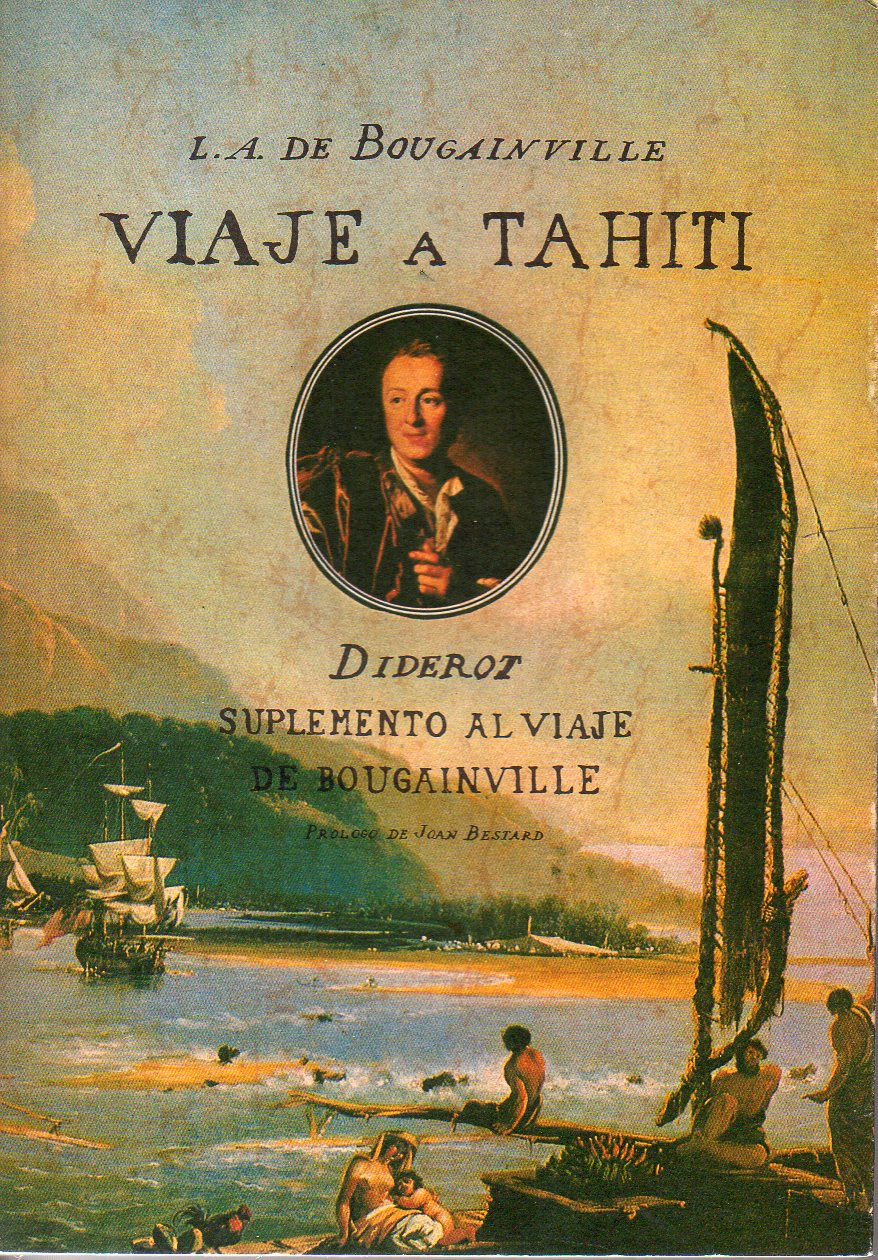
On commence, en félicitant Diderot pour ce style incomparable caractéristique de la reine des langues — la nôtre alors — au siècle des Lumières (Bach, Schiller, Mozart, Rameau…).
Sur le cannibalisme notre auteur ne cache rien et il écrit sans scrupule :
« Que deviennent-ils en se multipliant sur un espace qui n’a pas plus d’une lieue de diamètre ? A. Ils s’exterminent et se mangent ; et de là peut-être une première époque très ancienne et très naturelle de l’anthropophagie, insulaire d’origine. B. Ou la multiplication y est limitée par quelque loi superstitieuse ; l’enfant y est écrasé dans le sein de sa mère foulée sous les pieds d’une prêtresse. A. Ou l’homme égorgé expire sous le couteau d’un prêtre ; ou l’on a recours à la castration des mâles… B. A l’infibulation des femelles ; et de là tant d’usages d’une cruauté nécessaire et bizarre, dont la cause s’est perdue dans la nuit des temps, et met les philosophes à la torture. »
Diderot, on l’attend au tournant avec son bon sauvage :
« B. Je n’en doute pas : la vie sauvage est si simple, et nos sociétés sont des machines si compliquées ! Le Tahitien touche à l’origine du monde, et l’Européen touche ; sa vieillesse. L’intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la distance de l’enfant qui naît à l’homme décrépit. Il n’entend rien à nos usages, à nos lois, ou il n’y voit que des entraves déguisées sous cent formes diverses, entraves qui ne peuvent qu’exciter l’indignation et le mépris d’un être en qui le sentiment de la liberté est le plus profond des sentiments. »
Mais Goethe (revoyez mon texte sur la dévitalisation des Européens) soulignera aussi le déclin de notre perfection de civilisé :
« Du reste, nous autres Européens, tout ce qui nous entoure est, plus ou moins, parfaitement mauvais ; toutes les relations sont beaucoup trop artificielles, trop compliquées ; notre nourriture, notre manière de vivre, tout est contre la vraie nature ; dans notre commerce social, il n’y a ni vraie affection, ni bienveillance. »
Goethe évoquait presque en disciple de Rousseau (beaucoup plus germanique que français, et si mal compris…) le modèle du sauvage :
« On souhaiterait souvent d’être né dans les îles de la mer du Sud, chez les hommes que l’on appelle sauvages, pour sentir un peu une fois la vraie nature humaine, sans arrière-goût de fausseté. »
Parfois même Goethe succombait — toujours devant l’extraordinaire et bienheureux Eckermann au pessimisme, quant à la misère de notre temps (on est en février 1828) :
« Quand, dans un mauvais jour, on se pénètre bien de la misère de notre temps, il semble que le monde soit mûr pour le jugement dernier. Et le mal s’augmente de génération en génération. Car ce n’est pas assez que nous ayons à souffrir des péchés de nos pères, nous léguons à nos descendants ceux que nous avons hérités, augmentés de ceux que nous avons ajoutés… »
L’homme blanc, c’est le fric et la propriété (200 000 palestiniens massacrés pour le gaz, le tourisme et pour l’immobilier — les colonies…) ; Diderot alors :
« Ce vieillard s’avança d’un air sévère, et dit : “Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez ; mais que ci soit de l’arrivée, et lion du départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voulez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux…” »
Après on peut pleurer sur ce modèle communiste qui est celui des Évangiles :
« Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n’es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? »
Pour l’occidental, le monde est — reprenons leur dieu Malthus — un restaurant où seul le riche armé s’empiffre. Diderot écrit lui :
« Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t’avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t’avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. »
Les bons sauvages ne sont pas malthusiens pour un sou :
« Quel sentiment plus honnête et plus grand pourrais-tu mettre à la place de celui que nous leur avoir inspiré, et qui les anime ? Ils pensent que le moment d’enrichir la nation et la famille d’un nouveau citoyen et venu, et ils s’en glorifient. Ils mangent pour vivre et pour croître : ils croissent pour multiplier, et ils n’y trouvent ni vice, ni honte… »
Après comme Lao Tse Diderot fait la chasse aux lois (ne lui imputez pas notre « révolution ratée » — Bernanos, fruit des maçons, des juristes et des bourgeois) :
« Tu es en délire, si tu crois qu’il y ait rien, soit en haut, soit en bas, dans l’univers, qui puisse ajouter ou retrancher aux lois de la nature. Sa volonté éternelle est que le bien soit préféré au mal, et le bien général au bien particulier. Tu ordonneras le contraire ; mais tu ne seras pas obéi. Tu multiplieras les malfaiteurs et les malheureux par la crainte, par le châtiment et par les remords ; tu dépraveras les consciences ; tu corrompras les esprits ; ils ne sauront plus ce qu’ils ont à faire ou à éviter. Troublés dans l’état d’innocence, tranquilles dans le forfait, ils auront perdu de vue l’étoile polaire, leur chemin. »
Au moment où l’occident achève d’imposer son monstrueux malthusianisme partout, lisons et écoutons le bon sauvage alors :
« OROU. – 0 étranger ! ta dernière question achève de me déceler la profonde misère de ton pays. Sache, mon ami, qu’ici la naissance d’un enfant est toujours un bonheur, et sa mort un sujet de regrets et de larmes. L’enfant est un bien précieux, parce qu’il doit devenir un homme ; aussi, en avons-nous un tout autre soin que nos plantes et de nos animaux. Un enfant Supplément au Voyage de Bougainville III 20 qui naît, occasionne la joie domestique et publique : c’est un accroissement de fortune pour la cabane, et de force pour la nation : ce sont des bras et des mains de plus dans Tahiti, nous voyons en lui un agriculteur, un pécheur, un chasseur, mi soldat, un époux, un prêtre… »
Sur les mœurs et la servitude volontaire le philosophe sauvage écrit :
« Qu’entendez-vous donc par des mœurs ? B. J’entends une soumission générale et une conduite conséquente à des lois bonnes ou mauvaises. Si les lois sont bonnes, les mœurs sont bonnes ; si les lois sont mauvaises, les mœurs sont mauvaises ; si les lois, bonnes ou mauvaises, ne sont point observées, la pire condition d’une société, il n’y a point de mœurs. »
Les lois ne sont plus observées chez nous par les riches et les puissants. Elles ne le furent un temps que par peur du communisme (voir notre texte sur Zinoviev).
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.