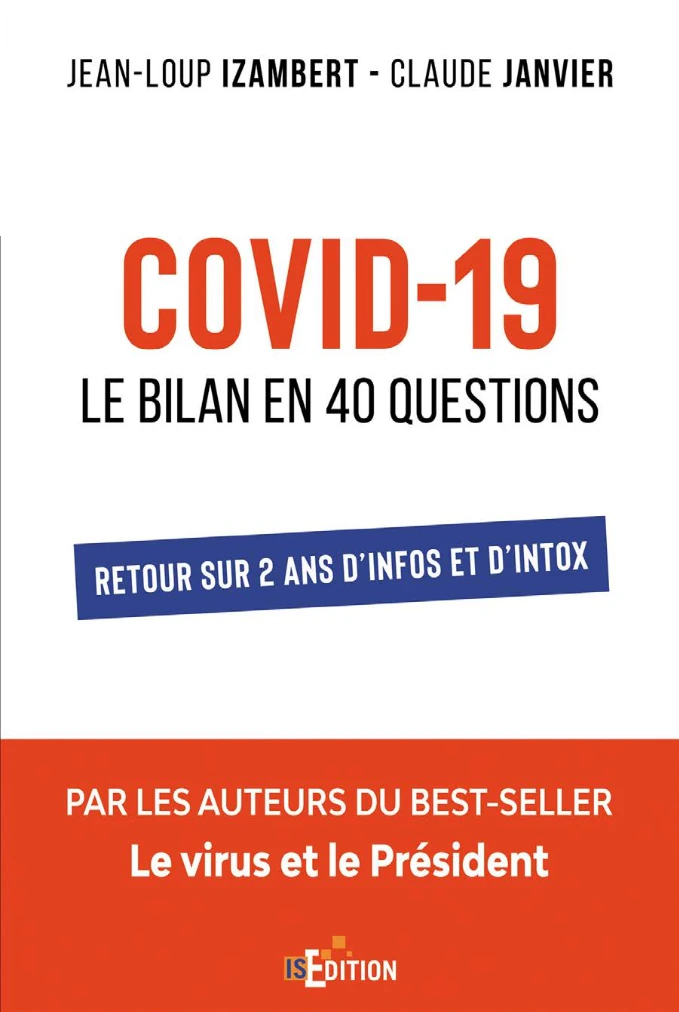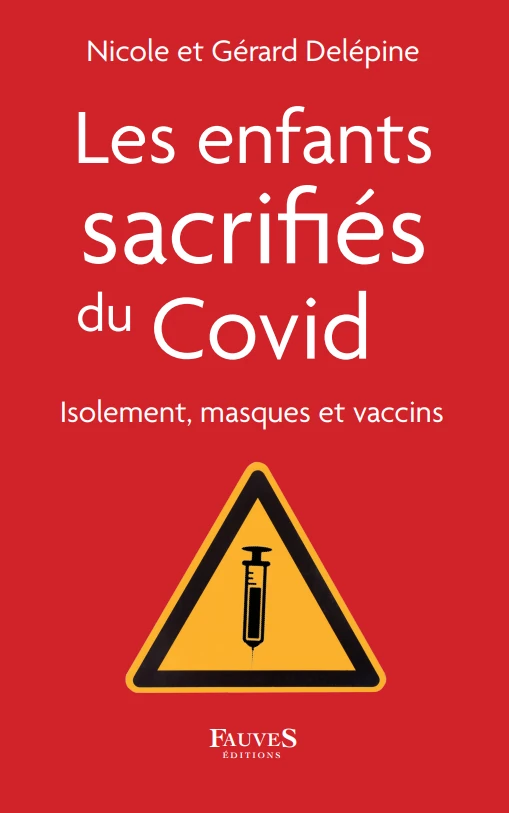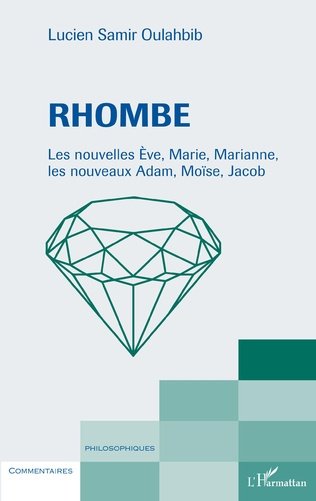06/10/2023 (2023-10-06)
Tocqueville et la disparition des révolutions en démocratie. Mais… « Dans les sociétés démocratiques, il n’y a guère que de petites minorités qui désirent les révolutions ; mais les minorités peuvent quelquefois les faire. »
Par Nicolas Bonnal
Les européens réagissent peu, se font bouffer par le mondialisme, le Reset et la guerre américaine, mais ils ne bougent pas ou bien faiblement, quand ils se croient concernés directement par la ploutocratie mondialiste devenue folle. Voyons pourquoi.
Toujours Tocqueville, immarcescible génie, pour nous expliquer pourquoi nous ne révoltons pas en démocratie ; en fait, comme l’ont compris Cournot ou Henri de Man (cf. nos textes) il n’y avait plus rien contre quoi se révolter après la première révolution. Le reste établit l’affreux système parlementaire et renforça le pouvoir étatique pour établir ce que Jouvenel nomme la démocratie totalitaire (voir notre texte aussi) ; car nous pataugeons dans ce marais de la Fin de l’Histoire (notion comprise par Fukuyama, mais pas par ses lecteurs) depuis deux siècles maintenant.
Dans un long texte de la Démocratie (sept pages), Tocqueville écrit sur cette égalité moderne si peu prolifique en révolutions :
« Cela est-il en effet ? l’égalité des conditions porte-t-elle les hommes d’une manière habituelle et permanente vers les révolutions ? contient-elle quelque principe perturbateur qui empêche la société de s’asseoir et dispose les citoyens à renouveler sans cesse leurs lois, leurs doctrines et leurs mœurs ? Je ne le crois point. Le sujet est important ; je prie le lecteur de me bien suivre. »
Les hommes dans le monde moderne ne sont pas égaux, mais pareils a dit Bernanos dans sa France contre les robots. Et ils aspirent à une paix sociale entropique. Tocqueville :
« Entre ces deux extrémités des sociétés démocratiques, se trouve une multitude innombrable d’hommes presque pareils, qui, sans être précisément ni riches ni pauvres, possèdent assez de biens pour désirer l’ordre, et n’en ont pas assez pour exciter l’envie. Ceux-là sont naturellement ennemis des mouvements violents ; leur immobilité maintient en repos tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous d’eux, et assure le corps social dans son assiette. Ce n’est pas que ceux-là mêmes soient satisfaits de leur fortune présente, ni qu’ils ressentent de l’horreur naturelle pour une révolution dont ils partageraient les dépouilles sans en éprouver les maux ; ils désirent au contraire, avec une ardeur sans égale, de s’enrichir ; mais l’embarras est de savoir sur qui prendre. Le même état social qui leur suggère sans cesse des désirs, renferme ces désirs dans des limites nécessaires. Il donne aux hommes plus de liberté de changer et moins d’intérêt au changement. »
Les désirs sont renfermés et aboutissent à la consommation, pas à la révolution (Drumont le verra finement suivi par Bernanos dans sa Grande Peur) :
« Non seulement les hommes des démocraties ne désirent pas naturellement les révolutions, mais ils les craignent. Il n’y a pas de révolution qui ne menace plus ou moins la propriété acquise. La plupart de ceux qui habitent les pays démocratiques sont propriétaires ; ils n’ont pas seulement des propriétés, ils vivent dans la condition où les hommes attachent à leur propriété le plus de prix. Ainsi, dans les sociétés démocratiques, la majorité des citoyens ne voit pas clairement ce qu’elle pourrait gagner à une révolution, et elle sent à chaque instant, et de mille manières, ce qu’elle pourrait y perdre. »
Seuls les riches bougent : voyez notre livre sur les grands écrivains et la théorie de la conspiration. Gustave Le Rouge, Chesterton (le nommé jeudi, livre-phare du vingtième siècle, au niveau d’Orwell ou de Tolkien) ou Jack London ont vu ce que les détenteurs de richesses mobilières déclencheraient, révolution « russe », orange ou autre. Tocqueville écrit :
« Dans les sociétés démocratiques, il n’y a guère que de petites minorités qui désirent les révolutions ; mais les minorités peuvent quelquefois les faire. »
Un peu d’argent, un peu de pollution mentale et le tour est joué comme on sait : campagne vaccinale, Grand Reset, altération éducative et sexuelle…
Chacun cherche donc à s’enrichir petitement :
« Les peuples sont donc moins disposés aux révolutions à mesure que, chez eux, les biens mobiliers se multiplient et se diversifient, et que le nombre de ceux qui les possèdent, devient plus grand. Quelle que soit d’ailleurs la profession qu’embrassent les hommes, et le genre de biens dont ils jouissent, un trait leur est commun à tous. Nul n’est pleinement satisfait de sa fortune présente, et tous s’efforcent chaque jour, par mille moyens divers, de l’augmenter. »
La révolution ? On a mieux à faire :
« Considérez chacun d’entre eux à une époque quelconque de sa vie, et vous le verrez préoccupé de quelques plans nouveaux dont l’objet est d’accroître son aisance ; ne lui parlez pas des intérêts et des droits du genre humain ; cette petite entreprise domestique absorbe pour le moment toutes ses pensées, et lui fait souhaiter de remettre les agitations publiques à un autre temps. »
Comme les Américains qu’ils ont pris pour modèles (pour Maurice Joly ce sont les juifs que nous avons pris pour modèles — voyez aussi mon texte en lien), les hommes modernes moyens n’ont pas d’objectif révolutionnaire :
« Cela ne les empêche pas seulement de faire des révolutions, mais les détourne de le vouloir. Les violentes passions politiques ont peu de prise sur des hommes qui ont ainsi attaché toute leur âme à la poursuite du bien-être. L’ardeur qu’ils mettent aux petites affaires les calme sur les grandes. Il s’élève, il est vrai, de temps à autre, dans les sociétés démocratiques, des citoyens entreprenants et ambitieux, dont les immenses désirs ne peuvent se satisfaire en suivant la route commune. Ceux-ci aiment les révolutions et les appellent ; mais ils ont grand ’peine à les faire naître, si des événements extraordinaires ne viennent à leur aide. »
Certes il y a — il y aurait — de temps en temps un « Hardi novateur » ; mais l’inertie reste la plus forte :
« Ils ne le combattent point avec énergie, ils lui applaudissent même quelquefois, mais ils ne le suivent point. À sa fougue, ils opposent en secret leur inertie ; à ses instincts révolutionnaires, leurs intérêts conservateurs ; leurs goûts casaniers à ses passions aventureuses ; leur bon sens aux écarts de son génie ; à sa poésie, leur prose. Il les soulève un moment avec mille efforts, et bientôt ils lui échappent, et comme entraînés par leur propre poids, ils retombent. Il s’épuise à vouloir animer cette foule indifférente et distraite, et il se voit enfin réduit à l’impuissance, non qu’il soit vaincu, mais parce qu’il est seul. »
De toute manière le novateur est condamné :
« À mesure que les hommes se ressemblent davantage, le dogme de l’égalité des intelligences s’insinue peu à peu dans leurs croyances, et il devient plus difficile à un novateur, quel qu’il soit, d’acquérir et d’exercer un grand pouvoir sur l’esprit d’un peuple. Dans de pareilles sociétés, les soudaines révolutions intellectuelles sont donc rares ; car, si l’on jette les yeux sur l’histoire du monde, l’on voit que c’est bien moins la force d’un raisonnement que l’autorité d’un nom qui a produit les grandes et rapides mutations des opinions humaines. »
La masse deviendra donc pétrifiée et inerte (Drumont en parle très bien) :
« Quand je vois la propriété devenir si mobile, et l’amour de la propriété si inquiet et si ardent, je ne puis m’empêcher de craindre que les hommes n’arrivent à ce point, de regarder toute théorie nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble fâcheux ; tout progrès social comme un premier pas vers une révolution, et qu’ils refusent entièrement de se mouvoir de peur qu’on les entraîne. Je tremble, je le confesse, qu’ils ne se laissent enfin si bien posséder par un lâche amour des jouissances présentes, que l’intérêt de leur propre avenir et de celui de leurs descendants disparaisse, et qu’ils aiment mieux suivre mollement le cours de leur destinée, que de faire au besoin un soudain et énergique effort pour le redresser. »
Mais complétons. Dans un autre chapitre essentiel et méconnu, Tocqueville dénonce les méfaits de la toute-puissance classe industrielle (les banquiers en fait) ; et cela donne :
« Ainsi, à mesure que la masse de la nation tourne à la démocratie, la classe particulière qui s’occupe d’industrie devient plus aristocratique. »
Il voit que cette classe appauvrit et abrutit la masse :
« Mais l’aristocratie manufacturière de nos jours, après avoir appauvri et abruti les hommes dont elle se sert, les livre en temps de crise à la charité publique pour les nourrir. Ceci résulte naturellement de ce qui précède. Entre l’ouvrier et le maître, les rapports sont fréquents, mais il n’y a pas d’association véritable. Je pense, qu’à tout prendre, l’aristocratie manufacturière que nous voyons s’élever sous nos yeux, est une des plus dures qui aient paru sur la terre ; mais elle est en même temps une des plus restreintes et des moins dangereuses. »
Et elle réintroduira une grande inégalité sur la terre :
« Toutefois, c’est de ce côté que les amis de la démocratie doivent sans cesse tourner avec inquiétude leurs regards ; car, si jamais l’inégalité permanente des conditions et l’aristocratie pénètrent de nouveau dans le monde, on peut prédire qu’elles y entreront par cette porte. »
On y est avec la caste milliardaire qui gère le dépeuplement.
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.