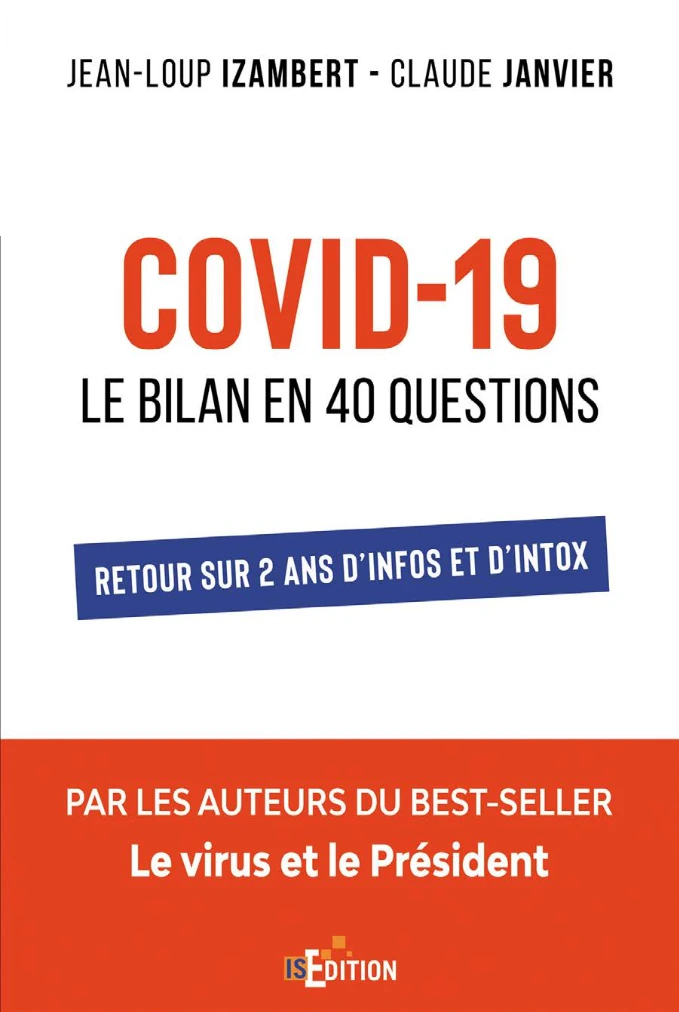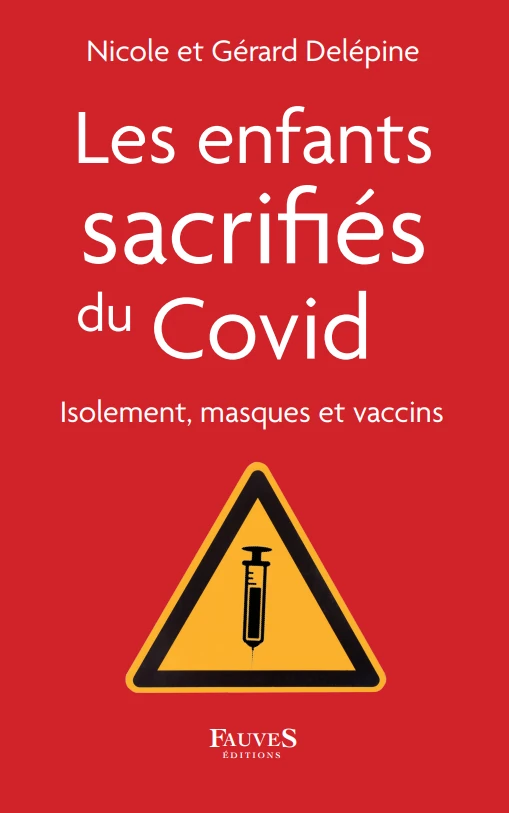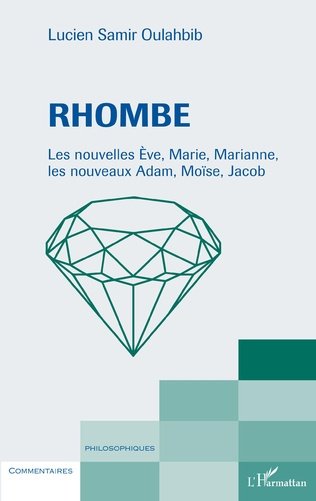18/07/2023 (2023-07-18)
[Source : quebecnouvelles.info]
Traduit de l’anglais (Article d’Alastair Mordey pour Quillette, publié le 16 juillet 2023 sur le site du National Post.)
Dans son article de 2016 intitulé « Concept creep : Psychology’s expanding concepts of harm and pathology », Nick Haslam, professeur de psychologie, aborde la manière dont la psychologie s’est politisée par le biais de manipulations du langage et de la terminologie : « Les concepts qui se réfèrent aux aspects négatifs de l’expérience et du comportement humains ont élargi leur signification de sorte qu’ils englobent désormais un éventail de phénomènes beaucoup plus large qu’auparavant… (produisant) une sensibilité de plus en plus grande aux préjudices ». Selon M. Haslam, une telle dérive conceptuelle « risque de pathologiser l’expérience quotidienne et d’encourager un sentiment de victimisation vertueux mais impuissant ».
L’un des meilleurs exemples de ce type de dérive conceptuelle est la redéfinition du mot « traumatisme ». Les cliniciens utilisent aujourd’hui ce mot pour décrire presque n’importe quelle adversité.
Ce changement d’usage est motivé par un agenda politique spécifique. Le mot « traumatisme » est devenu un terme utile pour les praticiens de la santé mentale qui sont impliqués dans l’activisme pour la justice sociale, car il rend certaines de leurs préoccupations essentielles, telles que l’inégalité sociale, plus menaçantes et alarmantes. Il est à la fois vrai et regrettable que certaines personnes aient une vie plus difficile que d’autres. Mais si nous disons à ces personnes qu’elles sont des victimes de traumatismes, cela améliorera-t-il leur santé mentale ? Et est-ce même vrai ?
La déclaration suivante du Centre pour la non-violence et la justice sociale de l’université de Drexel justifie l’utilisation excessive du terme que l’on retrouve dans le verbiage de tous les campus universitaires, centres de désintoxication et centres de conseil d’aujourd’hui :
Le mot « traumatisme » est utilisé pour décrire des expériences ou des situations qui sont émotionnellement douloureuses et pénibles, et qui dépassent la capacité des gens à y faire face, les laissant impuissants. Le traumatisme a parfois été défini en référence à des circonstances qui sortent du cadre de l’expérience humaine normale. Malheureusement, cette définition n’est pas toujours vraie. Pour certains groupes de personnes, les traumatismes peuvent être fréquents et faire partie de l’expérience humaine commune… Outre les événements terrifiants tels que la violence et les agressions, nous pensons que des formes relativement plus subtiles et insidieuses de traumatisme — telles que la discrimination, le racisme, l’oppression et la pauvreté — sont omniprésentes et, lorsqu’elles sont vécues de manière chronique, ont un impact cumulatif qui peut fondamentalement changer la vie.
Cette redéfinition du mot « traumatisme » est motivée par la politique, déguisée en diagnostic médical.
Jusqu’à récemment, tout le monde savait ce que signifiait le terme « traumatisme ». Dans le dernier Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), le traumatisme est défini comme un trouble psychiatrique présentant des symptômes indubitables et extrêmement débilitants, plus proches de ceux de la psychose que de la dépression. Ces symptômes peuvent survenir après que des personnes ont été soumises ou ont été témoins « d’une mort, d’une blessure grave ou d’une violence sexuelle, réelle ou menacée », c’est-à-dire de choses qui sortent du cadre de « l’expérience humaine normale ». Cela n’inclut pas les préjudices « plus subtils et insidieux », tels que le racisme ou l’oppression (même s’ils sont moralement répréhensibles).
Nous devrions également remettre en question l’idée selon laquelle les situations « douloureuses et pénibles » dépassent nécessairement la capacité des gens à y faire face. Cela suppose que la plupart des gens sont fragiles et impuissants face à l’adversité. Ce n’est tout simplement pas vrai. La plupart des êtres humains (y compris les enfants) sont extrêmement résistants, même lorsqu’ils sont confrontés à des événements véritablement traumatisants. Une étude de 2008, par exemple, a examiné le bien-être subjectif de ressortissants allemands sur une période de vingt ans avant, pendant et après le décès d’un être cher. Environ 60 % des sujets ont relativement bien géré le deuil et se sont rétablis en l’espace d’un an. Vingt autres pour cent ont considérablement souffert pendant la période de crise, mais ont retrouvé leur niveau antérieur de bien-être subjectif au cours des deux ou trois années suivantes. Les 20 % restants étaient encore en deuil de nombreuses années plus tard, mais beaucoup d’entre eux avaient déjà déclaré souffrir de problèmes de santé mentale avant le décès.
es auteurs notent que les êtres humains ont tendance à « revenir à un niveau de bien-être relativement rapidement après les événements de la vie, qu’ils soient les plus pénibles ou les plus favorables ». Les psychologues le savent depuis les années 1970. Alors pourquoi la plupart des professionnels de la santé mentale ne le savent-ils pas ou l’ignorent-ils aujourd’hui ? Peut-être parce que la psychologie universitaire et la psychologie clinique ont été complètement absorbées par la politique de justice sociale qui, comme l’ont expliqué les sociologues Bradley Campbell et Jason Manning, valorise le statut de victime.
En fait, relativement peu de personnes souffrent de traumatismes (au sens traditionnel du terme), même parmi les populations les plus vulnérables. Les taux de SSPT chez les toxicomanes, par exemple, sont inférieurs à ceux d’autres troubles mentaux. Dans une étude citée par la Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA), la plus grande organisation de services de santé mentale aux États-Unis, des chercheurs ont examiné la prévalence des troubles psychiatriques parmi un échantillon de consommateurs chroniques de crack dans une communauté pauvre. Alors que 24 % des consommateurs avaient reçu un diagnostic de trouble de la personnalité antisociale et que 17,8 % souffraient de dépression, seuls 11,8 % d’entre eux avaient souffert d’un syndrome de stress post-traumatique. Il est intéressant de noter que les chercheurs ont constaté que les toxicomanes blancs étaient plus susceptibles de souffrir de troubles mentaux que les toxicomanes noirs, ce qui suggère que, contrairement à la déclaration de l’université Drexel citée plus haut, les traumatismes ne sont pas principalement le résultat d’un racisme institutionnalisé.
Une étude portant sur des consommateurs de crack brésiliens, également citée par la SAMHSA, a révélé que l’extrême violence de la rue et la dégradation à laquelle ils étaient soumis et exposés en raison de leur consommation de drogue étaient la principale source de leur traumatisme. En tant que personne ayant passé beaucoup de temps à travailler avec des toxicomanes par voie intraveineuse, je ne trouve pas cela surprenant.
Selon les lignes directrices de la SAMHSA sur les soins tenant compte des traumatismes (dernière mise à jour en 2014), le traumatisme résulte d’un « événement, d’une série d’événements ou d’un ensemble de circonstances vécus par un individu comme physiquement ou émotionnellement nuisibles ou menaçants et qui ont des effets négatifs durables sur le fonctionnement et le bien-être physique, social, émotionnel ou spirituel de l’individu ».
Le problème est que cette définition du traumatisme est une question d’interprétation subjective : elle suggère que n’importe quelle expérience peut être traumatisante si elle fait que la personne qui en souffre se sent mal. Le divorce des parents et d’autres adversités courantes pourraient être définis comme des « traumatismes » s’ils sont « vécus » comme néfastes. Si le guide de la SAMHSA suit le DSM-5 en reconnaissant que le traumatisme n’est susceptible de se produire que lorsque les personnes sont exposées « à la mort, à des blessures graves ou à des violences sexuelles, réelles ou menacées », il dilue la définition en affirmant que le traumatisme psychologique n’est « pas limité à ces critères de diagnostic » et peut être « caractérisé de manière plus large ». Ce n’est pas la nature des événements eux-mêmes qui les définit comme traumatisants, mais la réaction émotionnelle de l’individu à ces événements. Selon cette définition, un enfant en bas âge qui refuse de se coucher à l’heure et dont les ressources émotionnelles sont « submergées » par l’heure du coucher au point de provoquer des crises de colère nocturnes pourrait être considéré comme souffrant d’un « traumatisme ».
Cet élargissement de la définition a naturellement entraîné une augmentation du nombre de personnes déclarant avoir subi un traumatisme. Les professionnels de la santé mentale ont réagi en proposant des soins tenant compte des traumatismes (TIC). Selon la SAMHSA, la plupart des plus de 10 000 programmes de soins de santé comportementale aux États-Unis proposent aujourd’hui une forme ou une autre de TIC.
Selon le Centre de recherche sociale de l’université de Buffalo, les soins tenant compte des traumatismes « partent du principe qu’une personne a plus de chances qu’une autre d’avoir des antécédents de traumatisme… tiennent compte de la nature omniprésente des traumatismes et favorisent des environnements de guérison et de rétablissement plutôt que des pratiques et des services qui peuvent involontairement traumatiser à nouveau ». Les patients peuvent être traumatisés à nouveau, selon eux, en étant « traités comme des numéros », en « ne se sentant pas vus ou entendus », en manquant de « sécurité émotionnelle » et/ou en étant victimes de « microagressions ».
[…]
Pour lire l’article dans sa forme originale
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.