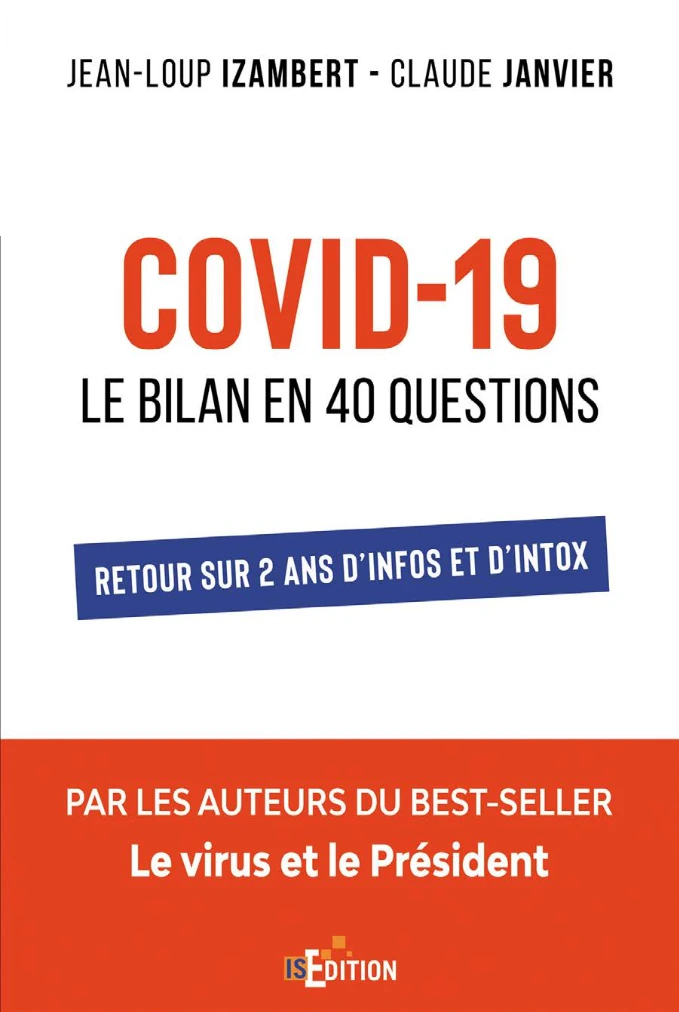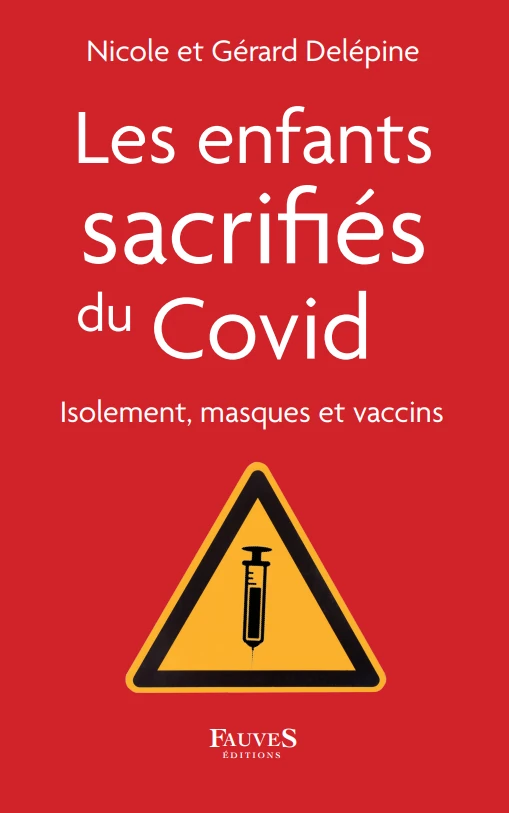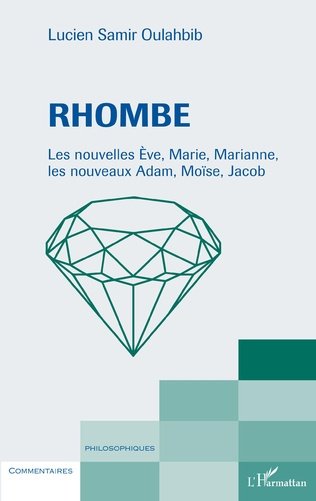20/11/2023 (2023-11-20)
Slobodan Despot interroge N. Bonnal
Ciné-autopsie
Combien de fois me suis-je dit, en contemplant ces derniers temps l’agonie française : c’est « Que la fête commence » à l’ère de Pétain ? Et ces « élites » robotisées, ne semblent-elles pas sorties d’une pantalonnade posthume de Jacques Tati ? Avec son livre sur la disparition de la France au cinéma, Nicolas Bonnal met en images nos plus obscures intuitions.
« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus mous. »
Nicolas Bonnal est un témoin frénétique pour un temps survolté. Il écrit sans ponctuation, sans majuscules, sans relecture, mais avec style. On l’avait repéré comme chroniqueur culturel dans le légendaire Idiot international de Jean-Edern Hallier, ce qui vaut bien — dans la musique moderne — un CV d’instrumentiste chez les Mothers of Invention de Frank Zappa. On l’a suivi sur des chemins que peu empruntent, et qu’il a fini par ouvrir pour les multitudes, notamment avec son livre sur Mitterrand le grand initié (Albin Michel, 2001). Avant cela, il avait levé un coin de rideau sur une gnose postmoderne avec Internet, la nouvelle voie initiatique (Les Belles Lettres, 2000), défriché un itinéraire dans le labyrinthe métaphysique de Tolkien avec Les univers d’un magicien (1998).
Cinéphile érudit et enragé, détecteur captivé-dégouté de toutes les odeurs de décomposition, conteur affermi par la foi orthodoxe de cette folle fin de civilisation, compilEUR de citations le plus raffiné de la blogosphère française, Bonnal a en plus ce talent rare de nous faire ressentir charnellement cette montée du chaos que d’autres essaient de prouver par de fastidieux raisonnements. De sa retraite espagnole, il publie des livres, comme il dit, à la vitesse du vent, et je ne suis même plus sûr que Destruction de la France au cinéma soit son tout dernier. N’importe, c’est un livre unique. En 74 étapes arbitraires, 74 titres du cinéma français d’après-guerre, Bonnal chronique et documente un processus historique et culturel d’une brutalité sans égale. Non pas le déclin, mais la pure et simple disparition, l’effacement ontologique d’une culture millénaire, d’un État-civilisation (comme diraient les Russes) qui fut l’axe du monde : la France. Ou comme l’écrit son talentueux préfacier, Pierre Le Vigan :
« Livre furieux, joyeux, caustique, exaspéré par le monde moderne, mais pas haineux. Bonnal en long et en large. On ne s’en lasse pas. L’idée de départ est de montrer comment une certaine France a disparu. Une France prémoderne ? Traditionnelle ? Celle des vieux métiers ? Celle des vieilles librairies, des bouquins papier et non des e-books ? Celle des bistrots ? Un peu tout cela. Une chose est sûre. C’était la France que nous aimions. »
Le florilège régalien qu’il propose va de Farrebique (1946) à Fantômas (1967). Son va-et-vient en apparence aléatoire dans le temps et les genres trace tout de même, pour finir, un entonnoir vers le néant au fond duquel miroite la lumière morte de Buffet froid, ce sinistre et génial tiré de rideau. La France des campagnes mystérieuses, des accents savoureux et des élans héroïques se dissout dans les cités dortoirs, les supérettes, la chansonnette cucul et le nivellement consommateur. Et le cynisme, autre nom du gel des âmes ! Cynisme roublard, cynisme queutard, cynisme soixante-huitard, cynisme boutiquard, cynisme politicard…
Dans le préambule théorique de son catalogue terminal dialoguent René Guénon et Jacques Tati, Bernanos et Pasolini, Günter Anders et Michel Serres, et les observations d’Alexis Carrel embraient avec un « clic » rassurant dans les imprécations de Guy Debord. Un chef militaire grand comme un menhir, raide comme une potence, semble catalyser toutes les illusions narcissiques de cette France enivrée de fausse gloire. Faut-il le nommer ? Le constat de décès est, ici déjà, incontestable, mais encore abstrait. Avec le choix de films qui l’illustre — et les commentaires acérés qui vont avec — Bonnal vous met le doigt sur la jugulaire du patient. Pour que vous n’alliez pas ensuite vous payer de mots en racontant que le cœur battait encore…
« Ne nous y trompons pas. Tous les films évoqués sont à voir, mais pas parce qu’ils sont des chefs-d’œuvre… L’essentiel : tous sont significatifs d’un tournant dans les mœurs. Des symptômes, et parfois des fantômes… Le temps a tourné comme il arrive au lait. »
Le Septième part, à la suite de la grande littérature, est un matériel de preuve implacable. Bonnal sait en extraire tout le jus. Même si le propos est sombre, l’argumentation nous invite à parcourir encore une fois, dix fois, cent fois, ce jardin enchanté qu’aura été — jusqu’il y a peu — le cinéma français. Il faut donc lire son livre, et le revisiter lui aussi, tant les références sont foisonnantes et déroutantes. J’ai tout de même demandé à Bonnal de nous éclairer une ou deux allées de son jardin crépusculaire.
Sept questions à Nicolas Bonnal
La mort de la France est un lieu commun parmi les dissidents modernes — lesquels remontent à Bloy, Céline, Bernanos, Caraco, Debord ou Muray. Pourquoi avoir ajouté une couche avec ce livre ?
Je voyais une minute sur YouTube où le pauvre Michel Serres était mis en demeure par un présentateur de ne pas regretter le bon vieux temps. Moi aussi, souvent, je ne le regrette pas. L’histoire, c’est du bruit et de la fureur, mais aussi de la faim, pas de chauffage et pas de film du soir — le tout avec une mortalité fantastique ! Elle n’a rien de marrant, l’Histoire, sauf dans le cerveau de ses minotaures manipulateurs. Je relis la bio de Balzac par Troyat et quelle prison tortionnaire que ces collèges cathos ! Non, j’ai voulu compléter mes études sur la Fin de l’Histoire par une référence au visible, donc au cinéma. On peut dire qu’il était resté une France un peu française, traditionnelle, coloniale, guerrière, aventurière (voir Alerte au sud de Jean Devaivre) jusqu’à de Gaulle (désolé…). Ensuite tout a basculé dans le modèle cybernétique, consumériste et immobilier des années 60 : voir les Melville ou le Clan des Siciliens. Le pays n’a pas décliné, IL A DISPARU et le néo-français, le froncé s’impose : c’est Les Valseuses (1973). La disparition physique de la France est nette dans Play Time de Tati et dans Mélodie en sous-sol de Verneuil. On fabrique un homo global qui n’a pas fini DE NE PAS faire parler de lui. Tout est chez Guy Debord : le prolétaire est devenu consommateur. Sinon, la décadence est en effet un lieu commun depuis deux siècles en France (après les rois et Napoléon…).
Il y a la destruction de la France au cinéma et la destruction _par_ le cinéma. Il y a des films-témoins du désastre et des films qui accélèrent le mouvement. Parmi ces derniers — films ou cinéastes —, lesquels vous apparaissent les plus efficaces dans leur œuvre de corrosion ?
Les films de Godard montrent bien l’émergence d’un individu scolarisé-crétin-industrialisé façon Léaud, fils de Marx et de Coca-Cola. Le Nouvelle Vague rompt avec le passé et on voit le crétin qui veut rouler américain, fumer américain, et même coucher américain (Jean Seberg) ; puis les Trente Glorieuses présentent l’addition salée et on voit arriver des monstres comme le boucher ou la bête qui ne mourra jamais dans Que la bête meure, le film de Chabrol (génial Jean Yanne). On a aussi les Valseuses qui montrent que le grand remplacement n’est pas qu’ethnique : il est physique, moral, ontologique. A partir des années 80, je considère qu’on est morts ; Besson va montrer un hexagone devenu simple Bantoustan euro et lambda des USA. Le françoustan. On a le débile du Grand Bleu, puis Le Transporteur puis Taken. Un film qui montre bien l’écrabouillement fastfood du pays par le football, c’est Grégoire Moulin contre l’humanité d’Artus de Penguern.
Les mauvais films, les navets, les films ratés semblent en dire davantage sur l’époque que les « grands » films. Pourquoi, selon vous ?
Ce seraient plutôt des films déplaisants. Le cinéma de Pialat est déplaisant, mais il montre l’horreur d’une France totalement postchrétienne : voyez La Gueule ouverte ; le cinéma de Chabrol n’est pas marrant non plus. Il faut aussi voir que la critique (« elle garde toujours son pouvoir de nuisance », me disait mon ami Jean-Jacques Annaud sur qui j’ai publié un livre en 2000) a détruit le cinéma comme le reste des arts. C’est pourquoi j’ai remis mon texte sur Tolstoï dans la première partie théorique de mon livre (la deuxième, ce sont les films) : il a compris dans son extraordinaire essai sur l’art que la critique et l’enseignement et le snobisme bourgeois allaient ou avaient déjà détruit l’art. Sexe, ennui, dépression, existentialisme, tout était déjà là. La bourgeoisie (caste liée à un État moderne et fort, explique Taine) est une caste eschatologique. C’est le scorpion qui coule la grenouille. Mais c’est aussi une classe révolutionnaire au pire sens du terme. Parlant de navets, je me souviens de la critique qui conchiait Tonnerre de Dieu ou les Tontons flingueurs devenus films-cultes depuis : ce n’étaient que des films que l’élite festivalière trouvait mauvais.
Vous distinguez dans le lot le « prince » Guitry et le maintenez bien au-dessus de la mêlée. De quel esprit — souffle — Sacha Guitry est-il encore le porteur ?
C’est marrant, je pensais en avoir donné plus d’un : Pagnol, qui arrête brutalement en 1955 (fin de notre vieille France ? De la Provence ?), Renoir, et bien sûr Cocteau dont j’ai déjà parlé dans mon essai sur le paganisme au cinéma. Mais tous ces princes sont nés au dix-neuvième, quand la France a encore des racines paysannes et païennes (le christianisme moderne depuis un siècle s’est merveilleusement adapté, Bloy ou Bernanos plus catholiques que moi l’avaient bien vu). Oui, Guitry, c’est un parfum d’Ancien régime, de France élégante et marrante, de beau langage et de bonne soupe. C’est aussi un lieu où on sent l’Être. Le trésor de Cantenac est un de ses chants du cygne, comme En remontant les Champs-Élysées, film où l’on sent que la défaite de Sedan et la Fin de l’Empire — et la fin de toute Restauration possible, que lamente aussi Dostoïevski dans son Journal — sonnent le glas d’une certaine idée de la France. Après, elle n’est plus qu’un fantasme. Guitry, aussi, c’est la légèreté : on pouvait tout dire sans se prendre la tête. L’Esprit c’était la Lettre.
La France est une dormeuse qui s’est nourrie de son propre souvenir. Reste-t-il encore, malgré tout, un filon de la France éveillée ? Si oui, où le trouver ?
Non. Il ne reste rien. On peut toujours faire semblant. Comme je dis à ma femme, j’étais très nostalgique (nostalgie signifie avoir mal) dans les années 1990. Il restait des souvenirs des gens avec des talents, des villages, des petits vieux sympas, des dames bien élevées à l’ancienne, tout cela est mort. Il faut l’admettre. Euro, mondialisation et technologie nous ont donné le coup de race. On est chez les zombis. D’un coup on n’a plus eu de matériau pour nourrir cette nostalgie, et c’est ce qui rend cet abominable siècle plus supportable que le précédent. Le roi est mort, mort au roi. Le français de souche est mort il y a longtemps. Les films de Jarmusch le montrent très bien, que c’est partout pareil. Ceux qui voyagent encore ou vivent à l’étranger me le confirment. Bien entendu, les vautours entonneront un refrain hostile. Normal, ils vivent de charognes.
Le soir, chez vous, après une journée passée à contempler l’effondrement général, quels films aimez-vous regarder ?
Un bon western crépusculaire ou une comédie musicale de l’âge d’or. J’ai publié deux livres, sur les westerns dans une perspective guénonienne (ou plutôt schuonienne, référence proche de Tintin) et sur la comédie de l’âge d’or, de 1945 à 1960. J’adore Tea for Two ; La Belle de New York et Easter Parade qui sont des films Americana, qui illustrent une nostalgie devenue impossible depuis (le peuple a été trop remplacé ou trop avili) ; c’est un genre US qu’on appelle Americana, et où on regrette les années vingt ou même l’avant-guerre de 1914, ou l’avant Fed (car c’est la Fed de Warburg qui a mis fin aux USA). Comme Fred Astaire le dit dans les Ziegfield follies, il n’y avait pas de taxes, pas d’impôts, pas de factures. On était dans un monde libertarien. En France, tout était déjà beaucoup moins drôle.
Quelles délectations nous reste-t-il qui ne soient pas moroses ?
Bel oxymore, délectation morose… Moi, mes délectations sont moroses. J’ai tout lu et surtout relu. Il faut comprendre qu’il n’y a pas tant de musiques, de films ou de romans ou d’essais qui soient bons. On peut se forcer à voir de mauvais films mais on en a vite marre. Seuls les classiques (y compris au cinéma ou dans la chansonnette ou la série télé), a dit Nietzsche, ont fait leurs preuves. Le reste me fatigue. Donc si je revois un Kubrick ou Le cavalier électrique de Pollack, si je relis Racine ou Chateaubriand, il faut savoir que c’est la centième fois. Donc c’est morose. Mais cela reste une délectation. Ma femme aussi joue au piano du Grieg ou du Bach pour la centième fois : mais elle se délecte. Le plus dur, c’est les voyages devenus impossibles (voyez mon Voyageur éveillé) : tout est devenu plus laid, plus technologique, plus cher, plus banal et homogénéisé. Les voyages ne valent plus la peine. On est comme au début du Seigneur des Anneaux (voir mon livre encore — je me fais insulter pour en écrire tant, ça c’est aussi une délectation) quand Bilbon dit qu’il se sent comme du beurre étalé sur trop de pain.
Pour le reste il faut être actif comme mon épouse Tetyana : jardiner, cuisiner, aimer, jouer, prier. Et ne pas trop parler…
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.