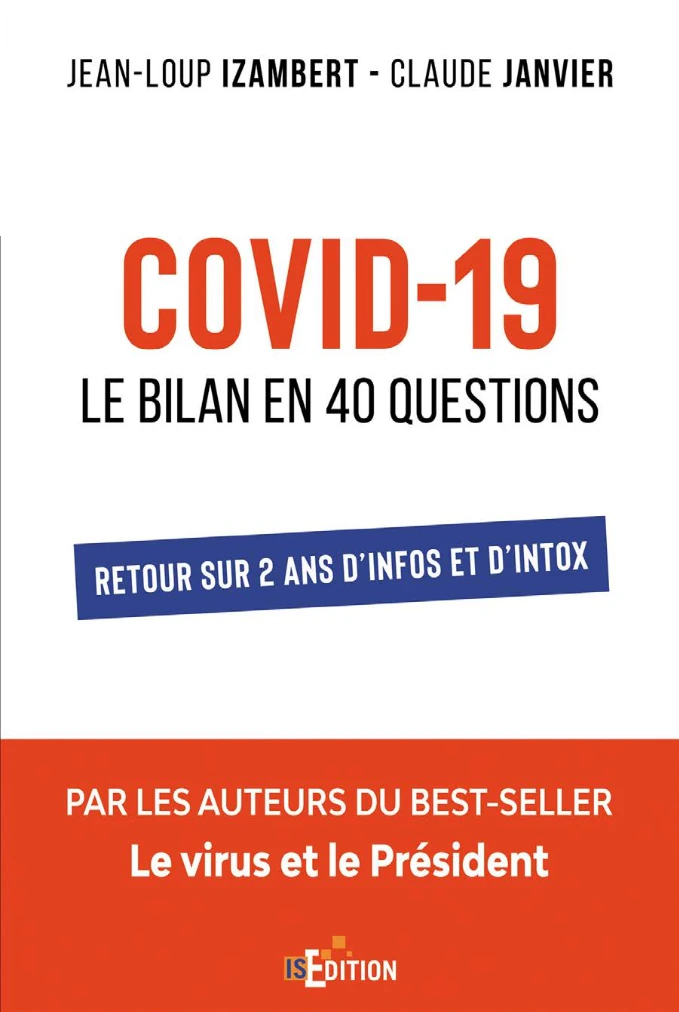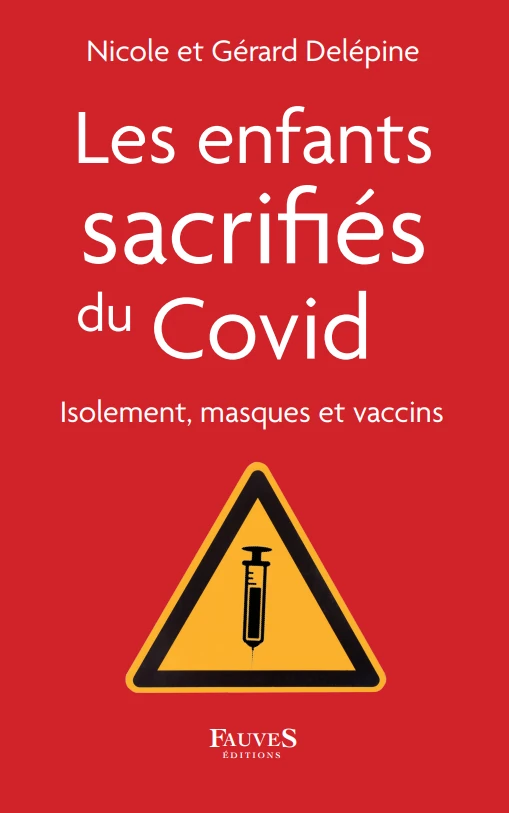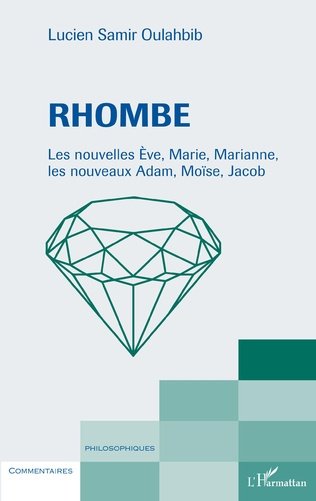22/11/2023 (2023-11-22)
Par Nicolas Bonnal
Les voyages (déjantés) de Horbiger (ils fêtent leurs vingt ans) : quelques années dans l’ailleurs absolu (introduction en 1187 mots en honneur de l’Ordre du Temple, aux matins des magiciens et aux déplieurs d’espace). Journal de voyage le plus déjanté (dixit Jean Raspail dès 2005 car le maître m’avait à l’œil du côté du salar de la peur) de l’histoire lettrée. En hommage à Horbiger, aux aviateurs allemands, au koala perdu, aux Indiens mats de peau et clairs d’idée, au calumet de l’épée et aux animaux transcendés par maréchal grommelle (renard du dessert)…
Je suis arrivé en Argentine le 9 novembre 2003, devant y passer l’hiver. J’y suis demeuré six ans, traversant toute l’Amérique du Sud, remontant l’Amazone, descendant (et remontant surtout) l’Amazone, zonant dans les Andes, me véhiculant à Ayacucho, séjournant assommé à La Paz, et devenant progressivement fou ; cent nuits de bus pour commencer, oh cette merveilleuse route de Mar del Plata à Bariloche avec un orage de nuit digne de Jules Verne. J’ai donc écrit des rêves nommés contes latinos, qui ont été publiés en 2009 par un de mes éditeurs parisiens, Michel de Maule, et chroniquant déjanté (dixit Raspail) pour le Libre Journal de Serge de Beketch. Les contes étaient espacés, liés à ma crise, à ma folie, à mon démon de midi (décrit déjà par Keyserling), à mes besoins d’écrire, à mes cybercafés, toujours trop rares au Brésil. Plusieurs amis sont venus me rejoindre et j’ai eu la joie de revoir le salar d’Uyuni (surnommé salar de la peur, ne riez pas) ou bien ce macho pêchu où Horbiger — mon double d’alors — prit alors le pouvoir six mille pieds au-dessus des hommes et du temps, faisant de moi fils du sommeil et du soleil, fils de l’inca et du K. de Buzzati cherchant des ombres comme au chant VI de l’Enéide. Ma rêverie païenne n’en finissait pas et je m’en rendis compte un jour où je vis dans un bus qui brinquebalait à 4000 mètres d’altitude une jeunesse péruvienne éprise d’amour (à la TV) pour l’Odyssée de Coppola avec une pléiade-sic de stars hollywoodiennes. Un peu de folie, un peu de tellurisme, et beaucoup de cinéma faisaient de vous un conquistador des terres d’or du rêve et de l’ivoire (comme dirait Nerval — ou bien Virgile).
Les rencontres étaient faciles (elles reparaissent parfois dans le souvenir, pas dans ces textes) ; partout la même langue, partout une curiosité, partout une désinhibition et un pouvoir d’argent (le poder adquisitivo) qui me rendaient tour à tour conquérant et épuisé. La dernière année avant de recevoir Tetyana qui devait m’accompagner dans mes derniers et fastidieux élans. Je vieillissais, endolori, je phagocytai mon temps, et JJ Annaud me demanda ce que je faisais TOUT CE TEMPS là-bas, lui qui y avait tourné sept ans au Tibet tout de même ; Paul Bowles avait dit qu’un voyage on ne sait pas quand on revient — j’allais dire quand on en sort, comme d’un rêve, qui rend la vie vivable, malgré ses vices et ses vertus.
J’ai fini tout cela à Iguaçu par mes rencontres avec mes animaux, les sauvages bien entendu (les autres sont dans l’assiette ou sur le canapé) qui rattrapés par le tourisme et l’américanisation, la massification et l’industrialisation, se corrompaient. Mais j’écrivis et publiais sur place des contes qui traduits en british par Kevin Hin devaient conquérir le lectorat. Mais je renonçai et rentrai, comme j’aime faire. Heureusement il restait assez de force à Tatiana pour me rejoindre à Monaco et partir revivre en Andalousie. Je rentrai même en première classe Air France grâce au riche copain Patrick venu me rejoindre au Chili. Lisez ce livre et n’en attendez rien de rationnel.
La première année, passée essentiellement en Argentine, j’ai passé cent nuits dans les bus. Ils étaient grands et confortables, conditionnés et bichonnés, je me sentais comme Céline dans ses salles de cinéma à New York. Mais c’était mieux que la petite mort des salles de cinéma, c’était la découverte d’un continent avec ses ivresses carnées (porte d’entrée la Pampa mais aussi Mendoza), la dérive d’un incontinent (liberté, que de vins je bus en ton nom !), et cette belle sensation de vide dans un continent où comme en Australie ou au Canada tout le monde vit dans quelques villes-gigantomachies, d’ailleurs pas si laides et insupportables que cela. Mais j’ai vécu à une riche époque (les âges d’or durent peu, cinq ans et pas vingt-cinq mille), vie pas trop chère, autonomie latine, débuts pas trop marqués de la société de consommation, lieux de poésie pas encore profanés, tout cela est loin maintenant.
C’est paradoxalement le lieu où j’ai le plus vécu et bu, celui où j’ai le moins écrit. J’ai fait des vers pourtant, vers patagons écrits en Arequipa, ville-refuge des Andes, marquée par ses volcans, son ciel azur et sa sérénité, abandonnée par les tremblements des terres qui l’avaient tant ravagée. Mes vers au vin blanc alors venaient suivant les verres.
Un de mes textes sur le Chili avait bien plus à Jean Raspail, lecteur de Serge. En fait en quinze jours ou trois semaines j’avais vécu et connu la Patagonie australe, Ushuaia, la Terre de Feu, les glaciers Perito Moreno, et puis j’étais remonté vers les volcans chiliens, leurs neiges et leurs lacs, avant de traverser à la vitesse de l’éclair les lagunes et les déserts de San Pedro de Atacama (honneur à qui recèle des déserts !) et ses geysers. Après un flambant voyage par Uyuni, et un lac blanc et salé transcendant, j’allais m’échouer à Sucre, cité savante et coloniale alors oubliée dans le temps. Tout cela a dû être bien esquinté maintenant.
Horbiger est apparu, suite à un Suisse dingo et sympa (un autre suisse m’impressionna, bédéaste qui dessinait mes projets) et rencontré à Mendoza, dans des vignobles où je ne dessoulai pas. Il y avait des beautés cuivrées et beiges dans ces parages tibétains. Horbiger fut accompagné d’animaux plus dingues que lui encore et je me suis rendu compte depuis que pas mal d’animaux, d’oiseaux surtout sont dingues, parce qu’ils sont plus animés et plus vivants que nous. Leur personnalité est transcendante à côté de celle des touristes ; j’ai remarqué aussi une baisse de la qualité de ces derniers, surtout les froncés, après 2007, élection et Europe obligatoire obligent. La mondialisation commençait à passer facture, avec son inflation, un peu partout.
Le vin, les voyages, les amours, tout cela donnait à cet ensemble un aspect enchanteur. Et puis je repensais à Tintin, à son Tibet d’opérette (comme la Suisse d’opérette de Tartarin-Daudet), aux oreilles cassées (elles se multiplient comme la rose de Saint-Exupéry, c’est cela l’industrie, ruse bottée pour détruire le monde) et je demandai si ce n’était pas cela le Tibet, ces Indiens, cette Copacabana — celle du bord du lac Titicaca, ces merveilleux prêtres chrétiens, ces cérémonies, et cette fragilité qui allait être balayée, massacrée par la mâchoire mondialiste. Alors tout cela donnait envie de rentrer. Il ne faut pas rester dans ces lieux qu’on a connus parfaits.
Aujourd’hui c’est la mâchoire de fer numérique qui se referme sur tout. Mais on en parle ailleurs. Peut-être que l’Amazonie, seule avec ses eaux et ses bêtes, garantit quelque nature libre, encore.
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.