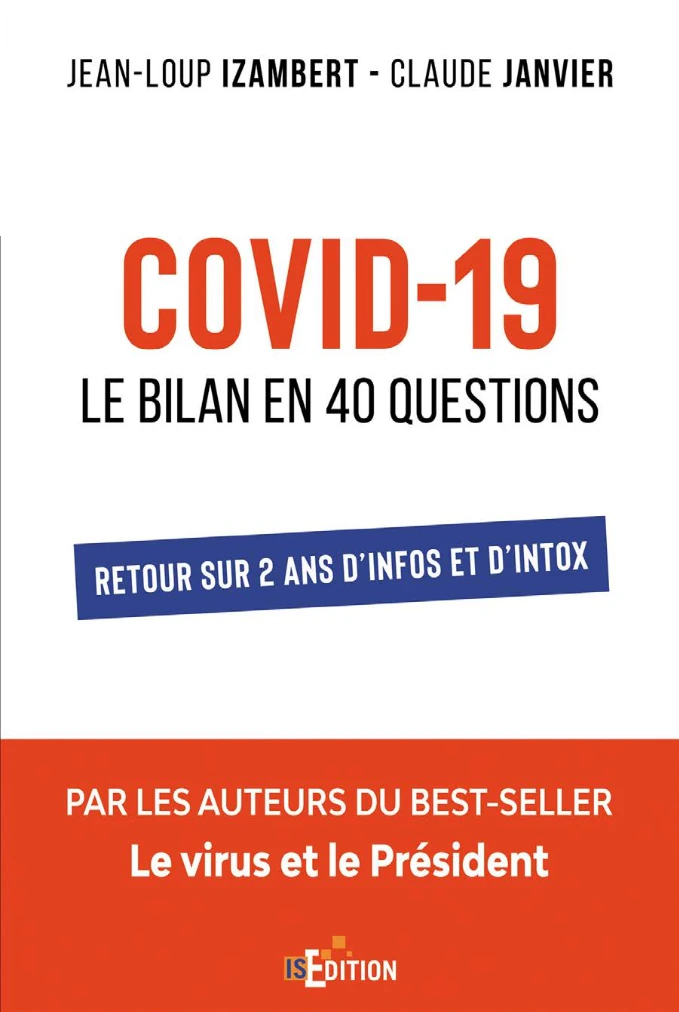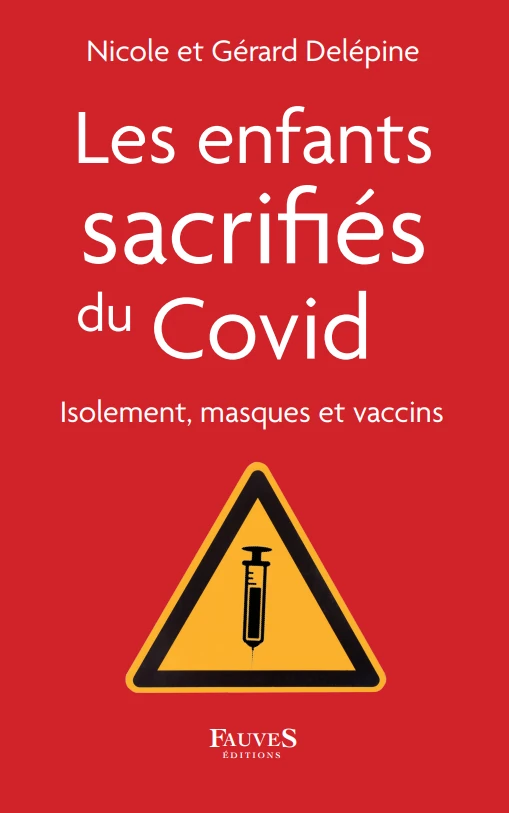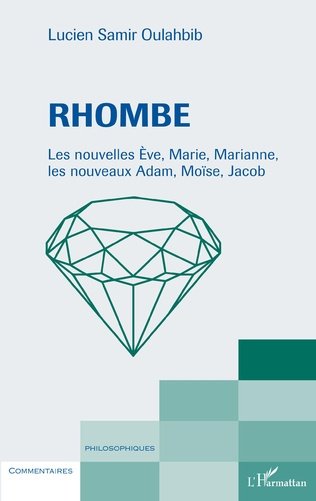30/10/2023 (2023-10-30)
Par Nicolas Bonnal
Baudelaire et le présent perpétuel… « Nouvel exemple et nouvelles victimes des inexorables lois morales, nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges, ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ses résultats positifs. »
Je suis tout le temps traversé par une perception qui est le bois de ma croix : depuis un siècle et demi ou deux, nous sommes (serions !) paralysés et nous n’avançons pas. Nous tournons en rond comme les danseurs possédés, oublieux, du Lancelot en prose. Les mêmes problèmes politiques et la même médiocrité morale, sociale pèsent éternellement partout. C’est du Joly ! On fait semblant de « progresser » (le mythe du progrès, bouger en rond — le vrai embouteillage), de ne pas s’en rendre compte. L’homme vit dans un présent perpétuel, sa prison-planète si j’ose dire. Il peut se divertir.
Un lecteur fidèle et facétieux me transmet alors ces lignes de Baudelaire que j’avais oubliées. Elles viennent des Fusées. On est sous le Second Empire, dans ce présent perpétuel et dans cette similaire situation, que vous retrouvez chez Marx, Tocqueville, Flaubert (voyez mon texte ici sur Flaubert).
Baudelaire ajoute que nous avons du culot.
On l’écoute :
« L’homme, c’est-à-dire chacun, est si naturellement dépravé qu’il souffre moins de l’abaissement universel que de l’établissement d’une hiérarchie raisonnable.
Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c’est qu’il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci : qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ?
— Car, en supposant qu’il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du dictionnaire historique ? sera réduit aux expédients et au désordre, bouffon des républiques du Sud-Amérique, — que peut-être même nous retournerons à l’état sauvage, et que nous irons, à travers les ruines herbues de notre civilisation, chercher notre pâture, un fusil à la main.
Non ; — car ce sort et ces aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges. »
C’est le sujet de mon roman d’aventures. Mais on ne va ni dans ce sens ni dans l’autre. Vers la minorité-machine ? Le reste n’est même plus retourné à la barbarie mais patauge comme nous, ou gamberge dans la bouffonnerie sociétale latino.
Cerise sur le gâteau, l’américanisation déjà présente chez Stendhal (voyez Lucien Leuwen) et l’atrophie.
« Nouvel exemple et nouvelles victimes des inexorables lois morales, nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges, ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ses résultats positifs. »
Guerre, communisme, quarante millions de morts pour quoi faire ? Comme Feuerbach, Baudelaire voit l’illusion religieuse fonctionner à plein, qui stimule au lieu d’être. Joseph de Maistre l’optimiste est dépassé. Baudelaire en déduit même le communisme :
« Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. De la religion, je crois inutile d’en parler et d’en chercher les restes, puisque se donner encore la peine de nier Dieu est le seul scandale en pareilles matières. La propriété avait disparu virtuellement avec la suppression du droit d’aînesse ; mais le temps viendra où l’humanité, comme un ogre vengeur, arrachera leur dernier morceau à ceux qui croiront avoir hérité légitimement des révolutions. Encore, là ne serait pas le mal suprême. »
La nullité sera universelle, avec troupeau imbécile décrit par Poe (lisez les lignes du traducteur Baudelaire sur Poe) ou Tocqueville :
« L’imagination humaine peut concevoir sans trop de peine, des républiques ou autres états communautaires, dignes de quelque gloire, s’ils sont dirigés par des hommes, sacrés, par de certains aristocrates. Mais ce n’est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle, ou le progrès universel ; car peu m’importe le nom. Ce sera par l’avilissement des cœurs. »
Un seul but, le fric. Mais depuis, le citoyen postmoderne demande quelque chose, mais pas beaucoup (Payne). Mille euros mensuels, il laisse le système tranquille…
Baudelaire devient sarcastique :
« … les gouvernants seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d’ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie ?
Alors, le fils fuira la famille, non pas à dix-huit ans, mais à douze, émancipé par sa précocité gloutonne ; il la fuira, non pas pour chercher des aventures héroïques, non pas pour délivrer une beauté prisonnière dans une tour, non pas pour immortaliser un galetas par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour s’enrichir, et pour faire concurrence à son infâme papa, — fondateur et actionnaire d’un journal qui répandra les lumières et qui ferait considérer le Siècle d’alors comme un suppôt de la superstition. »
C’est du Léon Bloy.
Baudelaire parle des foules, comme une correspondante, et souligne un oxymore : dans ce monde le prophète en devient ridicule.
« Quant à moi qui sens quelquefois en moi le ridicule d’un prophète, je sais que je n’y trouverai jamais la charité d’un médecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoyé par les foules, je suis comme un homme lassé dont l’œil ne voit en arrière, dans les années profondes, que désabusement et amertume, et devant lui qu’un orage où rien de neuf n’est contenu, ni enseignement, ni douleur. Le soir où cet homme a volé à la destinée quelques heures de plaisir, bercé dans sa digestion, oublieux autant que possible — du passé, content du présent et résigné à l’avenir, enivré de son sang-froid et de son dandysme, fier de n’être pas aussi bas que ceux qui passent, il se dit en contemplant la fumée de son cigare : Que m’importe où vont ces consciences ? »
Elles recherchent des nouvelles en se réveillant (Thoreau), le narcotique de l’information (Fichte). Elles inventent le bonheur (Nietzsche), elles clignent de l’œil (Nietzsche). Elles vont à la messe (Bloy, Bernanos).
On est vers 1855-1862. Dostoïevski écrit les possédés, Flaubert son éducation. Les dieux sont morts, les dés sont lancés.
Sources
- Baudelaire — Fusées
- Bonnal — Chroniques sur la Fin de l’Histoire ; Perceval et la reine (Amazon.fr)
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.