Commentaires sur le VIH de Montagnier
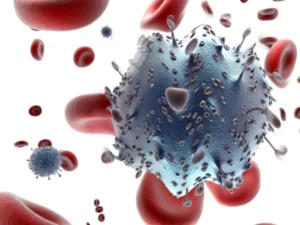
[Source : http://www.virusmyth.com/aids/hiv/epreplyintervlm.htm]
Par Eleni Papadopulos-Eleopulos et coll.
Continuum Hiver 1997
Traduction et mise en page Jean Bitterlin 03 mars 2023.
Nous remercions Djamel Tahi et Huw Christie de nous avoir demandé de commenter les réponses données par le Professeur Luc Montagnier dans son interview avec Djamel Tahi. Avant de commenter, nous avons pensé qu’il serait utile de commencer par un bref rappel des méthodes utilisées pour prouver l’existence des rétrovirus, et des preuves apportées par Montagnier et coll. 1983 de l’existence du « VIH ».
Méthodes utilisées pour prouver l’existence des rétrovirus
Il est généralement admis que Peyton Rous a découvert les rétrovirus en 1911 lorsqu’il a induit une malignité chez des poulets par des injections de filtrats acellulaires obtenus à partir d’une tumeur musculaire. Des expériences similaires ont été répétées par de nombreux chercheurs et les filtrats inducteurs de tumeurs sont devenus connus sous le nom d’agents filtrables, de virus filtrables, d’agents de Rous, de virus de Rous. Cependant, Rous lui-même a exprimé des doutes quant à la nature infectieuse des agents qui provoquaient des tumeurs. En effet, Rous mettait en garde : « La première tendance sera de considérer l’agent auto-perpétuel actif dans ce sarcome de la volaille comme un minuscule organisme parasite. L’analogie avec plusieurs maladies infectieuses de l’homme et des animaux inférieurs, causées par des organismes ultramicroscopiques, vient à l’appui de cette conception des faits, et l’on s’efforce actuellement de la vérifier expérimentalement. Mais un organisme d’un autre type n’est pas exclu. Il est concevable qu’un stimulant chimique, élaboré par les cellules néoplasiques, puisse provoquer la tumeur chez un autre hôte et entraîner en conséquence une nouvelle production du même stimulant ».(1)
En 1928, A E Boycott, le président de la Société Royale de Médecine, section de pathologie, dans son discours présidentiel intitulé « La transition du vivant au mort : la nature des virus filtrables », a déclaré : « Un autre phénomène analogue nous amène, je pense, un pas plus loin. Les produits de l’autolyse des cellules mortes dans le corps, en concentration appropriée, stimulent la croissance des tissus. Il s’agit d’un magnifique mécanisme d’autorégulation dans lequel la quantité de stimulus est proportionnelle à la quantité de destruction cellulaire, et donc à la quantité de croissance cellulaire requise, et il est évidemment de la plus haute importance pour la survie — un facteur de sélection et d’évolution bien plus puissant que n’importe quelle maladie ne l’a jamais été. Comme il opère normalement dans la guérison de nos doigts coupés, le résultat final est simplement la restauration des cellules qui ont été détruites. Mais si l’on échappe à la contrainte normale exercée par les tissus voisins et que l’on utilise des cultures de tissus, les produits de l’autolyse ou du métabolisme (sous forme d’extraits de tissus, de tumeurs ou d’embryons) stimulent indéfiniment la croissance et l’on peut obtenir une quantité de tissus beaucoup plus importante que celle dont on disposait au départ. À partir de l’autolyse de ceux-ci, une plus grande quantité de substance stimulante peut être obtenue, et il ne semble y avoir aucune raison pour que ce processus de multiplication ait une limite : les tissus normaux dans l’isolement physique des cultures de tissus sont aussi immortels que les tissus malins dans leur isolement physiologique du reste du corps… Ces produits de l’autolyse… n’ont pas reçu autant d’attention qu’ils le méritent, mais ils sont probablement de constitutions relativement simples et découvrables. Pourtant, appliqués aux cellules, ils provoquent leur croissance et, ce faisant, augmentent potentiellement leur propre quantité ; c’est en grande partie ce que fait l’agent de Rous… Quant à son origine, toutes les preuves semblent concorder pour indiquer que le virus de Rous apparaît de novo dans chaque tumeur. Il n’existe aucune preuve épidémiologique que le cancer pénètre dans l’organisme de l’extérieur ; tout ce que nous savons soutient l’opinion classique selon laquelle il s’agit d’une maladie locale autochtone. Des sarcomes expérimentaux produits par l’extrait d’embryon et l’indol, l’arsenic ou le goudron ont été transmis par des filtrats. Les épithéliomas sont facilement produits chez les souris par le goudron et chez les hommes par une irritation chronique ; et si nous croyons que toutes les tumeurs malignes contiennent plus ou moins d’un agent cancérigène apparenté au virus de Rous, il s’ensuit que nous pouvons avec un degré élevé de certitude stimuler les tissus normaux à produire du virus ».(2)
Dix ans plus tôt, dans un article intitulé « The Plasmagene Theory of the Origin of Cancer » (La théorie du plasmagène dans l’origine du cancer), Darlington, discutant de l’induction du cancer par l’agent de Rous, les virus filtrables et les particules « auto-propagatrices » transmises par l’hérédité, mais situées en dehors du noyau que l’on trouve dans les plantes et « connues sous le nom de plasmagènes », écrivait : « Ces infections, on le verra, sont artificielles, ou du moins non naturelles. La distinction entre infection naturelle et artificielle est connue depuis longtemps, bien que peu considérée, dans la discussion sur les virus des plantes. Un certain nombre d’affections aberrantes peuvent être transmises de la souche au scion, et certaines sont même apparues dans un scion après qu’il ait été greffé sur une souche saine. Il s’agit de maladies artificielles ; elles ne sont pas transmises dans la nature, mais uniquement par greffage. Certaines peuvent avoir été créées par la mutation de protéines autopropulsées dans les cellules de plantes propagées sur de longues périodes par voie végétative (comme peuvent l’être les tumeurs). D’autres sont certainement apparues par la migration ou la transplantation de protéines d’un organisme à un autre. Dans les deux cas, elles ont une propriété d’infection qu’elles ne peuvent révéler que dans des circonstances artificielles… Nous commettons donc une grande erreur en les appelant virus ; ce sont des provirus… Une autre question mérite une réponse : quelle forme la protéine mutante serait-elle susceptible de prendre dans la cellule tumorale ? En raison de sa multiplication rapide, elle pourrait bien présenter un degré d’agrégation plus élevé que son progéniteur. Elle apparaîtrait alors comme une particule étrangère dans la cellule mutante. C’est ce que confirment les observations faites au microscope électronique sur deux agents tumoraux de poulet de type provirus par Claude, Porter et Pickels (1947) ».(3)
L’observation au microscope électronique de Claude et coll. est le premier rapport de particules de type viral dans une tumeur, les premières micrographies électroniques du « virus de Rous ». Peu après, de nombreux autres chercheurs ont signalé la présence de ce type de particules dans de nombreuses tumeurs et, comme l’avait prédit Boycott, dans des « tissus normaux stimulés ». En ce qui concerne la prédiction de Darlington selon laquelle ces particules peuvent être dues à « un degré plus élevé d’agrégation » du cytoplasme, il peut être intéressant de noter que :
- (a) pour que les protéines, les acides nucléiques ou l’agrégation protéine/acide nucléique (condensation, contraction) aient lieu, l’oxydation est nécessaire ;(4)
- (b) les tissus tumoraux sont oxydés ;(4)
- (c) tous les agents utilisés pour « stimuler les tissus normaux » pour induire des rétrovirus sont des agents oxydants.(5-7)
Dans les années 1940, suite au développement du microscope électronique (ME) et de la technique d’ultracentrifugation dans des gradients de densité, les particules observées dans les tissus malins ont pu être isolées et donc purifiées, c’est-à-dire séparées de tout le reste. Parce que ces particules étaient observées dans les tissus malins, « on a jugé que les particules constituaient l’agent étiologique de la maladie » et, dans les années 1950, les agents filtrables de Rous ont été appelés oncovirus (onkos = tumeur). La principale caractéristique morphologique de ces particules est une gamme restreinte de diamètres et leur principale caractéristique physique est leur densité.(8) Lorsque l’ultrastructure de ces particules a été déterminée, elles ont été définies comme des particules d’un diamètre de 100-120 nm (NdT : un nanomètre est un milliardième de mètre ou un millionième de millimètre) contenant des « corps internes condensés (noyaux) » et des surfaces « constellées de projections » (pointes, boutons).(9)
Dans les années 1950, des rétrovirologues réputés, comme JW Beard, ont reconnu que les cellules, y compris les cellules non infectées, dans diverses conditions, étaient responsables de la génération d’un ensemble hétérogène de particules, dont certaines pouvaient ressembler à des oncovirus. Ce « problème de particules » a conduit à l’opinion que pour prouver l’existence d’un rétrovirus « le schéma d’approche, bien illustré par celui conçu et rigoureusement testé dans les enquêtes sur les agents viraux, est relativement simple. Il consiste en :
- (1) l’isolement des particules d’intérêt ;
- (2) la récupération (purification) des particules dans une préparation donnée qui sont homogènes en ce qui concerne le type de particule ;
- (3) l’identification des particules, et
- (4) l’analyse et la caractérisation des particules pour les propriétés physiques, chimiques ou biologiques désirées ».
Beard a également souligné que « l’identification, la caractérisation et l’analyse font l’objet de disciplines bien connues, établies par des enquêtes intensives, et les possibilités sont loin d’être épuisées. Curieusement, c’est dans ce domaine que l’on constate les lacunes les plus fréquentes. Elles sont parfois liées à l’évasion des disciplines ou à leur application à des matériaux inadaptés. Comme prévu, une grande partie de l’intérêt pour les aspects les plus fastidieux de l’isolement et de l’analyse des particules a été détournée par les procédés plus simples, et sans doute instructifs, de la microscopie électronique. Si cet instrument permet d’apprendre rapidement beaucoup de choses, il est néanmoins clair que les résultats qu’il permet d’obtenir ne pourront jamais remplacer, et risquent trop souvent d’occulter, la nécessité des analyses fondamentales critiques qui dépendent de l’accès à des matériaux homogènes » (10) (italiques de nous).
Les rétrovirologues étaient également d’accord sur le fait que « les virions du RTV (rétrovirus) ont une densité flottante caractéristique, et que la centrifugation jusqu’à l’équilibre dans des gradients de densité est la technique préférée pour la purification du RTV ». 11 Lors d’une réunion européenne sur l’utilisation de la centrifugation dans les gradients de densité, qui s’est tenue à l’Institut Pasteur en 1972 et dont Jean-Claude Chermann était le secrétaire, il a été souligné qu’une fois que les fluides de culture (surnageants) sont bandés (NdT : dans la centrifugation les composants du mélange se séparent en fonction de leur densité et on obtient des bandes), la bande de densité à laquelle les rétrovirus sont piégés (cela varie légèrement en fonction de la substance utilisée pour fabriquer les gradients), doit être soigneusement analysée. Les tests consistent en ce qui suit :
« Essais pour les virus tumoraux à ARN
Physiques
- Microscopie électronique
- Comptage des virus
- Morphologie
- Pureté
Biochimiques
- Transcriptase inverse
- 60-70S ARN, ARN total
- Protéines totales
- Analyse sur gel des protéines et des acides nucléiques du virus et de l’hôte
Immunologiques
- Diffusion du gel
- Fixation du complément*
- Immunofluorescence*
Biologiques
- Infectivité in vivo
- Infectivité in vitro
* Infectivité avec des réactifs spécifiques pour les antigènes internes et enveloppés gs et env ». (12)
(La transcriptase inverse est une enzyme découverte pour la première fois dans les oncovirus en 1970 (13), d’où leur nom actuel de rétrovirus, et l’ARN 60-70S, l’ARN « viral ». Les rétrovirus sont parfois appelés virus tumoraux à ARN, car leur génome est constitué d’ARN et non d’ADN).
Ainsi, la méthode spécifiée à l’Institut Pasteur en 1972 n’est pas différente de celle discutée par JW Beard deux décennies plus tôt. En effet, la méthode est la logique de base appliquée à la définition d’un virus. Il est impossible de prétendre qu’une protéine ou un ARN sont rétroviraux si l’on n’a pas d’abord prouvé qu’ils sont les constituants d’une particule et que cette particule est infectieuse. Comme on le voit, la première étape est l’examen au microscope électronique pour prouver que la bande contient des particules ayant les caractéristiques morphologiques des rétrovirus et, comme l’ont souligné Françoise Barre-Sinoussi et Jean Claude Chermann lors de la réunion de Pasteur, que la bande est pure, c’est-à-dire qu’elle ne contient rien d’autre que des particules « sans différences apparentes d’aspect physique » (14).
La deuxième étape de l’analyse du matériel de 1,16 g/ml consiste à prouver que les particules sont capables de transcrire de manière inverse l’ARN en ADN. Cependant, comme Gallo lui-même l’a signalé, la découverte de particules, même celles contenant de la transcriptase inverse, est une preuve insuffisante pour prouver qu’une particule est un rétrovirus. La preuve complète dépend d’expériences visant à :
- (a) obtenir des particules d’une culture qui sont séparées de tout le reste (isolées) et montrer que les particules contiennent des protéines et de l’ARN, mais pas d’ADN et que les protéines sont codées par l’ARN (le génome viral) ;
- (b) montrer que lorsque les particules sont introduites dans une culture de cellules non infectées, les particules pénètrent dans les cellules, l’ARN des particules est transcrit de manière inverse en ADN qui est incorporé dans l’ADN cellulaire ;
- (c) montrer que ces cellules produisent à leur tour des particules de type rétroviral ;
- (d) montrer que les particules produites par ces cellules contiennent des protéines et de l’ARN qui sont identiques à ceux des particules originales introduites dans les cellules ;
- (e) montrer que des cultures cellulaires identiques à celles dans lesquelles les particules de type rétroviral ont été introduites ne produisent pas de telles particules lorsqu’elles sont cultivées exactement dans les mêmes conditions, mais qu’au lieu des particules rétrovirales on introduit un autre matériel de culture tel que des microvésicules cellulaires.
En effet, contrairement à tout autre agent infectieux, toutes les cellules contiennent des génomes rétro viraux qui, dans des conditions appropriées, peuvent être exprimés en culture. C’est-à-dire qu’ils peuvent conduire à l’apparition de rétrovirus connus sous le nom de rétrovirus endogènes. Il s’ensuit que tant les cellules de la culture à partir de laquelle les particules originales ont été obtenues que la culture dans laquelle elles ont été introduites peuvent libérer des particules rétrovirales identiques, même si les particules qui ont été introduites n’étaient pas infectieuses. Il est donc absolument impératif de disposer de contrôles appropriés.
Ainsi, pour prouver l’existence d’un rétrovirus, il faut isoler et analyser deux fois les particules de type rétroviral. La première fois pour obtenir et analyser les constituants des particules libérées dans la première culture. La seconde fois, pour prouver que les particules libérées, le cas échéant, par la cellule dans la seconde culture, sont identiques aux particules ancestrales. La mise en garde cruciale de cette procédure est l’utilisation de techniques expérimentales pour contrôler les effets de la coculture, des agents chimiques et des nombreux autres facteurs qui peuvent eux-mêmes induire des phénomènes rétroviraux indépendamment de l’infection rétrovirale exogène. (15-17)
En conclusion, au début des années 1980, les rétrovirologues étaient d’accord pour dire que pour prouver l’existence des rétrovirus, il fallait d’abord isoler (purifier) les particules candidates et la méthode pour y parvenir était le marquage par bande en gradient de densité.
Résumé de l’article de Montagnier et de ses collègues dans Science 1983
En 1983, Luc Montagnier et ses collègues de l’Institut Pasteur ainsi que d’autres chercheurs français ont publié un article qui est considéré comme la première étude dans laquelle l’existence du « VIH » a été prouvée. L’article est intitulé « Isolement d’un rétrovirus T-lymphotrope chez un patient à risque pour le Syndrome d’Immunodéficience Acquise » (SIDA) (18) avec comme principale auteure Françoise Barre-Sinoussi et Jean Claude Chermann comme second auteur. La prétention des auteurs d’avoir isolé un rétrovirus et donc prouvé son existence était basée sur les expériences suivantes :
- Des lymphocytes provenant des ganglions lymphatiques de deux patients atteints de lymphadénopathies ainsi que des cellules mononucléaires du sang périphérique de ces patients « ont été placés dans un milieu de culture contenant de la phytohémagglutinine (PHA), un facteur de croissance des cellules T (TCGF) et un antisérum contre l’interféron humain a »… Dans le système de la souris, nous avions précédemment montré que l’antisérum contre l’interféron pouvait augmenter la production de rétrovirus par un facteur de 10 à 50“. Les surnageants ont été régulièrement testés pour l’activité de la transcriptase inverse (RT) en utilisant l’amorce synthétique du modèle An.dT12-18. « Après 15 jours de culture, une activité de transcriptase inverse a été détectée dans le surnageant de culture du ganglion lymphatique » d’un des patients, le premier. (Le niveau d’activité n’est pas indiqué.) « Les lymphocytes du sang périphérique cultivés de la même manière étaient systématiquement négatifs pour l’activité de la transcriptase inverse, même après 6 semaines ». Les deux cultures du second patient l’étaient aussi. Apparemment, la détection de l’activité RT (NdT : RT pour transcriptase inverse) a été considérée comme une preuve de l’infection par un rétrovirus.
- Des lymphocytes provenant d’un donneur de sang adulte sain ont été mis en culture (conditions de culture non précisées) et, après trois jours, la moitié de la culture a été mise en coculture avec des lymphocytes provenant de la culture du patient chez qui la RT a été détectée. (Conditions non précisées.) « Une activité de transcriptase inverse a pu être détectée dans le surnageant au jour 15 des cocultures » (le niveau d’activité n’est pas indiqué), mais pas dans la culture du donneur de sang. (Il n’est pas mentionné si les conditions de la culture du donneur de sang étaient les mêmes que celles de la coculture. Cependant, il est évident que les cellules du donneur de sang n’ont pas été mises en coculture avec des lymphocytes provenant de ganglions lymphatiques de patients qui n’étaient pas exposés au risque de SIDA, mais qui présentaient par ailleurs des anomalies cliniques et de laboratoire similaires à celles du patient numéro un. Étant donné que la coculture entraîne l’apparition de rétrovirus endogènes, il s’agit d’une omission importante dans le protocole expérimental).
- Des lymphocytes normaux de cordon ombilical ont été cultivés pendant trois jours (conditions de culture non indiquées), après quoi les surnageants de la coculture et le polybrène ont été ajoutés. « Après une période de latence de 7 jours, un titre relativement élevé d’activité de transcriptase inverse a été détecté ». (En fait, l’activité était relativement faible, pas plus de 8000 coups/minute. Une activité de fond aussi élevée que 4000 comptes/min a été rapportée.(19) Les « cultures identiques » auxquelles on n’a pas ajouté de surnageant sont restées négatives. (Puisqu’aucun surnageant n’a été ajouté, les cultures ne pouvaient pas être identiques. Étant donné que le surnageant de cultures non infectées ajouté à des cellules normales non infectées entraîne l’apparition de rétrovirus endogènes, il s’agit également d’une différence significative). Commentant les résultats des trois expériences, les auteurs ont écrit : « Ces deux infections successives montrent clairement que le virus peut être propagé sur des lymphocytes normaux provenant de nouveau-nés ou d’adultes ». Les données des trois expériences ont apparemment été considérées comme une preuve d’« isolement », mais « le fait que ce nouvel isolat était un rétrovirus a été confirmé par sa densité dans un gradient de saccharose, qui était de 1,16 ».
- Les preuves fournies par les gradients de saccharose étaient constituées de deux parties.
- (a) le surnageant des lymphocytes du sang de cordon ombilical dans lesquels l’activité de la RT a été détectée a été mis en bande dans les gradients de densité de saccharose. L’activité RT maximale a été signalée à la bande de 1,16 g/ml
- (b) à la culture de lymphocytes de sang de cordon dans laquelle l’activité RT a été détectée, on a ajouté de la méthionine [35S], c’est-à-dire de la méthionine radioactive, un acide aminé qui est incorporé dans les chaînes de protéines en croissance et dont la radioactivité permet de détecter ces protéines. Deux types d’expériences ont été réalisées avec cette culture, l’une avec les cellules et l’autre avec le surnageant :
- (i) un extrait cellulaire a été lysé (cassé) et centrifugé. On a ajouté à des parties du surnageant cellulaire divers sérums (contenant des anticorps) et les protéines ont été électrophorisées (séparées à l’aide d’un champ électrique) sur un gel de polyacrylamide-SDS. On a constaté que de nombreuses protéines réagissaient, non seulement avec les sérums des deux patients atteints de lymphadénopathies multiples, mais aussi avec les sérums d’un donneur sain et d’une chèvre normale.
- (ii) le surnageant de culture a été bandé dans un gradient de densité de saccharose. Bien qu’il ne soit pas fait mention d’études de ME (NdT : Microscopie Électronique) de la bande de 1,16 g/ml, il a été affirmé que cette bande représentait « le virus purifié et marqué du patient 1 ». La bande de 1,16 g/ml a réagi avec les sérums des deux patients ainsi que de deux donneurs de sang sains et a été traitée de la même manière que l’extrait cellulaire. Bien que dans les manuscrits publiés, il soit pratiquement impossible de distinguer les protéines réagissant avec n’importe quel sérum, même avec les sérums des deux patients, il est indiqué dans le texte que “lorsque le virus purifié et marqué [la bande de 1,16 g/ml] a été analysé [a réagi avec les sérums], trois protéines principales ont pu être observées : la protéine p25 et les protéines de poids moléculaire 80 000 et 45 000. La protéine 45K peut être due à la contamination du virus par l’actine cellulaire qui était présente dans les immunoprécipitations de tous les extraits cellulaires.” (Les études de ME de la culture des lymphocytes du sang de cordon « ont montré des particules immatures caractéristiques avec un bourgeonnement dense en forme de croissant (type C) au niveau de la membrane plasmique… Le virus est un virus tumoral à ARN de type C typique ».
INTERVIEW DE LUC MONTAGNIER
Luc Montagnier a-t-il découvert le VIH ?
Par Djamel Tahi
Continuum Hiver 1997
Article d’une interview en vidéo réalisée à l’Institut Pasteur en juillet 1997.
Commentaires par le groupe de Perth sur les réponses de Montagnier
DT : Un groupe de scientifiques australiens affirme que personne jusqu’à présent n’a isolé le virus du SIDA, le VIH. Pour eux, les règles d’isolement des rétrovirus n’ont pas été soigneusement respectées pour le VIH. Ces règles sont les suivantes : culture, purification du matériel par ultracentrifugation, photographies au microscope électronique (ME) du matériel qui présente des bandes à la densité du rétrovirus, caractérisation de ces particules, preuve de l’infectivité des particules.
LM : Non, ce n’est pas de l’isolement. Nous avons fait de l’isolement parce que nous avons « transmis » le virus, nous avons fait une culture du virus. Par exemple, Gallo a dit : “Ils n’ont pas isolé le virus… et nous (Gallo et coll.), nous l’avons fait émerger en abondance dans une lignée cellulaire immortelle”. Mais avant de le faire émerger dans des lignées cellulaires immortelles, nous l’avons fait émerger dans des cultures de lymphocytes normaux provenant d’un donneur de sang. C’est cela le principal critère. On avait quelque chose que l’on pouvait transmettre en série, que l’on pouvait maintenir. Et caractérisé comme un rétrovirus non seulement par ses propriétés visuelles, mais aussi biochimiques, l’activité RT (transcriptase inverse) qui est vraiment spécifique des rétrovirus. Nous avons également eu les réactions des anticorps contre certaines protéines, probablement les protéines internes. Je dis probablement par analogie avec la connaissance d’autres rétrovirus. On n’aurait pas pu isoler ce rétrovirus sans connaître d’autres rétrovirus, c’est évident. Mais je crois que nous avons répondu aux critères d’isolement. Complètement.
1. Si “la culture, la purification du matériel par ultracentrifugation, les photographies au microscope électronique (ME) du matériel qui présente une bande à la densité du rétrovirus, la caractérisation de ces particules, la preuve de l’infectivité des particules” n’est pas un isolement, alors pourquoi Montagnier et ses collègues ont-ils prétendu en 1983 avoir isolé le « VIH » en effectuant ou en prétendant avoir effectué toutes ces procédures sauf une (pas de photographies ME du matériel présentant une bande) ? Pourquoi, dans l’article de 1984 où ils revendiquent le premier isolement du « VIH » chez les hémophiles, ainsi que dans leurs autres études de la même année dans lesquelles ils revendiquent également l’isolement du « VIH », ont-ils effectué ou prétendu avoir effectué toutes ces étapes sauf une ? (20-21) Pourquoi dans leur étude intitulée “Caractérisation de l’ADN polymérase dépendant de l’ARN d’un nouveau rétrovirus lymphotrope T humain (virus associé aux lymphadénopathies) ‘(22) ont-ils déclaré que le virus avait été ‘purifié sur gradient de saccharose en utilisant la centrifugation isopycnique (8)’ ? La référence 8 est l’article présenté par Sinoussi et Chermann au Symposium Pasteur de 1972, où ils ont souligné l’importance de montrer que le matériel bandé ne contenait rien d’autre que des particules « sans différences apparentes d’apparence physique » (14).
2. La découverte de tout ou partie des phénomènes décrits par Montagnier ne constitue pas une preuve d’isolement. Ces phénomènes ne peuvent être considérés que comme une preuve de la détection virale et alors, si et seulement si, ils sont spécifiques aux rétrovirus. Le mot « isolement » est dérivé du latin « insulatus » qui signifie « transformé en île ». Il désigne l’action de séparer un objet de toutes les matières étrangères qui ne sont pas cet objet. Ici, l’objet d’intérêt est une particule rétrovirale. Les mots « isolement » et « passage » ont des significations différentes et distinctes. « Isolement » signifie obtenir un objet, une particule rétrovirale par exemple, séparé de tout le reste. « Passage » signifie transférer un objet (qui peut être isolé ou non) d’un endroit à un autre, par exemple d’une culture à une autre. Par conséquent, même si l’on suppose que le « quelque chose » que Montagnier et ses collègues ont fait passer d’une culture à une autre en transférant des cellules ou des surnageants de culture était un rétrovirus, et qu’il a été transmis à un nombre infini de cultures successives, cela ne constitue toujours pas une preuve d’isolement. Par exemple, si l’on dispose d’une série de bouteilles contenant de l’eau et que l’on ajoute un colorant dans la première, que l’on prélève une partie de la première et qu’on la met dans la deuxième, que l’on fait passer un échantillon de la deuxième dans la troisième et ainsi de suite, il est clair que cette procédure n’a pas permis d’isoler le colorant de l’eau. Une culture contient une myriade de choses et n’est donc pas, par définition, une preuve de l’isolement d’un objet. La seule façon d’affirmer que l’on a « fait une culture du virus » est d’avoir eu la preuve de l’existence du virus avant de faire une culture. La seule chose que Montagnier et ses collègues ont prouvée est l’émergence dans la coculture avec des « lymphocytes d’un donneur de sang » d’une activité RT. La détection d’une enzyme dans une culture, même si elle est spécifique aux rétrovirus, n’est pas une preuve d’isolement. Par exemple, la mesure d’enzymes cardiaques ou hépatiques dans des cas d’infarctus du myocarde ou d’hépatite respectivement ne peut être interprétée comme un « isolement » du cœur ou du foie. La découverte dans la culture de particules ayant les caractéristiques morphologiques d’un rétrovirus et d’une activité de transcriptase inverse, soit dans la culture, soit dans la bande 1,16 g/ml, même si elle est « réellement spécifique des rétrovirus », ne constitue pas une preuve d’isolement rétroviral. Même si Montagnier et ses collègues savaient à l’avance que certaines des protéines présentes dans la culture ou dans la bande de 1,16 g/ml étaient rétrovirales, et que les patients avaient des anticorps rétroviraux qui réagissaient avec ces protéines, une telle réaction n’est pas une preuve de l’isolement. Les arguments fondés sur des analogies, ou même sur la connaissance d’autres rétrovirus ne peuvent être considérés comme des preuves de l’isolement. Par exemple, observer quelque chose dans l’océan qui ressemble à un poisson (même si c’est un poisson) n’équivaut pas à ce que le poisson dans votre poêle à frire soit séparé de tout ce qui se passe dans l’océan.
3. Nous sommes d’accord avec Gallo pour dire que Montagnier et coll. (NdT : et ses collègues) n’ont pas présenté de preuve de « l’isolement véritable » d’un rétrovirus, de n’importe quel rétrovirus, ancien ou nouveau, exogène ou endogène.
4. La « connaissance d’autres rétrovirus » montre que les particules présentant une activité RT et des « propriétés visuelles de rétrovirus » ne sont pas tous des virus. C’est un fait reconnu même par Gallo, bien avant l’ère du SIDA. (23) Cela montre également que la RT n’est pas « vraiment spécifique des rétrovirus ». Les cellules non infectées ainsi que les bactéries ou les virus autres que les rétrovirus possèdent la RT. Selon certains des rétrovirologues les plus connus, y compris ses découvreurs, ainsi que le lauréat du prix Nobel et directeur de l’Institut National de la Santé (NdT : en anglais le National Institute of Health ou NIH) américain, Harold Varmus, les transcriptases inverses sont présentes dans toutes les cellules, y compris les bactéries. (13,24-25) En effet, l’activité de la transcriptase inverse a été signalée dans de nombreuses lignées cellulaires à partir desquelles le « VIH » est « isolé », notamment H9 et CEM, ainsi que dans des lymphocytes normaux, même s’ils ne sont pas infectés par le « VIH ».(26-27) Montagnier, Barre-Sinoussi et Chermann ont eux-mêmes montré que l’activité de la transcriptase inverse n’est pas spécifique aux rétrovirus. Dans leur article de 1972, Barre-Sinoussi et Chermann écrivent : « Il y avait une activité significative dans la zone d’échantillonnage et le pic de sédimentation le plus rapide, constitué principalement de débris cellulaires. Cette activité enzymatique peut s’expliquer par la présence de quelques particules virales dans ces régions, et, comme une activité polymérase similaire a été trouvée dans des cellules normales, elle peut être principalement attribuée à l’enzyme cellulaire ». Dans cette interview, Luc Montagnier répondant à la question 14 dit : « Par exemple, un jour j’avais un pic très fin de RT, que F Barre-Sinoussi m’a donné, avec une densité un peu plus élevée, 1,19 et j’ai vérifié ! C’était un mycoplasme, pas un rétrovirus ». Comment est-il alors possible pour Montagnier de dire que la RT est spécifique des rétrovirus ? Nous sommes d’accord pour dire que l’activité RT est caractéristique des rétrovirus. Cependant, « spécificité » n’a pas le même sens que « caractéristique ». Les cheveux sont caractéristiques des êtres humains, mais tous les animaux avec des cheveux ne sont pas des humains.
5. Isoler signifie obtenir un objet séparé de tout le reste. Les rétrovirus sont des particules et aucune « analogie » ne peut prouver que l’on a isolé une particule rétrovirale. La « connaissance d’autres rétrovirus » peut être utile pour choisir la meilleure méthode pour obtenir l’isolement. La « connaissance des autres rétrovirus » montre que la meilleure méthode, mais en aucun cas la méthode parfaite, pour isoler et prouver l’existence d’un rétrovirus, est de réaliser un marquage isopycnique (densité identique de la particule et de la partie du gradient) et de réaliser tous les tests spécifiés au symposium Pasteur de 1972. La « connaissance d’autres rétrovirus » montre également qu’il n’y a rien de spécifique concernant la morphologie des particules rétrovirales, les réactions protéine-anticorps ou même le banding (NdT : de produire une bande dans le tube centrifugé) à la densité de 1,16 g/ml dans les gradients de densité de saccharose. Les particules rétrovirales se regroupent dans la bande de densité de 1,16 g/ml, mais tout ce qui se trouve à cette densité, y compris les particules ayant la morphologie des particules rétrovirales, n’est pas un rétrovirus (11-13,28). Pour s’en convaincre, il suffit de considérer le « premier » rétrovirus humain, « HL23V ».
Au milieu des années 1970, Gallo et ses collègues ont rapporté l’isolement du premier rétrovirus humain. En fait, les preuves de l’isolement du « HL23V » ont surpassé celles de Montagnier et coll. et celles de tous les autres pour le « VIH » » dans au moins trois aspects importants. Contrairement au « VIH », dans le cas du « HL23V », le groupe de Gallo :
- (a) a rapporté la détection de l’activité RT dans des leucocytes frais, non cultivés ;
- (b) n’a pas eu besoin de stimuler ses cultures cellulaires avec divers agents. (Montagnier et Gallo admettent tous deux qu’aucun des phénomènes qui, selon eux, prouvent l’existence du « VIH » ne peut être détecté si les cultures ne sont pas stimulées par plusieurs agents) ;
- (c) a publié une micrographie électronique de particules de type viral groupées à une densité de saccharose de 1,16 g/ml. (23-29)
Cependant, aujourd’hui, personne, pas même Gallo, ne considère « HL23V » comme le premier rétrovirus humain ou même comme un rétrovirus. (Pour une discussion plus détaillée, voir Papadopulos-Eleopulos et coll. (30-32)). Il ne faut pas non plus oublier les connaissances supplémentaires suivantes concernant les rétrovirus :
- (a) la leçon de l’enzyme adénosine triphosphate. Comme la RT, cette enzyme était considérée comme spécifique des rétrovirus et, au moins dans les années 1950, elle était utilisée non seulement pour leur détection et leur caractérisation, mais aussi pour leur quantification.(8-11) Pourtant, il est actuellement admis qu’il s’agit de l’une des enzymes les plus répandues.
- (b) un pourcentage beaucoup plus élevé de sérums de malades du SIDA et de personnes à risque réagit avec les protéines des rétrovirus endogènes que les sérums de personnes saines, 70 % contre 3 %.(33)
DT : Je reviens sur les règles d’isolement des rétrovirus qui sont : culture, purification à la densité de rétrovirus, photographies ME du matériel à la densité de rétrovirus, caractérisation des particules, preuve de l’infectivité des particules. Toutes ces étapes ont-elles été réalisées pour l’isolement du VIH ? J’aimerais ajouter que, selon plusieurs références publiées citées par le groupe australien, la RT n’est pas spécifique aux rétrovirus et, de plus, votre travail de détection de la RT n’a pas été fait sur le matériel purifié ?
LM : Je crois que nous avons publié dans Science (mai 1983) un gradient qui montrait que la RT avait exactement la densité de 1,16. On avait donc un pic qui était RT. On a donc rempli ce critère de purification. Mais il est difficile de le transmettre en série parce que lorsque vous mettez le matériel en purification, dans un gradient, les rétrovirus sont très fragiles, donc ils se cassent entre eux et perdent grandement leur infectivité. Mais je pense que malgré cela, nous avons pu conserver un peu de leur infectivité. Mais ce n’était pas aussi facile que ce que l’on fait aujourd’hui, car les quantités de virus étaient tout de même très faibles. Au début, nous sommes tombés sur un virus qui ne tuait pas les cellules. Ce virus provenait d’un patient asymptomatique et a donc été classé parmi les virus non syncytia (NdT : La formation de syncytia ou de cellules géantes multinucléées est, selon la version des tenants de l’hypothèse virale, l’un des principaux effets cytopathiques induits par l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)),virus non cytopathogènes qui utilisent le corécepteur ccr5. Il s’agissait du premier virus BRU. On en avait très peu, et on ne pouvait pas le transmettre dans une lignée cellulaire immortelle. Nous avons essayé pendant quelques mois, nous n’avons pas réussi. Nous avons réussi très facilement avec la deuxième souche. Mais il y a le problème assez mystérieux de la contamination de cette seconde souche par la première. C’était le LAI.
1. Il est vrai que Montagnier et ses collègues ont trouvé un pic d’activité RT à la densité de 1,16 g/ml. Cependant, le fait de trouver ce pic ne prouve pas que la bande était constituée de particules de rétrovirus, pures ou impures. Cette preuve ne peut donc pas être considérée comme « ayant rempli ce critère de purification ».
2. Dans le même numéro de Science où Montagnier et ses collègues ont publié leur étude, Gallo a souligné que « l’enveloppe virale qui est nécessaire à l’infectivité est très fragile, elle a tendance à se détacher lorsque le virus bourgeonne des cellules infectées, rendant ainsi les particules incapables d’infecter de nouvelles cellules ». Pour cette raison, Gallo a affirmé que « le contact cellule à cellule peut être nécessaire pour l’infection rétrovirale ».(34) Actuellement, tous les experts du « VIH » s’accordent à dire que la gp120 est absolument nécessaire pour l’infectivité du « VIH ». En 1993, Montagnier lui-même a déclaré que pour que les particules du « VIH » soient infectieuses, elles doivent d’abord se lier au récepteur cellulaire CD4 et que « la gp120 est responsable de la liaison avec le récepteur CD4 ».(35-36) Cependant, à ce jour, personne n’a publié de ME de particules acellulaires ayant la dimension de particules rétrovirales et aussi de boutons (NdT : protubérances), de spikes (NdT : de pointes), c’est-à-dire de gp120, pas même Hans Gelderblom et ses collègues de l’Institut Koch de Berlin qui ont mené les études les plus détaillées de microscopie électronique des particules présentes dans des cultures/cocultures contenant des tissus dérivés de patients atteints du SIDA. Dans l’une de leurs dernières publications où cette question est abordée, ils estiment qu’immédiatement après avoir été libérées, les « particules de VIH » possèdent en moyenne 0,5 bouton par particule, mais soulignent également qu’« il était possible que des structures ressemblant à des boutons soient observées même en l’absence de gp120, c’est-à-dire des faux positifs ».(37)
Cela signifie que ni Montagnier et ses collègues, ni personne d’autre par la suite, n’ont pu infecter les cultures avec des cellules de donneurs sains, des lymphocytes de cordon ombilical ou toute autre culture avec le « VIH purifié » ou, même les fluides sans cellules (le surnageant de culture) même si le virus « purifié » ne contenait rien d’autre que des particules. En d’autres termes, il est impossible que Montagnier et ses collègues aient eu une quelconque infectivité, ne serait-ce qu’une « petite » (NdT : infectivité), avec le surnageant de culture ou le « virus étiqueté purifié ». Pour la même raison, la « deuxième souche » n’a pas pu être contaminée par « la première ». En outre, puisque Montagnier et coll. ont fourni à Gallo des surnageants exempts de cellules, il aurait été impossible que les cultures de Gallo soient contaminées par le BRU (NDT BRU étant le nom du patient, un styliste de mode parisien, duquel l’équipe de Montagnier a obtenu le rétrovirus « VIH »), le LAI (NdT : idem avec un patient nommé LAI) ou un mélange.
3. Le virus de Montagnier ne provenait pas « d’un patient asymptomatique », mais d’un patient présentant « une lymphadénopathie et une asthénie ». Ni dans leur étude, ni même aujourd’hui, après près de quinze ans de « VIH », il n’y a de preuve de l’existence d’un rétrovirus humain ayant la capacité de « tuer les cellules ». L’étude qui est actuellement la plus souvent citée comme prouvant que le « VIH » tue les cellules T4 considérées comme la « marque de fabrique » du SIDA, a été publiée en 1984 par Montagnier et ses collègues. Ils ont cultivé des cellules CD4+ (T4) provenant d’un patient hémophile qui était « porteur asymptomatique du virus », « en présence de phytohémagglutinine (PHA) suivie d’IL-2 ». Dans la culture, ils ont détecté une activité RT et des « particules virales caractérisées par un petit noyau excentrique ». Le nombre de cellules T4 (CD4+) dans la culture a été mesuré en comptant le nombre de cellules capables de se lier à un anticorps monoclonal spécifique de la protéine CD4. Le nombre de cellules capables de le faire a diminué avec le temps. En discutant de leurs résultats, ils ont écrit : « Ce phénomène intrigant peut être dû à une modulation induite par le virus au niveau de la membrane cellulaire, ou à un obstacle stérique au site de liaison de l’anticorps », c’est-à-dire que la diminution n’est pas due à la destruction des cellules. (38-39)
Compte tenu de leurs données, la conclusion selon laquelle la diminution des cellules T4 n’est pas due à la destruction des cellules n’est pas surprenante. En revanche, leur conclusion selon laquelle l’effet pourrait être induit par le « virus » est surprenante. Montagnier et ses collègues connaissaient les preuves expérimentales qui montraient que dans certaines conditions (y compris l’exposition au PHA, à l’IL-2 et à d’autres agents oxydants), une diminution des cellules T4 apparaît en l’absence du VIH. Dans ce type de culture, les cellules T perdent leur marqueur CD4 et acquièrent d’autres marqueurs, dont le CD8, alors que le nombre total de cellules T reste constant. (40-43) De plus, ils avaient la preuve que dans les « cellules infectées », ce phénomène ne peut être détecté à moins que la culture ne soit stimulée par des substances telles que la PHA ou des antigènes. (Protéines telles que les protéines « non VIH » présentes dans les cultures « infectées ». (39) Compte tenu de ce qui précède, il est encore plus surprenant que Montagnier et ses collègues n’aient pas disposé de contrôles (NdT : n’ont pas fait d’expériences de contrôle), c’est-à-dire de cultures de cellules T4 provenant de patients qui ne risquaient pas de contracter le SIDA, mais qui étaient néanmoins malades et auxquelles ils ont ajouté de la PHA et de l’IL-2. De telles expériences ont été rapportées en 1986 par Gallo et ses collègues. Ils ont présenté des données sur trois cultures cellulaires qui contenaient 34 % de cellules CD4 au départ : Une culture était « infectée » et stimulée par la PHA, une autre n’était pas infectée, mais était stimulée par la PHA et la troisième n’était ni infectée ni stimulée. Après deux jours de culture, la proportion de cellules CD4+ dans la culture stimulée -non infectée et stimulée-infectée était respectivement de 30 % et 28 %, tandis qu’après 6 jours, leur nombre était de 10 % et 3 %. Le nombre de cellules CD4+ n’a pas changé de manière significative dans la culture non infectée non stimulée. (44)
En 1991, Montagnier et ses collègues ont réalisé des expériences sur des cellules non infectées et non stimulées pour étudier l’apoptose induite par le « VIH », qui était considérée (et l’est encore par beaucoup) comme le principal mécanisme par lequel le « VIH » tue les cellules. Ils ont montré que dans les cultures de cellules CEM « infectées par le VIH » en présence d’un agent d’élimination des mycoplasmes, la mort cellulaire (apoptose) est maximale 6 à 7 jours après l’infection, « alors que la production maximale de virus a eu lieu aux jours 10 à 17 », c’est-à-dire que l’effet maximal a précédé la cause maximale. Dans les cellules CEM « infectées » de façon chronique et dans la lignée cellulaire monocytique U937, aucune apoptose n’a été détectée bien que « ces cellules produisent continuellement du virus infectieux ». Dans les lymphocytes CD4 isolés d’un donneur normal, stimulés avec du PHA et « infectés par le VIH » en présence d’IL-2, l’apoptose devient détectable 3 jours après l’infection et clairement apparente après 4 jours. « De façon intrigante, au cinquième jour », l’apoptose est devenue détectable dans les cellules « non infectées » stimulées par le PHA. Ils ont conclu : « Ces résultats démontrent que l’infection par le VIH des cellules mononucléaires du sang périphérique conduit à l’apoptose, un mécanisme qui pourrait également se produire en l’absence d’infection à cause d’un traitement mitogène de ces cellules ».(45) En conclusion, toutes les données actuellement disponibles montrent que l’« infection par le VIH » en l’absence d’agents stimulants ne diminue pas le nombre de cellules T4, ni n’induit l’apoptose, tandis que les agents stimulants (semblables à ceux auxquels sont exposés les patients à risque de développer le SIDA) le font en l’absence de « VIH ». En d’autres termes, ni le « VIH » sur lequel Montagnier et ses collègues ont « trébuché » au début, ni aucun autre « VIH » depuis lors n’a été démontré comme « tuant les cellules ».
DT : Pour quelle raison les photographies de ME que vous avez publiées proviennent-elles de la culture et non de la purification ?
LM : La production de virus était si faible qu’il était impossible de voir ce que pouvait contenir un concentré de virus à partir d’un gradient. Il n’y avait pas assez de virus pour le faire. Bien sûr, on l’a cherché, on l’a cherché dans les tissus au début, de même dans la biopsie. Nous avons vu quelques particules, mais elles n’avaient pas la morphologie typique des rétrovirus. Elles étaient très différentes. Relativement différentes. Donc avec la culture, il a fallu de nombreuses heures pour trouver les premières images. C’était un effort de Romain ! C’est facile de critiquer après coup. Ce que nous n’avions pas, et je l’ai toujours reconnu, c’est que c’était vraiment la cause du SIDA.
Les rétrovirus ne sont pas des notions ésotériques, nucléaires ou cosmologiques dont l’existence postulée ne peut être déduite que par des observations indirectes. Ce sont des particules que l’on peut voir, même si ce n’est pas à l’œil nu. Puisque Montagnier et ses collègues admettent ne pas avoir vu de particules à la bande de 1,16 g/ml ayant la morphologie d’un rétrovirus, affirmer la présence d’un rétrovirus et encore moins la présence d’un « virus purifié » est totalement infondé et défie toute croyance. La bande de 1,16 g/ml peut être comparée à un filet de pêche. La différence est que la bande piège les objets en fonction de leur densité et non de leur taille. Imaginez un pêcheur qui voit dans l’océan de nombreux objets différents, dont certains peuvent être des poissons. Il jette le filet, attend, et lorsqu’il récupère le filet, il procède à un examen approfondi de son contenu et montre qu’il contient de nombreuses créatures marines, mais rien qui ressemble à un poisson. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, il affirme avoir attrapé un poisson. En fait, il affirme que le filet ne contient rien d’autre que du poisson.
DT : Comment est-il possible, sans les images de ME de la purification, de savoir si ces particules sont virales et appartiennent à un rétrovirus, qui plus est un rétrovirus spécifique ?
LM : Eh bien il y avait les images de bourgeonnement. Nous avons publié des images de bourgeonnement qui sont caractéristiques des rétrovirus. Cela dit, sur la seule base de la morphologie, on ne pouvait pas dire qu’il s’agissait vraiment d’un rétrovirus. Par exemple, un spécialiste français des ME de rétrovirus m’a publiquement attaqué en disant : « Ce n’est pas un rétrovirus, c’est un arénavirus ». Parce qu’il y a d’autres familles de virus qui bourgeonnent et ont des pointes à la surface, etc.
Bien que le bourgeonnement à partir de la membrane cellulaire soit la manière dont les particules rétrovirales apparaissent, ce processus n’est pas spécifique au virus. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une particule bourgeonne et possède les caractéristiques morphologiques des particules rétrovirales qu’elle est un rétrovirus. Deux faits et la citation de deux des rétrovirologues les plus connus permettent d’illustrer ce fait : Des « particules bourgeonnantes ressemblant à des virus » ont été trouvées dans des « lignées de cellules T CEM, H9 et C8166 non infectées ; dans 2 lignées de cellules B transformées par l’EBV ; et dans des cultures de cellules lymphoïdes humaines primaires provenant du sang du cordon ombilical, qui ont été stimulées ou non par le PHA et cultivées avec ou sans sérum, et dans des lymphocytes du cordon ombilical directement après la séparation par Fico »(46) (les italiques sont de nous). À la suite d’une vaste étude in vivo menée par O’Hara et ses collègues de Harvard, des « particules de VIH » ont été trouvées chez 18/20 (90 %) des patients présentant une hypertrophie des ganglions lymphatiques attribuée au SIDA. Cependant, des particules identiques ont également été trouvées chez 13/15 (87 %) des patients présentant une hypertrophie des ganglions lymphatiques non attribuée au SIDA et ne présentant aucun risque de développer le SIDA. Ces données ont amené les auteurs à conclure que « la présence de telles particules n’indique pas, en soi, une infection par le VIH ». (47)
En 1986, Gallo et ses collègues, discutant du « Premier isolement du HTLV-III » (NdT : nom donné au « VIH » par l’équipe de Gallo), ont écrit : « Au moment où nous avons obtenu le LAV (NdT : Lymphadenopathy-Associated Virus — virus associé aux lymphadénopathies, également nom donné au « VIH »), plusieurs experts en morphologie virale étaient d’avis que les particules représentées sur la micrographie électronique publiée dans Science par Barre-Sinoussi et coll. étaient un arénavirus… Comme nous considérions que la simple détection de particules virales dans des cultures de patients atteints du SIDA et de l’ARC (NdT : AIDS-Related Complex, terme utilisé dans les premiers jours de « l’épidémie de SIDA » pour décrire les personnes qui n’avaient que des symptômes bénins de la maladie tels que des ganglions lymphatiques enflés) était insuffisante pour confirmer scientifiquement notre hypothèse selon laquelle de telles particules étaient impliquées dans l’étiologie de la maladie, nous avons décidé d’obtenir d’abord des réactifs spécifiques contre le nouveau virus afin de publier des résultats définitifs concernant l’étiologie du SIDA » ».(48) Selon Peter Duesberg, les « particules et protéines » du « VIH » pourraient tout à fait refléter du matériel non viral.(49)
DT : Pourquoi cette confusion ? Les images EM n’ont pas montré clairement un rétrovirus ?
LM : À cette époque, les rétrovirus les plus connus étaient ceux de type C, qui étaient très typiques. Ce rétrovirus n’était pas de type C et les lentivirus étaient peu connus. Je l’ai moi-même reconnu en regardant des photos du virus de l’anémie infectieuse des équidés à la bibliothèque, et plus tard du virus visna. Mais je le répète, il n’y avait pas que la morphologie et le bourgeonnement, il y avait la RT… c’est l’assemblage de ces propriétés qui m’a fait dire que c’était un rétrovirus.
Dans leur étude, Montagnier et ses collègues écrivent : « La microscopie électronique des lymphocytes du cordon ombilical infectés a montré des particules immatures caractéristiques avec un bourgeonnement dense en forme de croissant (type C) au niveau de la membrane plasmique… Ce virus est un virus tumoral à ARN de type C typique ». En 1984, Montagnier, Barre-Sinoussi et Chermann ont signalé que leur virus était « morphologiquement similaire aux particules D telles que celles trouvées dans le virus Mason-Pfizer ou le virus récemment isolé du SIDA simien ». (38) (En 1984, les chercheurs des centres de recherche sur les primates aux États-Unis ont affirmé l’existence du SIDA chez les singes et que la cause du SIDA était un rétrovirus de type D similaire au virus Mason-Pfizer, un rétrovirus de type D typique, et ont suggéré que le SIDA des singes et ces rétrovirus pourraient être utiles dans l’étude du SIDA et du « VIH » humains).
La même année, dans une autre publication, Montagnier et coll. ont affirmé que les particules « VIH » avaient « une morphologie similaire à celle du virus de l’anémie infectieuse équine (EIAV pour equine infectious anaemia virus), et des particules de type D ». Le virus EIAV et le virus visna ne sont ni des rétrovirus de type C ni des rétrovirus de type D, mais des lentivirus, c’est-à-dire des virus dont la morphologie est totalement différente et que l’on dit induire des maladies longtemps après l’infection. (Au moment où cet article a été publié, on s’est rendu compte que les patients qui avaient un test d’anticorps « VIH » positif ne développaient pas le SIDA immédiatement, c’est-à-dire qu’il y avait un délai entre le test positif et l’apparition du SIDA). Il est très étonnant que la morphologie d’un seul et même virus soit capable de changer de genre, passant d’une particule typique de type C à une particule typique de type D, puis à une sous-famille complètement différente, à savoir un lentivirus typique, apparemment à volonté. (La famille des Retroviridae est divisée en trois sous-familles, Oncovirinae, Lentivirinae et Spumavirinae. Les Oncovirinae sont à leur tour divisées en particules de type B,— C et — D. Ces résultats sont analogues à la description d’une nouvelle espèce de mammifère (homme, gorille et orang-outan).
DT : Concernant la RT, elle est détectée dans la culture. Puis il y a une purification où l’on trouve des particules rétrovirales. Mais à cette densité, il y a beaucoup d’autres éléments, dont ceux que l’on appelle « de type viral ».
LM : Exactement, exactement. Si vous voulez, ce n’est pas une propriété, mais l’assemblage des propriétés qui nous a fait dire qu’il s’agissait d’un rétrovirus de la famille des lentivirus. Prises isolément, chacune des propriétés n’est pas vraiment spécifique. C’est l’assemblage de ces propriétés. Nous avions donc : la densité, la RT, les images de bourgeonnement et l’analogie avec le virus visna. C’est cela les quatre caractéristiques.
1. En dehors des rétrovirus, d’autres particules peuvent posséder « l’assemblage de propriétés » (la densité, le RT, le bourgeonnement et l’analogie avec le virus visna). Il s’ensuit que la détection de particules possédant cet « assemblage de propriétés » n’est pas une preuve que les particules détectées sont des rétrovirus. En fait, Montagnier et ses collègues n’ont pas rapporté la détection de particules « VIH » ayant cet « assemblage de propriétés ». Puisque Montagnier et ses collègues n’ont pas pu trouver de particules ayant les caractéristiques morphologiques d’un rétrovirus à la « densité » de 1,16 g/ml, même après « un effort romain », il s’ensuit que la preuve de l’existence du « VIH » à partir du gradient de densité n’était pas seulement non spécifique, mais inexistante. (Ce seul fait suffit à écarter toute prétention de preuve de l’existence d’un rétrovirus, peu importe ce qu’ils ont trouvé d’autre n’importe où, y compris des particules bourgeonnantes de la surface cellulaire, des particules ressemblant à des rétrovirus dans la culture, des RT à la « densité » ou des protéines à la même densité qui réagissent avec les sérums des patients).
2. Il est vrai que Montagnier et coll. ont rapporté une activité RT à la densité de 1,16 g/ml, mais puisque :
- (a) Barre-Sinoussi et Chermann acceptent que les cellules et les fragments cellulaires ont aussi une activité RT ;
- (b) à la bande de 1,16 g/ml aucune particule avec les caractéristiques morphologiques du rétrovirus n’a été vue ;
- (c) à cette densité, Montagnier et coll. ont trouvé des fragments cellulaires, il s’ensuit que la preuve de l’existence du « HIV » par la détection de l’activité RT à cette densité n’était pas seulement non spécifique, mais inexistante.
Étant donné les faits que :
- (a) il existe des différences significatives dans la nature des processus de bourgeonnement entre les particules de type C, de type D et les lentivirus50 et qu’en 1983 Montagnier et coll. ont rapporté leur rétrovirus comme étant de type C et en 1984 comme étant soit de type C soit de type D, et même plus tard cette année-là comme étant EIAV ;
- (b) le virus visna et l’EIAV sont des lentivirus, il s’ensuit qu’au moins jusqu’au milieu de 1984, les preuves de Montagnier et coll. concernant l’existence du « VIH » (si le « VIH » est un lentivirus) à partir d’« images de bourgeonnement » et l’analogie avec l’EIAV et le virus visna n’étaient pas seulement non spécifiques, mais inexistantes.
DT : Mais comment tous ces éléments permettent-ils de prouver qu’il s’agit d’un nouveau rétrovirus ? Certains de ces éléments pourraient correspondre à d’autres choses, « de type viral »… ?
LM : Oui, et en plus nous avons des rétrovirus endogènes qui expriment parfois des particules — mais d’origine endogène, et qui n’ont donc pas de rôle pathologique, en tout cas pas dans le SIDA.
Nous sommes d’accord pour dire qu’il existe des rétrovirus endogènes (mais il est intéressant de noter que jusqu’en 1994 « il n’y a pas de rétrovirus endogènes humains connus »(51)). Ces rétrovirus endogènes ne peuvent être distingués des rétrovirus exogènes ni morphologiquement ni chimiquement. En outre, il existe des preuves qui montrent que 70 % des patients atteints du SIDA et des personnes à risque, contre 3 % des personnes qui ne sont pas à risque, ont des anticorps contre les rétrovirus endogènes.(33) Compte tenu de ces faits et des conditions de culture que Montagnier et ses collègues ainsi que tous les autres chercheurs sur le « VIH » utilisent pour détecter le « VIH », ainsi que des données actuellement disponibles sur le « VIH » et le SIDA, il est plus probable que le « VIH » (si son existence est prouvée) soit un rétrovirus endogène plutôt qu’un rétrovirus exogène.
Une partie des données relatives aux conditions de culture peut être résumée comme suit : en culture, les cellules commencent tôt ou tard à libérer des rétrovirus endogènes. L’apparition du rétrovirus endogène peut être accélérée et le rendement multiplié jusqu’à un million de fois en stimulant la culture avec des mitogènes, en pratiquant la co-culture ou en ajoutant au surnageant de culture des cultures cellulaires normales non stimulées. En effet, dès 1976, les rétrovirologues ont reconnu que « l’échec de l’isolement des virus endogènes de certaines espèces peut refléter les limites des techniques de coculture in vitro ». (52) Pour détecter l’« assemblage » des « quatre caractéristiques » du « VIH », Montagnier et coll. (comme tout le monde) ont utilisé au moins deux des techniques ci-dessus. En fait, Montagnier et Gallo admettent tous deux qu’aucune des quatre « caractéristiques » ne peut être détectée si les cultures ne sont pas stimulées. De même, une partie des données relatives au « VIH » et au SIDA peuvent être résumées comme suit :
(a) il est vrai que les rétrovirus endogènes peuvent ne pas avoir de rôle pathologique dans le SIDA, mais il est également vrai qu’à ce jour, il n’y a pas non plus de telle preuve pour le « VIH ». (53) Selon Montagnier et Gallo, la « marque » de l’immunodéficience dans le SIDA est la diminution des cellules T4, qui serait le résultat de la destruction des T4 par le « VIH ». Cependant, Montagnier et ses collègues admettent dès 1984 qu’au moins in vitro, la diminution observée des cellules T4 après une infection par le « VIH » n’est pas due à la destruction des cellules, mais à une diminution de la liaison de l’anticorps T4 (CD4) aux cellules. Deux ans plus tard, les expériences de l’équipe de Gallo ont prouvé sans l’ombre d’un doute que la diminution des cellules T4 (de la liaison de l’anticorps CD4) n’était pas due à l’infection par le « VIH », mais au PHA présent dans la préparation du « VIH ». Comme nous l’avons mentionné, au début de l’ère du SIDA, il a été largement prouvé que le traitement de cultures cellulaires avec du PHA et d’autres agents oxydants entraîne une diminution de la liaison de l’anticorps CD4 et une augmentation de la liaison de l’anticorps CD8, c’est-à-dire qu’une diminution des cellules T4 s’accompagne d’une augmentation des cellules T8, alors que le nombre total de cellules reste constant. Les malades du SIDA et les personnes appartenant aux groupes à risque du SIDA sont continuellement exposés à des agents oxydants puissants. Il est actuellement admis que, tant chez les malades du SIDA que chez les personnes à risque, la diminution des cellules T4 s’accompagne d’une augmentation des cellules T8, tandis que le nombre de cellules T4 + T8 reste constant. (53) Il est également intéressant de noter que dès 1985, Montagnier écrivait : « Ce syndrome (le SIDA) survient chez une minorité de personnes infectées, qui ont généralement en commun un passé de stimulation antigénique et de dépression immunitaire avant l’infection par le LAV »(54), c’est-à-dire que Montagnier reconnaissait que dans le groupe à risque du SIDA, le déficit immunitaire précède l’infection par le « VIH ». En 1984, Montagnier et ses collègues, dont Barre-Sinoussi et Chermann, ont déclaré que « pour obtenir des preuves définitives, il faudra disposer d’un modèle animal dans lequel ces virus [LAV, HTLV-III=HIV] pourraient induire une maladie similaire au SIDA ». À ce jour, aucun modèle de ce type n’existe. Néanmoins, lorsque le lauréat du prix Nobel Kary Mullis l’a poursuivi pour obtenir ne serait-ce qu’un seul article scientifique prouvant la théorie du VIH du SIDA, Montagnier lui a conseillé « Pourquoi ne cites-tu pas les travaux sur le SIV ? » (Simian immunodeficiency virus—Virus de l’immunodéficience simienne) ; (55)
(b) Contrairement aux rétrovirus endogènes qui se transmettent verticalement, le « VIH » se transmettrait horizontalement, notamment par les rapports sexuels. En effet, à l’heure actuelle, il est généralement admis que la grande majorité des individus ont été infectés par contact hétérosexuel. Selon Montagnier et Gallo, la première étude à avoir prouvé hors de tout doute que le « VIH » est un virus à transmission hétérosexuelle bidirectionnelle a été publiée en 1985 par Redfield et coll. Cependant, dans un livre publié en 1990 et intitulé AIDS and Sex, ses rédacteurs, Bruce Voeller, June Machover Reinisch et Michael Gottlieb, discutant de cette étude transversale, ainsi que d’autres études similaires, ont écrit : « des chercheurs du gouvernement ont publié des données indiquant que le personnel des forces armées américaines infecté par le VIH-1 avait attrapé le virus auprès de prostituées, ce qui a déclenché des appels à l’intensification des campagnes contre la prostitution. Lorsque les soldats infectés ont été interrogés par des chercheurs non militaires en qui ils avaient confiance, il est apparu que presque tous avaient été infectés par la consommation de drogues par voie intraveineuse ou par des contacts homosexuels, actes pour lesquels ils pouvaient être renvoyés des services armés, ce qui les empêchait d’être francs avec les chercheurs militaires initiaux. Dans chacune de ces études défectueuses publiées, les chercheurs, les rédacteurs en chef des revues et les pairs examinateurs n’ont pas corrigé les erreurs qui auraient dû être reconnues ».
Nancy Padian, du département d’épidémiologie et de biostatistique de l’université de Californie, et ses collègues, qui ont mené jusqu’à présent les études les plus approfondies sur la transmission hétérosexuelle, ont discuté l’étude de Redfield et coll. ainsi que d’autres études qui prétendaient prouver de telles transmissions, et ont écrit en 1991 : « Ces études peuvent ne pas avoir contrôlé de manière adéquate d’autres voies de transmission non sexuelles déroutantes, telles que les risques associés à la consommation de drogues par voie intraveineuse. À première vue, les cas qui semblent attribués à la transmission hétérosexuelle peuvent, après un entretien approfondi, être en fait liés à d’autres sources de risque… Comme les études sur les partenaires ne sont pas, par définition, des échantillons aléatoires, et que la plupart des résultats rapportés sont basés sur des analyses rétrospectives ou transversales, certaines études peuvent sur-sélectionner les couples dans lesquels les deux partenaires d’un couple sont infectés parce que ces couples peuvent être plus facilement identifiés, ce qui biaise les taux de transmission. En outre, il est souvent difficile d’établir la source de l’infection chez ces couples. Lorsque peu de données prospectives sont disponibles, l’enrôlement de couples monogames dans lesquels le statut sérologique du partenaire est inconnu, comme c’était le cas pour la plupart des couples de cette étude, est l’une des seules façons de contrôler ce biais ». (56) En effet, les études prospectives, aussi peu nombreuses soient-elles, ne permettent pas de prouver que le « VIH » est transmis sexuellement. (57-58)
Dans son étude de dix ans, sans conteste la plus longue et la meilleure étude de ce type, Padian (59) et ses collègues n’ont pas ménagé leurs efforts pour tenter de prouver que le « VIH » est transmis par voie hétérosexuelle. Son étude comportait deux parties, l’une transversale, l’autre prospective. Dans la première, sur 360 partenaires féminines de cas index masculins infectés, « l’infectivité constante par contact pour la transmission homme-femme a été estimée à 0,000 9 ». Les facteurs de risque de séroconversion étaient les suivants (i) les rapports sexuels anaux. (Montagnier lui-même a montré qu’un test d’anticorps positif redevient négatif et qu’un faible nombre de cellules T4 redevient normal en arrêtant les rapports anaux, ce qui signifie que le résultat positif n’est pas dû à un rétrovirus ;( 60) (ii) avoir des partenaires qui ont acquis cette infection par l’usage de drogues (Padian elle-même dit que cela signifie que les femmes peuvent aussi être des utilisatrices de drogues injectables) ; (iii) la présence chez la femme de MST. (les anticorps dirigés contre leurs agents causaux peuvent avoir une réaction croisée avec les protéines du « VIH » ; (31) Sur 82 partenaires masculins négatifs de cas index féminins positifs, seuls deux ont présenté une séroconversion. Ils ont estimé que la probabilité d’une transmission de femme à homme était 8 fois plus faible que celle d’un homme à femme. Padian elle-même a mis en doute la validité de ces deux cas. Pour le premier, elle a donné plusieurs raisons en 1991, lorsque ce cas a été rapporté pour la première fois. Pour le second cas, elle a mentionné le fait que « la transmission de la chlamydia a été simultanée ou proche de la transmission du VIH est frappante », c’est-à-dire que le test d’anticorps « VIH » positif est apparu au moment où il a été infecté par la chlamydia. (NdT : L’infection à Chlamydia (ou chlamydiose) est due à une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. C’est l’une des infections sexuellement transmissibles (IST) les plus fréquentes).
Dans l’étude prospective, qui a débuté en 1990, « nous avons suivi 175 couples sérodiscordants au fil du temps, pour un total d’environ 282 années-couple de suivi… La plus longue durée de suivi a été de 12 visites (6 ans). Nous n’avons observé aucune séroconversion après l’entrée dans l’étude… Lors du dernier suivi, les couples étaient beaucoup plus susceptibles d’être abstinents ou d’utiliser des préservatifs de façon constante… Néanmoins, seuls 75 % d’entre eux ont déclaré avoir utilisé des préservatifs de façon constante au cours des 6 mois précédant leur dernière visite de suivi ». Note : Non seulement la séroconversion n’a été rapportée que dans l’étude transversale, mais tous les cas ont été diagnostiqués avant 1990. Cependant : (i) tous les experts du « VIH » s’accordent à dire que la spécificité des kits de test utilisés à l’époque était inférieure à celle des kits utilisés aujourd’hui ; (ii) les critères de la WB (NdT : rappel — Western Blot, un des deux tests avec ELISA prétendant détecter l’infection au « VIH ») utilisés pour définir l’« infection » à l’époque ne sont pas suffisants aujourd’hui. Même si l’on accepte les données de l’étude transversale de Padian et coll., ils ont estimé que le risque pour un homme non infecté de contracter une infection par le « VIH » de sa partenaire féminine infectée par contact est de 0,000 11 (1/9000). Cela signifie qu’en moyenne, un homme ayant des rapports sexuels quotidiens avec une partenaire féminine infectée pendant seize ans (soit 6000 contacts à 365 par an), aurait une probabilité de 50 % d’être infecté. Si les rapports sexuels ont lieu en moyenne chaque semaine, il faudrait cent quinze ans pour atteindre la même probabilité. Dans ces conditions, on peut se demander comment le « VIH » pourrait devenir une épidémie à la suite d’une transmission hétérosexuelle bidirectionnelle.
DT : Mais alors, comment faire la différence ?
LM : Parce qu’on pouvait « transmettre » le virus. On a transmis l’activité RT dans de nouveaux lymphocytes. H. Nous avons eu un pic de réplication. On a gardé la trace du virus. C’est l’ensemble des propriétés qui nous a fait dire que c’était un rétrovirus. Et pourquoi nouveau ? La première question que nous a posée la Nature était : « Ne s’agit-il pas d’une contamination de laboratoire ? Ne s’agit-il pas d’un rétrovirus de souris ou d’un rétrovirus animal ? ». A cela, on pouvait répondre non ! Car nous avions montré que le patient avait des anticorps contre une protéine de son propre virus. L’assemblage est d’une logique parfaite ! Mais il est important de le prendre comme un assemblage. Si vous prenez chaque propriété séparément, elles ne sont pas spécifiques. C’est l’assemblage qui donne la spécificité.
1. Dans l’étude de Montagnier et coll. de 1983, la détection de rien d’autre qu’une activité RT dans les cultures stimulées de lymphocytes provenant d’un homosexuel masculin a été considérée comme la preuve qu’il était infecté par un rétrovirus. La mise en évidence de la même activité dans le surnageant d’une co-culture des mêmes cellules avec des lymphocytes d’un donneur de sang sain a été considérée comme la preuve du passage du rétrovirus des lymphocytes de l’homosexuel aux lymphocytes du donneur et a également été considéré comme la preuve de l’isolement du virus. Cependant, la transmission d’une activité (RT) n’est pas la même chose que la transmission d’un objet (rétrovirus).
De plus, étant donné que les lymphocytes non infectés par le « VIH » ainsi que de nombreuses bactéries et virus autres que les rétrovirus possèdent une activité de RT (l’activité de RT a été rapportée dans de nombreuses lignées cellulaires non infectées par le « VIH » utilisées pour isoler le VIH, telles que H9 et CEM, et dès 1972 dans des lymphocytes normaux stimulés par le PHA), trouver une activité de RT dans des cultures successives de lymphocytes, chacune contenant du matériel provenant de la précédente, n’est pas une preuve, même pour une activité passagère de RT. Pour illustrer ce que Montagnier et ses collègues ont fait, revenons à l’analogie du pêcheur et de son filet : supposons que le pêcheur jette son filet et attrape quelques créatures marines. Il en laisse quelques-unes dans le filet comme appât, puis le jette à nouveau. Cette fois, en plus des créatures marines, il attrape aussi des poissons. Il retire les poissons, laisse quelques créatures marines dans le filet, jette à nouveau le filet et cette fois, il attrape encore plus de poissons. Il répète la procédure plusieurs fois et à chaque fois il attrape plus de poissons. Comme Montagnier et coll. qui retirent les cellules et réutilisent les surnageants, le pêcheur retire le poisson et réutilise les créatures marines (« l’appât »). Il est clair que les poissons pris dans le filet ne sont pas les descendants de l’« appât ». Le but de l’« appât » est de créer les conditions favorables à l’apparition des poissons dans le filet. (En fait, les vrais pêcheurs passent leur vie à déterminer les bonnes conditions). Tout ce que le pêcheur « passe », c’est le moyen d’attraper le poisson, pas le poisson lui-même. De la même manière, Montagnier et coll. semblent « passer » les conditions pour générer l’activité RT, générant ainsi l’illusion de « passer » l’activité RT.
2. Avoir un pic d’activité de la RT n’est pas une preuve de la « réplication » d’un rétrovirus. Suivre la RT n’est pas la même chose que « suivre le virus ».
3. Supposons que l’on ait isolé et prouvé l’existence d’un rétrovirus dans des cultures avec des tissus provenant de l’homme. « La première question posée par » Nature est : « S’agit-il d’un rétrovirus endogène ? ». Ce n’est que lorsque l’on a la preuve qu’il ne s’agit ni d’un rétrovirus humain exogène ni d’un rétrovirus endogène que se pose la question de la « contamination du laboratoire » par des rétrovirus animaux.
4. Ce que le patient avait, c’était des anticorps qui réagissaient avec une protéine qui, dans les gradients de densité de saccharose, se regroupait à 1,16 g/ml. Étant donné qu’à cette densité, Montagnier et ses collègues n’ont pas pu trouver de particules présentant les caractéristiques morphologiques d’un rétrovirus, la preuve que cette protéine était rétrovirale était inexistante. En fait, ils n’avaient aucune preuve que la protéine était incorporée même dans des particules non rétrovirales, quelles que soient les particules présentes à cette densité.
5. Si Montagnier et ses collègues savaient d’avance d’une certaine manière que la protéine qui se liait à 1,16 g/ml et réagissait avec le sérum de l’homosexuel était la protéine d’un rétrovirus présent dans ses lymphocytes (et non dans les lymphocytes du donneur sain ou du cordon ombilical), et en même temps que les anticorps étaient dirigés contre « son propre virus », pourquoi fallait-il faire toutes ces expériences pour prouver son existence ?
DT : Mais à la densité des rétrovirus, avez-vous observé des particules qui semblaient être des rétrovirus ? Un nouveau rétrovirus ?
LM : À la densité de 1,15, 1,16, nous avions un pic d’activité RT, qui est l’enzyme caractéristique des rétrovirus.
Même s’ils étaient en présence d’une activité RT, à la densité de 1,16 g/ml, ils n’avaient aucune preuve de l’existence de particules rétrovirales et l’activité ne pouvait donc pas être considérée comme une preuve de l’existence de telles particules.
DT : Mais cela pourrait-il être autre chose ?
LM : Non… à mon avis, c’était très clair. Ce ne pouvait pas être autre chose qu’un rétrovirus de cette façon. Parce que l’enzyme que F. Barre-Sinoussi a caractérisée biochimiquement avait besoin de magnésium, un peu comme le HTLV d’ailleurs. Elle avait besoin de la matrice, du template, de l’amorce aussi qui était tout à fait caractéristique d’une RT. Ce n’était pas ouvert à la discussion. A Cold Spring Harbour en septembre 1983, Gallo m’a demandé si j’étais sûr que c’était une RT. Je le savais, F. Barre-Sinoussi avait fait tous les contrôles pour cela. Ce n’était pas simplement une polymérase cellulaire, c’était une RT. Ça ne marchait qu’avec des amorces d’ARN, ça fabriquait de l’ADN. Ça, c’était sûr.
En 1983, Montagnier, Barre-Sinoussi et Chermann et leurs collègues ont prouvé l’existence de l’enzyme transcriptase inverse « en utilisant les conditions ioniques décrites pour HTLV-I », c’est-à-dire « 5 mM Mg2+ » et « poly(A).oligo-(dT)12-18 comme modèle d’amorce ». Ces conditions et cette amorce modèle peuvent être caractéristiques des rétrovirus, mais elles ne sont pas spécifiques de la RT rétrovirale, ni même de toute autre RT. Même avant l’ère du SIDA, il était connu que cette amorce, dans les conditions utilisées par Barre-Sinoussi, Montagnier et leurs collègues, peut être transcrite non seulement par la RT, mais aussi par les ADN polymérases cellulaires. Il suffit de mentionner l’étude intitulée : « Characteristics of the RNA dependent DNA polymerase [RT] of a new human T lymphotropic retrovirus (lymphadenopathy associated virus) » (Caractéristiques de l’ADN polymérase (RT) dépendant de l’ARN d’un nouveau rétrovirus lymphotrope T humain (virus associé aux lymphadénopathies) (« HIV ») dans laquelle Montagnier, Barre-Sinoussi, Chermann et leurs collègues ont « caractérisé » la RT du « HIV ». Ils y ont utilisé les mêmes conditions ioniques qu’en 1983 et trois amorces de matrice « ADN activé », poly (A).oligo-(dT)12-18 et poly Cm .oligo-dG 12-18. Ils ont rapporté que tandis que le poly Cm .oligo-dG 12-18, « une amorce modèle spécifique à la transcriptase inverse » était transcrit uniquement par les cellules « infectées par le VIH », l’« ADN activé » et le poly (A).oligo-(dT)12-18 étaient transcrits à la fois par les cellules infectées et non infectées. 22 En d’autres termes, trouver une activité RT en utilisant l’amorce modèle An.dT12-18 n’est même pas une preuve de l’existence de la RT et encore moins de l’existence d’une RT rétrovirale.
DT : Avec les autres rétrovirus que vous avez rencontrés dans votre carrière, avez-vous suivi le même processus et avez-vous rencontré les mêmes difficultés ??
LM : Je dirais que pour le VIH, c’est un processus facile. Par rapport aux obstacles que l’on rencontre pour les autres… parce que le virus n’émerge pas, ou bien parce que l’isolement est sporadique — on y arrive une fois sur cinq. Je parle de la recherche actuelle sur les autres maladies. On peut citer le virus de la sclérose en plaques du professeur Péronne. Il m’a montré son travail il y a dix ans et il lui a fallu une dizaine d’années pour trouver une séquence génétique très proche d’un virus endogène. Vous voyez… c’est très difficile. Parce qu’il ne pouvait pas « transmettre » le virus, il ne pouvait pas le faire émerger en culture. Alors que le VIH émerge comme du chiendent. La souche LAI, par exemple, émerge comme du chiendent. C’est pour cela qu’elle a contaminé les autres.
Sans commentaire.
DT : Avec quoi avez-vous cultivé les lymphocytes de votre patient ? Avec la lignée cellulaire H9 ?
LM : Non, parce que ça n’a pas du tout fonctionné avec le H9. Nous avons utilisé beaucoup de lignées cellulaires et la seule qui pouvait le produire était les Lymphocytes Tampon.
Sans commentaire.
DT : Mais en utilisant ce genre d’éléments, il est possible d’introduire d’autres choses capables d’induire une RT et des protéines, etc.
LM : Je suis tout à fait d’accord. C’est pourquoi finalement nous n’étions pas très enthousiastes à l’idée d’utiliser des lignées cellulaires immortelles. Pour cultiver le virus en masse, d’accord, mais pas pour le caractériser, parce qu’on savait qu’on allait apporter d’autres choses. Les Japonais ont découvert des lignées cellulaires MT (MT2, MT4) qui répliquent très bien le VIH et qui, en même temps, sont transformées par le HTLV. Donc, vous avez un mélange de VIH et de HTLV. C’est une vraie soupe.
Nous sommes d’accord avec Montagnier pour dire que lorsqu’on utilise des cultures de lymphocytes infectés par des rétrovirus exogènes tels que MT2, MT4 et H9 (HUT-78), qui proviennent tous de patients atteints de « leucémie à cellules T4 adultes », censée être causée par le HTLV-I, c’est « une vraie soupe ». Cependant, étant donné l’existence de rétrovirus endogènes, lorsqu’on utilise des lymphocytes d’individus normaux et des lymphocytes de cordon ombilical, le résultat est toujours « une vraie soupe ». Peut-être une soupe différente, mais néanmoins toujours « une vraie soupe ».
DT : De plus, il n’est pas impossible que les patients soient infectés par d’autres agents infectieux ?
LM : Il pourrait y avoir des mycoplasmes… il pourrait y avoir un tas de choses. Mais heureusement que nous avions l’expérience négative des virus associés aux cancers et cela nous a aidé, parce que nous avions rencontré tous ces problèmes. Par exemple, un jour j’avais un pic de RT très fin, que F. Barre-Sinoussi m’avait donné, avec une densité un peu plus élevée, 1,19. Et j’ai vérifié ! C’était un mycoplasme, pas un rétrovirus.
Nous sommes d’accord pour dire que les patients atteints du SIDA et les personnes à risque sont infectés par un « tas de choses ». De plus, les cultures avec les tissus de ces patients peuvent, en plus de ces agents, être infectées in vitro par d’autres agents, tels que les mycoplasmes.
DT : Avec le matériel purifié à la densité du rétrovirus, comment est-il possible de faire la différence entre ce qui est viral et ce qui ne l’est pas ? Parce qu’à cette densité, il y a un tas d’autres choses, y compris des particules de « type viral », des fragments cellulaires…
LM : Oui, c’est pourquoi c’est plus facile avec la culture cellulaire, car on voit les phases de la production du virus. Vous avez le bourgeonnement. Charles Dauget (un spécialiste de la ME) a plutôt regardé les cellules. Bien sûr, il a regardé le plasma, le concentré, etc. il n’a rien vu de majeur. Parce que si vous faites un concentré, il faut faire des coupes fines (pour voir un virus avec l’EM), et pour faire une coupe fine il faut avoir un concentré au moins de la taille d’une tête d’épingle. D’énormes quantités de virus sont donc nécessaires. Par contre, on fait une coupe fine de cellules très facilement et c’est dans ces coupes fines que Charles Dauget a trouvé le rétrovirus, avec différentes phases de bourgeonnement.
Il est peut-être vrai qu’il est parfois plus facile de détecter une particule présentant les caractéristiques morphologiques d’un rétrovirus dans la culture que dans le plasma. Cependant, puisque le « concentré » viral est obtenu à partir du surnageant de culture et que, par définition, un « concentré » contient plus de particules par unité de volume que le surnageant de culture, il s’ensuit qu’il devrait être beaucoup plus facile de voir une particule dans le concentré que dans la culture. Puisque Montagnier et ses collègues n’ont « rien vu de majeur » dans le « concentré », c’est-à-dire dans la bande de 1,16 g/ml, pourquoi ont-ils déclaré dans leur article de 1983 que le « concentré » contenait non seulement des particules virales, mais aussi du virus « purifié » ? Sur la photo prise au microscope électronique que Montagnier et ses associés, dont Charles Dauget, ont publiée, on voit des bourgeons à la surface de la cellule, dont certains sont plus prononcés que d’autres. Mais qu’est-ce qui prouve que ce sont des virus ou qu’ils sont en train de devenir des virus ?
DT : Lorsque l’on regarde les photos publiées au microscope électronique, pour vous en tant que rétrovirologue, il est clair qu’il s’agit d’un rétrovirus, un nouveau rétrovirus ?
LM : Non, à ce stade, on ne peut pas le dire. Avec les premières images de bourgeonnement, ça pourrait être un virus de type C. On ne peut pas distinguer.
Nous sommes d’accord pour dire que ça pourrait être n’importe quoi d’autre.
DT : Est-ce que ça pourrait être autre chose qu’un rétrovirus ?
LM : Non… bien, après tout, oui… ça pourrait être un autre virus en herbe. Mais il y a un… nous avons un atlas. On sait un peu, par familiarité, ce qui est un rétrovirus et ce qui ne l’est pas. Avec la morphologie, on peut faire la distinction, mais il faut une certaine familiarité.
Nous convenons que la familiarité peut parfois permettre de distinguer les particules de type rétroviral des autres particules de type viral à l’aide de caractéristiques morphologiques. Cependant, il existe des particules qui ne sont PAS des virus (y compris les rétrovirus) et qui présentent des caractéristiques morphologiques identiques à celles des rétrovirus. Par conséquent, d’un point de vue morphologique, les bourgeons et les particules acellulaires ne peuvent être considérés comme des rétrovirus. En outre, les cultures de tissus provenant de patients atteints du SIDA contiennent une pléthore de particules de type viral dont le diamètre varie entre 65 et 250 nm, dont la forme est sphérique, angulaire ou en forme de goutte d’eau, dont la surface présente ou non des pointes et qui contiennent des noyaux coniques, en forme de barre, centrosymétriques et tubulaires, ainsi que des noyaux doubles et un mélange de noyaux. Comme les nombreuses particules de taxonomie variable qu’on a estimées être la particule du VIH, aucune de ces particules n’a été purifiée et caractérisée et, comme le VIH, leur origine et leur rôle doivent rester conjecturaux. (9,61-64)
DT : Pourquoi pas de purification ?
LM : Je répète que nous n’avons pas purifié. On a purifié pour caractériser la densité de la RT, qui était bien celle d’un rétrovirus. Mais on n’a pas pris le pic… ou ça n’a pas marché… parce que si on purifie, on endommage. Donc pour les particules infectieuses, il vaut mieux ne pas trop les toucher. Donc on prend simplement le surnageant de la culture de lymphocytes qui ont produit le virus et on le met en petite quantité sur de nouvelles cultures de lymphocytes. Et voilà, vous transmettez le rétrovirus en série et vous obtenez toujours les mêmes caractéristiques et vous augmentez la production à chaque fois que vous le transmettez.
1. S’ils n’ont pas purifié les particules, pourquoi ont-ils prétendu l’avoir fait et continué à le faire jusqu’à cette interview ?
2. Il est vrai qu’ils ont rapporté le pic de l’activité RT à la densité de 1,16 g/ml, c’est-à-dire à la densité dans laquelle ils ont affirmé avoir « purifié, marqué le virus ». Cependant, comment est-il possible d’affirmer que l’activité RT « était bien celle d’un rétrovirus », alors qu’ils « n’ont pas pris le pic… ou que cela n’a pas fonctionné », c’est-à-dire qu’à ce pic, ils n’ont même pas trouvé de particules ressemblant à des rétrovirus, pour ne pas dire des rétrovirus ? Pour faire passer un rétrovirus d’une culture à une autre, il faut d’abord avoir la preuve de l’existence d’un rétrovirus dans la première culture. « Faire passer » des phénomènes non spécifiques n’est pas une preuve de la transmission d’un rétrovirus. De plus, étant donné que tous les phénomènes que Montagnier et ses collègues considéraient comme des preuves de l’existence d’un rétrovirus, y compris l’activité RT et les particules de type viral, pouvaient apparaître de novo dans les cultures, en particulier dans les conditions de culture qu’ils ont utilisées, ils ne peuvent pas prétendre prouver qu’ils ont transmis quoi que ce soit. Comment Montagnier et ses collègues savaient-ils que s’ils avaient eu des contrôles appropriés, les mêmes phénomènes ne se seraient pas produits dans la culture du donneur de sang ainsi que dans les lymphocytes ombilicaux, même s’ils n’étaient pas « infectés » par le « VIH » ?
DT : L’étape de la purification n’est donc pas nécessaire ?
LM : Non, non, ce n’est pas nécessaire. Ce qui est essentiel, c’est de transmettre le virus. Le problème que Péronne avait avec le virus de la sclérose en plaques était qu’il ne pouvait pas transmettre le virus d’une culture à l’autre. C’est là le problème. Il y est parvenu un tout petit peu, pas assez pour le caractériser. Et de nos jours, caractériser signifie avant tout se situer au niveau moléculaire. Si vous voulez, la procédure va plus vite. Donc pour le faire : un ADN, cloner cet ADN, l’amplifier, le séquencer, etc. Donc vous avez l’ADN, la séquence de l’ADN qui vous dit si c’est vraiment un rétrovirus. On connaît la structure familière des rétrovirus, tous les rétrovirus ont une structure génomique familière avec tel ou tel gène qui est caractéristique.
1. Si l’étape de purification (isolement) n’est pas nécessaire, alors pourquoi Montagnier et ses collègues ont-ils prétendu avoir prouvé l’existence du « VIH » parce qu’ils l’ont « isolé », « purifié » ?
2. Puisque tout morceau d’ADN peut être cloné et amplifié, le clonage et l’amplification d’un morceau d’ADN ne fournissent aucune information quant à son origine, c’est-à-dire s’il est rétroviral ou non. Il n’est pas non plus possible, en séquençant un morceau d’ADN, de dire qu’il s’agit « véritablement d’un rétrovirus », à moins qu’il n’existe une preuve préalable que ces séquences sont présentes dans une particule rétrovirale et nulle part ailleurs. Il n’y a rien de spécifique dans la « structure des rétrovirus ». S’il existe effectivement une « séquence d’ADN » unique indiquant « qu’il s’agit véritablement d’un rétrovirus » et que « tous les rétrovirus ont une structure génomique familière avec tel ou tel gène », alors aucune preuve de ce type n’existe pour le « génome du VIH » (32). Il suffit de mentionner qu’à ce jour, deux séquences identiques du « génome du VIH » n’ont pas été publiées. Un même patient peut avoir différentes séquences de « l’ADN du VIH ». Selon des chercheurs de l’Institut Pasteur, « un patient asymptomatique peut héberger au moins 106 variantes génétiquement distinctes du VIH, et pour un patient atteint du SIDA, le chiffre est de plus de 108. (65-66) Les différences génétiques peuvent atteindre 40 %. (67) (Comparez cela aux 1-2 % de différences entre les ADN des hominidés, dont certains codent pour des protéines identiques telles que les chaînes a et b de l’hémoglobine des chimpanzés et des humains). La longueur de l’« ADN du VIH » se situerait entre 9 et 15 Kb. En 1985, les chercheurs de Pasteur ont rapporté que « la structure génétique déduite est unique ; elle montre, en plus des gènes rétroviraux gag, pol et env, deux nouveaux cadres de lecture ouverts que nous appelons Q et F ». (68) En 1990, on a dit que le génome du « VIH » était constitué de dix gènes (69). En 1996, Montagnier a rapporté que le « VIH » possédait huit gènes (70) et, selon Barre-Sinoussi, (71) le « VIH » a neuf gènes.
DT : Donc, pour l’isolement des rétrovirus, l’étape de la purification n’est pas obligatoire ? On peut isoler les rétrovirus sans les purifier.
LM : Oui… on n’est pas obligé de transmettre du matériel pur. Ce serait mieux, mais il y a le problème de l’endommager et de diminuer l’infectivité du rétrovirus.
1. Pour l’isolement des rétrovirus, l’étape de purification EST obligatoire. On NE PEUT ISOLER des rétrovirus SANS PURIFICATION. Par définition, isoler signifie « mettre à part ou seul » (Concise Oxford Dictionary) et purifier signifie « débarrasser d’éléments étrangers » (Concise Oxford Dictionary). Ainsi, à moins que les contaminants ne soient retirés de l’entourage des particules de « VIH » (c’est-à-dire pour purifier le « VIH »), les particules de « VIH » ne sont PAS ISOLÉES.
2. Nous sommes d’accord pour dire que pour transmettre un rétrovirus, on n’a pas besoin de matériel pur. Cependant, pour transmettre quelque chose, il faut d’abord savoir ce que l’on transmet, c’est-à-dire avoir la preuve de son existence. Pour les rétrovirus, une telle preuve ne peut être obtenue qu’en isolant (purifiant) les particules, en déterminant leurs propriétés physiques et chimiques et en prouvant qu’elles sont infectieuses.
DT : Sans passer par cette étape de purification, n’y a-t-il pas un risque de confusion sur les protéines que l’on identifie et aussi sur la RT qui pourrait provenir d’autre chose ?
LM : Non… après tout, je le répète, si nous avons un pic de RT à la densité de 1,15, 1,16, il y a 999 chances sur 1 000 que ce soit un rétrovirus. Mais il pourrait s’agir d’un rétrovirus d’origine différente. Je répète, il y a des rétrovirus endogènes, des pseudo-particules qui peuvent être émises par les cellules, mais quand bien même, de la partie du génome qui fournit les rétrovirus. Et que l’on acquiert par hérédité, dans les cellules depuis très longtemps. Mais finalement je pense que pour la preuve — parce que les choses évoluent comme la biologie moléculaire permettant une caractérisation encore plus facile de nos jours — il faut passer très vite au clonage. Et cela a été fait très rapidement, aussi bien par Gallo que par nous-mêmes. Clonage et séquençage, et là on a la caractérisation complète. Mais je le répète, la première caractérisation est l’appartenance à la famille des lentivirus, la densité, le bourgeonnement, etc. les propriétés biologiques, l’association avec les cellules T4. Toutes ces choses font partie de la caractérisation, et c’est nous qui les avons faites.
Oui, il est impossible de déterminer l’identité des protéines y compris celle de la RT sans isolement.
1. Montagnier et ses collègues, même après un effort de romain, n’ont pas pu trouver de particules ressemblant à des rétrovirus à cette densité ; ainsi, d’après son expérience (preuve expérimentale), il y a zéro chance et PAS 999 sur 1000 que l’activité de RT à la densité de 1,15, 1,16 représente un rétrovirus dans leur cas.
2. Nous sommes d’accord qu’il pourrait s’agir d’un rétrovirus d’origine différente. L’existence de rétrovirus endogènes, ainsi que la présence chez les patients atteints du SIDA et les personnes à risque d’anticorps réagissant avec leurs antigènes, signifie que même si Montagnier et coll. avaient prouvé l’existence d’un rétrovirus, il aurait été impossible de dire que le rétrovirus provenait de l’homosexuel masculin et non des donneurs ou des lymphocytes du cordon ombilical.
3. La « biologie moléculaire », le « clonage et le séquençage » du génome du « VIH » ont été examinés en détail ailleurs. (32-49) Il suffit de mentionner ici que :
(a) la preuve de l’existence du « VIH » et de son rôle causal dans le SIDA a été revendiquée avant toute « biologie moléculaire », « clonage et séquençage » ;
(b) puisque tout morceau d’acide nucléique peut être cloné et séquencé, le clonage et le séquençage d’un morceau d’acide nucléique ne peuvent être utilisés pour prouver l’existence d’un rétrovirus ou de son génome. Au contraire, la preuve de l’existence d’acides nucléiques viraux (ARN viral et ADNc) peut être acceptée si et seulement s’il est démontré que l’ARN est une entité moléculaire unique appartenant à des particules ayant les caractéristiques morphologiques, physiques et réplicatives des particules rétrovirales. Cela ne peut se faire qu’en séparant les particules de tout le reste, en les purifiant. Au lieu de cela, Montagnier et Gallo ont utilisé « une véritable soupe » de cultures et de co-cultures (le groupe de Montagnier a même volontairement infecté les cultures avec le virus d’Epstein-Barr). Le surnageant de ces cultures a été mis en bande dans des gradients de densité de saccharose. Parmi tout l’ARN (et l’ADN) qui s’est regroupé à 1,16 g/ml, ils ont arbitrairement choisi un certain ARN en utilisant des critères totalement non rétroviraux spécifiques et l’ont appelé « ARN du VIH », sans aucune preuve que la bande contenait même des particules rétrovirales ; (32)
(c) la première étape, absolument nécessaire pour prouver que l’« ARN VIH », rétroviral ou non, provient des lymphocytes de personnes infectées par le « VIH », consiste à réaliser des expériences d’hybridation en utilisant des lymphocytes frais, non cultivés, et l’« ADN VIH » (obtenu par transcription inverse de l’« ARN VIH »), comme sonde. Il est difficile de comprendre pourquoi Montagnier et ses collègues n’ont pas rapporté de telles expériences. Le groupe de Gallo l’a fait et les résultats étaient négatifs. En 1994, Gallo a été cité dans ce magazine comme ayant déclaré : « Nous n’avons jamais trouvé l’ADN du VIH dans les cellules tumorales du SK (NdT : Sarcome de Kaposi)… En fait, nous n’avons jamais trouvé l’ADN du VIH dans les cellules T ». (72) Il n’existe actuellement aucune étude prouvant l’existence d’une seule copie du « génome complet du VIH » dans les cellules T fraîches, même d’un seul patient atteint du SIDA ou d’un patient à risque de SIDA ;
(d) Actuellement, le nombre de particules de « VIH » dans le plasma est quantifié en mesurant l’« ARN du VIH », la charge virale qui serait de « 15 x 103 à 554 x 103 virions par ml ». (73) De nombreuses études prétendent prouver que la « charge virale », l’« ARN du VIH », peut être réduite à des niveaux indétectables par l’utilisation de la RT et des inhibiteurs de protéase. Cependant, étant donné que : (i) il est admis que l’« ARN du VIH » est une transcription de l’« ADN du VIH » ; (ii) par nature, ni la RT ni les inhibiteurs de protéase n’ont d’effet sur la transcription de l’ADN, ils ne font qu’inhiber l’infection de nouvelles cellules, c’est-à-dire que la diminution de l’« ARN du VIH » est une conséquence de la diminution de l’« ADN du VIH » ; on s’attendrait à ce que l’effet de ces médicaments soit déterminé en mesurant le niveau de l’« ADN du VIH ». Pourtant, pratiquement aucune étude de ce type n’a été publiée. Les très rares études qui existent montrent que ni la RT ni les inhibiteurs de protéase n’ont d’effet sur l’« ADN du VIH » (74-76), ce qui signifie qu’il n’existe aucune relation entre l’« ARN du VIH » et l’« ADN du VIH ».
4. En 1984, Montagnier et ses collègues ont rapporté que « la préincubation de lymphocytes T4+ avec trois anticorps monoclonaux différents dirigés contre la glycoprotéine T4 bloquait l’infection des cellules par le LAV », c’est-à-dire bloquait la détection de l’activité RT dans les cellules T4 « infectées » par le « VIH ». Ils ont conclu que leurs « résultats suggèrent fortement que la glycoprotéine T4 est au moins associée à tout ou partie du récepteur du LAV » (38). Cependant, le blocage d’un phénomène non spécifique du « VIH », à savoir l’activité RT, ne peut être considéré comme une preuve du blocage de l’infection par le « VIH » ou de l’association du « VIH » avec les lymphocytes T4.
DT : Mais il arrive un moment où l’on doit faire la caractérisation du virus. C’est-à-dire : quelles sont les protéines qui le composent ?
LM : C’est cela. Ainsi donc, l’analyse des protéines du virus exige une production et une purification de masse. Il est nécessaire de faire cela. Et là je dois dire que cela a partiellement échoué. J.C. Chermann était chargé de cela, au moins pour les protéines internes. Il a eu des difficultés à produire le virus et cela n’a pas fonctionné. Mais c’était une voie possible, l’autre voie était d’avoir l’acide nucléique, le clonage, etc. C’est cette méthode qui a fonctionné très rapidement. L’autre voie n’a pas fonctionné parce qu’on avait à l’époque un système de production qui n’était pas assez robuste. On n’avait pas assez de particules produites pour purifier et caractériser les protéines virales. Cela n’a pas pu se faire. On ne pouvait pas produire beaucoup de virus à l’époque parce que ce virus n’émergeait pas dans la lignée cellulaire immortelle. On pouvait le faire avec le virus LAI, mais à l’époque on ne savait pas cela.
Nous sommes d’accord pour dire que « l’analyse des protéines du virus exige une production et une purification de masse. Il est nécessaire de le faire ». À cet égard, ils n’ont pas seulement échoué partiellement, mais ils ont TOTALEMENT ÉCHOUÉ. Si « l’analyse des protéines du virus exige une production et une purification de masse », il en va de même pour l’analyse des « acides nucléiques, le clonage, etc. » Si l’on ne parvient pas à purifier le virus, on échoue :
- à caractériser les antigènes viraux et à obtenir un étalon-or pour la réaction antigène-anticorps, c’est-à-dire qu’on ne peut pas utiliser les tests d’anticorps pour définir l’infection par le rétrovirus ;
- à obtenir et caractériser les acides nucléiques rétroviraux, l’ARN (ADNc) et donc les sondes et les amorces pour les études d’hybridation et de PCR, c’est-à-dire qu’on ne peut pas utiliser les tests moléculaires pour définir l’infection rétrovirale. Le fait que ce soit le cas est accepté par Donald Francis, un chercheur qui, avec Gallo, a joué un rôle important dans l’élaboration de la théorie selon laquelle le SIDA est causé par un rétrovirus. En 1983, Francis, alors collaborateur en chef des activités du laboratoire de lutte contre le SIDA des Centers for Disease Control des États-Unis (NdT : le ou les célèbres CDC) et ancien chef du programme de lutte contre la variole de l’OMS, a émis l’hypothèse d’une cause virale du SIDA : « Il faut compter sur des méthodes de détection plus élaborées grâce auxquelles, par un outil spécifique, on peut « voir » un virus. Certaines substances spécifiques, comme les anticorps ou les acides nucléiques, permettront d’identifier les virus même si les cellules restent vivantes. Le problème ici est que de telles méthodes ne peuvent être développées que si nous savons ce que nous cherchons. Autrement dit, si nous recherchons un virus connu, nous pouvons vacciner un cobaye, par exemple, avec un virus pur… Mais il est évident que si nous ne savons pas quel virus nous recherchons et que nous sommes donc incapables de produire des anticorps chez les cobayes, il est difficile d’utiliser ces méthodes… nous chercherions quelque chose qui pourrait ou non exister en utilisant des techniques qui pourraient ou non fonctionner » (77) (italiques de nous).
DT : Gallo l’a-t-il fait ?
LM : Gallo ? … Je ne sais pas s’il a vraiment purifié. Je ne le crois pas. Je crois qu’il s’est lancé très rapidement dans la partie moléculaire, c’est-à-dire le clonage. Ce qu’il a fait, c’est le Western Blot. Nous avons utilisé la technique RIPA, donc ce qu’ils ont fait de nouveau, c’est qu’ils ont montré certaines protéines que l’on n’avait pas bien vues avec l’autre technique. Voici un autre aspect de la caractérisation du virus. Vous ne pouvez pas le purifier, mais si vous connaissez quelqu’un qui possède des anticorps contre les protéines du virus, vous pouvez purifier le complexe anticorps/antigène. C’est ce qu’on a fait. Et on a ainsi obtenu une bande visible, marquée par radioactivité, que l’on a appelée protéine 25, p25. Et Gallo en a vu d’autres. Il y avait la p25 qu’il a appelée p24, il y avait la p41 que nous avons vue…
Il est impossible de caractériser deux inconnues virales, à savoir ses protéines et les anticorps dirigés contre elles, par la formation d’un complexe anticorps/antigène et encore moins de caractériser le « virus ». Par quel moyen Montagnier a-t-il su que quelqu’un avait des anticorps contre les protéines du virus et que les protéines avec lesquelles les anticorps réagissent étaient virales ? Il est scientifiquement impossible de savoir que quelqu’un a des anticorps contre un virus et qu’en même temps, la bande de 1,16 g/ml contient des protéines du même virus avant d’avoir prouvé son existence.
DT : Concernant les anticorps, de nombreuses études ont montré que ces anticorps réagissent avec d’autres protéines ou éléments qui ne font pas partie du VIH. Et qu’ils ne peuvent pas être suffisants pour caractériser les protéines du VIH.
LM : Non ! Parce qu’on avait des témoins. Nous avions des personnes qui n’avaient pas le SIDA et qui n’avaient pas d’anticorps contre ces protéines. Et les techniques que nous avons utilisées étaient des techniques que j’avais moi-même perfectionnées quelques années auparavant, pour détecter le gène src. Vous voyez, le gène src a aussi été détecté par immunoprécipitation. C’était la p60 (protéine 60). J’étais très adroit, et mon technicien aussi, avec la technique RIPA. Si on obtient une réaction spécifique, c’est spécifique.
1. Il est vrai que Montagnier avait des témoins, mais les témoins n’étaient pas appropriés. Montagnier et ses collègues ont fait réagir les protéines dont la concentration est de 1,16 g/ml avec les sérums de deux patients homosexuels atteints de lymphadénopathie. Les patients atteints du SIDA et les personnes à risque étaient déjà connus pour avoir une pléthore d’anticorps, tous susceptibles de présenter une réactivité croisée. Par conséquent, on aurait pu s’attendre à ce que Montagnier et coll. utilisent comme témoins des individus malades qui n’avaient pas le SIDA ou le pré-SIDA et qui n’étaient pas à risque de contracter le SIDA, mais qui avaient également une pléthore d’anticorps, tous avec un potentiel de réactivité croisée. Au lieu de cela, leurs contrôles étaient constitués de deux donneurs de sang dont l’état de bonne santé se caractérise par des niveaux d’anticorps plus faibles.
2. Montagnier et coll. n’ont pas obtenu la preuve d’une « réaction spécifique ». Les sérums des patients et des donneurs ont réagi à la fois avec le « virus purifié », c’est-à-dire la bande de 1,16 g/ml, et avec des extraits de cellules « infectées ». Dans leurs bandes publiées, avec le « virus purifié », il n’est pas possible de distinguer de protéines ne réagissant avec aucun des sérums. Dans le texte, ils déclarent : « Lorsque le virus purifié et marqué (la bande de 1,16 g/ml) du patient 1 a été analysé… trois protéines principales ont pu être observées : la protéine p25 et des protéines d’un poids moléculaire de 80 000 et 45 000. Aucune réaction de ce type n’a été signalée avec les sérums des donneurs. Dans les bandes publiées avec des extraits de « cellules infectées », il est évident que de nombreuses protéines ont réagi avec les sérums des « patients et des donneurs de sang sains ». Un an plus tard, Montagnier et ses collègues ont confirmé que « les sérums de certains patients atteints du SIDA fixaient un grand nombre de protéines cellulaires… Cette bande était apparente dans le RIPA (NdT : Radioimmunoprecipitation Assay est un tampon utilisé pour extraire les protéines des cellules entières ainsi que les fractions membranaires et nucléaires) et seuls les sérums qui précipitaient spécifiquement la p25 étaient considérés comme positifs ». En d’autres termes, pour une raison inconnue, ils ont conclu que parmi toutes les protéines réagissant, seule la p24 (leur p25) était rétrovirale et que parmi tous les anticorps, seul celui qui réagissait avec la p24 était dirigé contre le rétrovirus. Même si l’on considère que la réaction entre la p24 qui présente une bande à 1,16 g/ml et l’anticorps présent dans les sérums est spécifique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas due à une réactivité croisée, il est impossible de tirer la conclusion que la p24 est une protéine rétrovirale et que l’anticorps est produit à la suite d’une infection par ce rétrovirus. En effet, étant donné que Montagnier et coll. n’ont même pas pu détecter des particules de type rétrovirus à 1,16 g/ml, leurs conclusions concernant la p24 et l’anticorps réagissant avec elle défient complètement le raisonnement scientifique.
DT : Mais nous savons que les patients atteints du SIDA sont infectés par une multitude d’autres agents infectieux qui sont susceptibles de…
LM : Ah oui, mais les anticorps sont très spécifiques. Ils savent distinguer une molécule sur un million. Il y a une très grande affinité. Lorsque les anticorps ont suffisamment d’affinité, vous repérez quelque chose de vraiment très spécifique. Avec les anticorps monoclonaux, vous repérez vraiment UNE protéine. Tout cela est utilisé pour la détection d’antigènes à des fins de diagnostic.
1. Aucun anticorps, pas même les anticorps monoclonaux, n’est « très spécifique » ou même spécifique. (78-84) En effet, il existe des cas où « l’antigène à réaction croisée se lie avec une plus grande affinité que l’antigène homologue lui-même… Le fait le plus évident concernant les réactions croisées des anticorps monoclonaux est qu’elles sont caractéristiques de toutes les molécules et qu’elles ne peuvent être éliminées par absorption sans supprimer toute réactivité…. Même les antigènes qui diffèrent pour la majeure partie de leur structure peuvent partager un déterminant, et un anticorps monoclonal reconnaissant ce site donnerait alors une réaction croisée de 100 %. Un exemple est la réaction des auto-anticorps dans le lupus à la fois avec l’ADN et la cardiolipine ». (80)
Toutefois, « il convient de souligner que le partage d’un « déterminant » ne signifie pas que les antigènes ont des structures chimiques identiques, mais plutôt qu’ils présentent une ressemblance chimique qui peut ne pas être bien comprise, par exemple, une répartition des charges de surface ». (80) Il est important de noter que les experts du « VIH » admettent que la « réactivité croisée » est la raison de la réactivité « indéterminée » des anticorps observée dans le Western Blot du « VIH », ainsi que, par exemple, la réactivité entre les anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine p18 du « VIH » et les cellules dendritiques dans les tissus lymphatiques de divers patients atteints d’un certain nombre de maladies non liées au SIDA (85) et les tissus normaux prélevés sur des personnes infectées par autre chose que le « VIH ». (86) Pour être convaincu que tous les « anticorps (y compris les monoclonaux) sont polyspécifiques, c’est-à-dire qu’ils sont capables de réagir avec divers antigènes dissemblables tels que : protéines, acides nucléiques et haptènes », « ils sont capables de réagir avec plus d’un antigène du soi ou du non-soi, souvent sans similitude antigénique apparente », il suffit de lire les publications scientifiques des chercheurs de l’Institut Pasteur tels que Stratis Avrameas. (83-87)
2. On ne peut pas conclure qu’une protéine qui présente une bande à 1,16 g/ml est virale simplement parce qu’elle réagit avec un anticorps présent dans le sérum du patient, même si l’on sait d’une manière ou d’une autre que les anticorps présents dans le sérum sont monoclonaux. Supposons une situation idéale où :
- (a) tous les anticorps présents dans les sérums des patients sont monoclonaux et « très spécifiques » ;
- (b) la bande de 1,16 g/ml contient, en plus des nombreuses microvésicules et des protéines non incorporées, des protéines incorporées d’origine cellulaire et peut-être d’origine bactérienne, fongique et virale (constituants des nombreux agents infectieux, autres que les rétrovirus, présents dans la culture et chez les patients) et, comme l’a montré une étude franco-allemande de 1997, un certain nombre de particules de type rétrovirus. Même dans cette situation idéale, il n’est PAS POSSIBLE D’AFFIRMER que simplement parce qu’une protéine comme la p24, la p41 ou d’autres se trouve dans cette bande et réagit avec les sérums, cette protéine est un constituant des particules de type rétrovirus.
3. La réalité est que :
- (a) tous les patients atteints du SIDA et les personnes à risque ont une pléthore d’anticorps, y compris des auto-anticorps. Les auto-anticorps comprennent des anticorps anti-lymphocytaires et, comme Montagnier et ses collègues l’ont montré (88), des anticorps anti-actine et anti-myosine, c’est-à-dire des anticorps dirigés contre les deux protéines cellulaires ubiquitaires que sont l’actine et la myosine.
- (b) tous les anticorps présents dans les sérums ont un potentiel de réactivité croisée.
- (c) les protéines du surnageant des lymphocytes non infectés qui, dans les gradients de densité de saccharose, s’étalent à 1. (c) les protéines du surnageant de lymphocytes non infectés qui, dans les gradients de densité de saccharose, forment une bande à 1,16 g/ml, le virus fictif, comprennent des protéines ayant les mêmes poids moléculaires que les protéines du « VIH » ; (89)
- (d) les animaux inoculés avec le virus fictif développent des anticorps qui réagissent avec les protéines du « SIV », un « rétrovirus » dont les protéines ont les mêmes poids moléculaires que les protéines du « VIH » et qui est dit être le plus proche parent du « VIH » ; (90)
- (e) les malades du SIDA et les personnes à risque sont soumis de manière répétée à des stimuli allogènes, y compris des lymphocytes allogènes ;
- (f) jusqu’en 1997, il n’existait aucune preuve montrant que la bande 1,16 g/ml contenait même des particules de type rétrovirus. Compte tenu de cette réalité, prétendre que le simple fait qu’une protéine présente une bande de 1,16 g/ml et réagisse avec les anticorps présents dans le sérum des patients n’est, au mieux, pas différent de ce qui suit :
- (i) un chercheur dispose de deux bols, l’un d’eux contient un mélange d’œufs crus, certains connus et peut-être certains inconnus, et peut-être du lait provenant de plusieurs animaux. L’autre contient plusieurs acides. Là encore, certains sont connus et d’autres inconnus. Une fois le contenu des deux bols mélangé, il obtient un précipité. Il prétend que le précipité prouve l’existence dans le bol de lait provenant d’un animal précédemment inconnu et d’un acide inconnu et que la réaction est entre l’acide inconnu et une protéine du lait précédemment inconnu.
- (ii) Cette affirmation est scientifiquement impossible puisque n’importe quelle protéine dans les œufs aurait pu réagir avec n’importe quel acide pour produire le précipité observé.
Ainsi, étant donné la réalité telle qu’elle est décrite aux points (a) à (f) ci-dessus, c’est complètement non scientifique de prétendre que la réaction entre des protéines qui forment une bande à 1,16 g/ml et réagissent avec des anticorps présents dans le sérum des patients est une preuve de l’existence du « VIH ». Prétendre que la réaction entre des protéines qui forment une bande à 1,16 g/ml (en l’absence de preuve que la bande contient même des particules de type rétrovirus) avec des anticorps présents dans le sérum indique non seulement que la bande contient des protéines rétrovirales, mais des protéines d’un nouveau rétrovirus, n’est pas différent de ce qui suit : un pêcheur qui a des créatures marines, mais pas de poisson dans un filet. Il jette quelques animaux dans le filet. Le pêcheur observe que les animaux mangent certaines protéines présentes dans le filet et affirme que ces protéines n’étaient pas seulement des protéines de poisson, mais les protéines d’un tout nouveau poisson, un poisson que personne n’a vu auparavant, un poisson doré.
DT : Pour vous, la p41 n’était pas d’origine virale et n’appartenait donc pas au VIH. Pour Gallo, c’était la protéine la plus spécifique du VIH. Pourquoi cette contradiction ?
LM : On avait tous les deux raisonnablement raison. C’est-à-dire que dans ma technique RIPA… en fait il y a des protéines cellulaires que l’on rencontre partout — il y a un « bruit de fond » non spécifique, et parmi ces protéines il y en a une qui est très abondante dans les cellules, c’est l’actine. Et cette protéine a un poids moléculaire de 43 000 kd. Donc, elle était là. J’avais donc raisonnablement raison, mais ce que Gallo a vu en revanche, c’est la gp41 du VIH, car il utilisait le Western Blot. Et ça, je l’ai reconnu.
1. Il n’est pas possible que Montagnier et Gallo aient tous deux « raisonnablement raison ». Gallo et Montagnier ont tous deux fait réagir la bande de 1,16 g/ml avec des sérums de patients. Indépendamment de la méthode utilisée pour détecter la réaction (RIPA ou WB), ou du nombre de réactions effectuées, ils auraient dû trouver les mêmes protéines réactives.
2. Dans leur étude de 1983, Montagnier et ses collègues ont trouvé trois protéines, p25, p45 et p80. En ce qui concerne la p45, ils ont écrit : « La protéine 45K peut être due à la contamination du virus par l’actine cellulaire qui était présente dans les immunoprécipités de tous les extraits cellulaires ». Dans une étude publiée en 1984, ils avaient « une p25 proéminente, une p18, une protéine de faible poids moléculaire au fond du gel (p12), et trois protéines de haut poids moléculaire (43 000, 53 000, 68 000). La bande à 43 000 peut inclure un composant d’origine cellulaire, puisqu’elle a également été trouvée dans une préparation similaire faite à partir des cellules témoins non infectées ».
3. Étant donné que les sérums des patients et des donneurs de sang sains ont réagi à plusieurs reprises avec la protéine p45/p43 provenant de cellules infectées et non infectées, on aurait pu s’attendre à ce que Gallo détecte également cette protéine. Cependant, ni Gallo ni personne d’autre depuis lors n’a signalé une telle bande, quelle que soit la méthode utilisée pour détecter la réaction antigène/anticorps. La divergence peut être résolue si l’on prend en considération le fait que la migration des protéines dans une bande électrophorétique, en plus du poids moléculaire, peut également être influencée par d’autres facteurs, par exemple la charge portée par la protéine. Ainsi, une seule et même protéine peut sembler avoir un poids moléculaire légèrement différent lorsqu’elle est détectée par RIPA ou par WB. Par exemple, on considère actuellement que la p25 détectée par Montagnier et la p24 détectée par Gallo sont toutes deux une seule et même protéine « VIH » p24.
4. Le poids moléculaire de l’actine n’est ni de 45 000 ni de 43 000, mais de 41 000. À l’heure actuelle, il existe de nombreuses preuves que la bande de 1,16 g/ml du « VIH pur » contient de l’actine cellulaire (91-94) et, comme cela a déjà été mentionné, Montagnier lui-même a montré que les sérums des malades du SIDA et des personnes à risque contiennent des anticorps qui réagissent avec l’actine. En d’autres termes, lorsque l’on fait réagir la bande de 1,16 g/ml avec des sérums de patients, indépendamment de la présence de « VIH », une bande p41 (p45/43) doit être présente et représenter l’actine cellulaire (si Montagnier croit maintenant que la p41 est une protéine du « VIH », pourquoi persiste-t-il à exclure cette bande de ses critères pour un Western Blot positif ? (95)
DT : Pour vous la p24 était la protéine la plus spécifique du VIH, pour Gallo pas du tout. On reconnaît grâce à d’autres études que les anticorps dirigés contre la p24 étaient souvent retrouvés chez des patients non infectés par le VIH, et même chez certains animaux. En fait aujourd’hui, une réaction d’anticorps contre la p24 est considérée comme non spécifique.
LM : Ce n’est pas suffisant pour diagnostiquer une infection par le VIH.
La protéine p24 n’est pas suffisante pour diagnostiquer une infection par le « VIH », car elle n’est pas spécifique. En effet, aucune autre protéine du « VIH », pas même la p41 (p45/43), n’a été signalée comme réagissant plus souvent avec les sérums d’individus sains (sans risque de SIDA). On n’a pas non plus constaté qu’un anticorps monoclonal dirigé contre l’une des autres protéines « VIH » réagissait plus souvent avec des protéines présentes dans des cultures non « infectées » ou des sérums d’individus ne présentant aucun risque de SIDA. Selon Montagnier, étant donné que :
- (a) « ce sont des protéines cellulaires que l’on rencontre partout — il y a un bruit de fond non spécifique » ;
- (b) une de ces protéines, ayant un poids moléculaire de 45/43, est l’actine ;
- (c) cette protéine a réagi avec des sérums d’individus ne présentant pas de risque de SIDA ; la p45/43 représente une protéine cellulaire et non virale. Cependant, étant donné que :
- (i) la myosine est aussi ubiquitaire que l’actine.
- (ii) la myosine possède une chaîne légère d’un poids moléculaire de 24 000.
- (iii) les protéines du cytosquelette (dont l’actine et la myosine sont les plus abondantes) ont été rapportées dans le « VIH pur ».(91-94) En effet, la myosine et l’actine joueraient un rôle crucial dans le bourgeonnement et la libération des particules « VIH ». (91)
- (iv) Montagnier a montré que les patients atteints de SIDA et à risque de SIDA ont des anticorps anti-myosine.
- Pourquoi ne pas considérer la bande p24 comme représentant la myosine ?
DT : Aucune protéine n’est suffisante ?
LM : Aucune protéine n’est suffisante de toute façon. Mais à l’époque, le problème ne s’est pas présenté comme ça. Le problème était de savoir si c’était un HTLV ou pas. Le seul rétrovirus humain connu était le HTLV. Et on a montré clairement que ce n’était pas un HTLV, que les anticorps monoclonaux de Gallo contre la p24 du HTLV ne reconnaissaient pas la p25 du VIH.
Nous sommes d’accord pour dire qu’aucune protéine n’est suffisante pour diagnostiquer une infection par le « VIH ». Le problème à l’époque, comme aujourd’hui, n’était pas de « savoir si c’était un HTLV ou pas », mais de savoir si c’était rétroviral ou pas. Tout ce qui n’est pas HTLV n’est pas rétroviral.
DT : À la densité des rétrovirus, 1,16, il y a beaucoup de particules, mais seulement 20 % d’entre elles appartiennent au VIH. Pourquoi 80 % des protéines ne sont pas virales et les autres le sont ? Comment peut-on faire la différence ?
LM : Il y a deux explications. D’une part, à cette densité vous avez ce qu’on appelle des microvésicules d’origine cellulaire, qui ont à peu près la même taille que le virus, et puis le virus lui-même, en bourgeonnant, apporte des protéines cellulaires. Donc effectivement ces protéines ne sont pas virales, elles sont d’origine cellulaire. Alors, comment faire la différence ? ! Franchement avec cette technique on ne peut pas le faire précisément. Ce qu’on peut faire, c’est purifier le virus au maximum avec des gradients successifs, et on tombe toujours sur les mêmes protéines.
1. À ce jour, il n’existe aucune preuve que l’une des protéines qui réagissent à 1,16 g/ml soit une protéine du « VIH ». La seule raison pour laquelle 20 % des protéines qui atteignent 1,16 g/ml sont considérées comme des protéines « VIH » est que cette fraction de protéines réagit à un moment ou à un autre avec différents sérums de patients atteints du SIDA.
2. Nous convenons qu’avec la technique utilisée par le groupe de Montagnier, on ne peut pas prouver quelles protéines (ou acides nucléiques) sont cellulaires et lesquelles sont virales.
3. Nous sommes d’accord. La seule façon de prouver l’existence de la protéine virale (acides nucléiques) est de « purifier le virus au maximum », c’est-à-dire d’obtenir des gradients de densité qui ne contiennent que des particules ayant les caractéristiques morphologiques du rétrovirus et rien d’autre. Cela n’a jamais été fait pour prouver l’existence des protéines et des acides nucléiques du « VIH ».
4. Si l’on « tombe toujours sur les mêmes protéines » dans les gradients successifs, cela ne prouve en rien que ces protéines sont virales et que celles qui disparaissent sont cellulaires.
DT : Les autres disparaissent ?
LM : Disons que les autres diminuent un peu. On enlève les microvésicules, mais à chaque fois on perd beaucoup de virus, donc il faut avoir beaucoup de virus au départ pour en garder un peu quand on arrive à la fin. Et puis encore une fois c’est l’analyse moléculaire, c’est la séquence de ces protéines qui va permettre de dire si elles sont d’origine virale ou pas. C’est ce qu’on a commencé pour la p25, ça a échoué… et l’autre technique c’est de faire le clonage, et donc là vous avez l’ADN et à partir de l’ADN vous avez les protéines. Vous déduisez la séquence des protéines et leur taille, et vous butez à nouveau sur ce que vous avez déjà observé avec l’immunoprécipitation ou avec l’électrophorèse sur gel. Et on sait par analogie avec les tailles des protéines d’autres rétrovirus, on peut déduire de manière assez proche ces protéines. Donc vous avez la p25 qui était proche de la p24 de HTLV, vous avez la p18… au final vous avez les autres. Par contre, celle qui était très différente était la très grande protéine, p120.
1. Quel que soit le nombre de fois que l’on répète la centrifugation pour obtenir des bandes, si l’on commence par ne pas avoir de particules de type rétrovirus, on finira par ne pas en avoir. Parfois, par des centrifugations successives, il est possible d’éliminer les composants non rétroviraux et d’obtenir une bande qui ne contient rien d’autre que des particules présentant des caractéristiques morphologiques de rétrovirus. Cependant, pour pouvoir le faire, même après la première centrifugation, il faut commencer avec une proportion relativement élevée de particules de type rétrovirus.
2. Une fois encore, l’origine des protéines ne peut être déterminée par une analyse moléculaire, c’est-à-dire par le séquençage des protéines.
3. Nous sommes d’accord sur le fait que si les protéines d’un rétrovirus sont codées par son génome, comme cela est généralement admis, il est alors possible de caractériser les protéines rétrovirales par leur génome. Cependant, pour ce faire, il faut d’abord prouver que l’ARN (ADNc) est un constituant d’une particule rétrovirale. Cela n’a pas été fait pour le génome du « VIH ». En fait, même aujourd’hui, il n’existe aucune preuve que l’ARN du « VIH » est un constituant d’une particule, quelle qu’elle soit, virale ou non virale.
4. À ce jour, il n’y a aucune preuve d’une relation entre les séquences de l’ARN (ADN) du « VIH » et les séquences des protéines « observées par immunoprécipitation ou par électrophorèse sur gel ». En fait, il n’y a même pas de relation entre la taille des protéines codées par les gènes du « VIH » et la taille des protéines « observées par immunoprécipitation ou par électrophorèse sur gel ». Par exemple, en 1987, Gallo et ses associés ont effectué une « analyse assistée par ordinateur » des « séquences d’acides aminés des complexes protéiques de l’enveloppe dérivés des séquences d’acides nucléiques de sept isolats du virus du SIDA », et ont conclu que « la gp41 devrait être, par calcul, d’environ 52 à 54 daltons ». (96)
5. L’un des nombreux aspects déroutants du « VIH » est le suivant :
- (a) les experts du « VIH » s’accordent à dire qu’il n’y a pas deux « VIH » qui ont les mêmes séquences génomiques et que la différence peut atteindre 40 % ; (67)
- (b) ils admettent également que la grande majorité (99,9 %) des génomes du « VIH » sont défectueux, c’est-à-dire qu’il manque soit une partie d’un gène ou de gènes, soit un ou plusieurs gènes entiers ; comment est-il alors possible :
- (i) de mesurer la charge virale (« ADN du VIH ») et la charge virale (« ARN du VIH ») en utilisant les mêmes sondes d’hybridation et les mêmes amorces PCR ?
- (ii) de réaliser des tests d’anticorps en utilisant des kits contenant les mêmes antigènes pour tous les différents « VIH » ?
6. En effet, l’histoire de la façon dont les chercheurs sur le « VIH » ont essayé de prouver l’existence de la p120 et comment ils se sont finalement mis d’accord sur son existence est très intéressante et instructive. (32) Cependant, étant donné que la protéine p120 est censée être présente uniquement dans les boutons, aucune particule de « VIH » acellulaire possédant des boutons n’a été signalée jusqu’à présent. Il s’ensuit que ni les particules dans le surnageant de culture ni le virus « pur » n’auront de gp120. En d’autres termes, il est impossible que les bandes RIPA ou WB contiennent une protéine « VIH » de poids moléculaire 120 000.
DT : Aujourd’hui, les problèmes concernant la production en masse du virus, la purification, les images EM à 1,16, sont-ils résolus ?
LM : Oui, bien sûr.
Aucune preuve de ce genre ne peut être trouvée dans la littérature publiée.
DT : Existe-t-il des images EM du VIH provenant de la purification ?
LM : Oui, bien sûr.
1. Avant mars 1997, aucun groupe de chercheurs sur le « VIH » n’avait publié ne serait-ce qu’une seule micrographie électronique d’une bande de matériau à la densité de 1,16 g/ml dans un gradient de densité de saccharose. Les premières micrographies électroniques de matériaux groupés dans des gradients de densité de saccharose sont apparues en 1997 dans deux publications, l’une franco-allemande et l’autre du National Cancer Institute (NCI) des États-Unis. (89) Les micrographies électroniques franco-allemandes proviennent du gradient de densité de saccharose de 1,16 g/ml, alors qu’il n’est pas possible de dire de quelle densité proviennent les données du NCI. Les données des deux études révèlent que la grande majorité du matériel est constituée de « microvésicules » cellulaires « non virales », de « faux » virus, c’est-à-dire que le matériel en bande est pratiquement entièrement cellulaire. Ces particules, comme les particules rétrovirales, contiennent des acides nucléiques en plus des protéines, mais elles ne sont pas aussi condensées.
2. Les électro microphotographies des deux études contiennent également une petite minorité de particules dont la morphologie ressemble davantage à celle des particules rétrovirales que celle des particules « factices ». Les deux groupes affirment que ces particules moins nombreuses sont des « VIH ».
3. Dans l’étude du NCI, aucune raison n’est donnée pour affirmer que ces particules sont des « VIH ». Les auteurs de l’étude franco-allemande affirment que les particules sont des « VIH » parce qu’elles ont :
- (a) des « diamètres d’environ 110 nm » ;
- (b) un « noyau conique dense » ;
- (c) des « corps latéraux » ; et parce qu’aucune particule de ce type n’a été observée dans le matériau en bande provenant des cellules témoins non « infectées ».
Cependant, selon des chercheurs en rétrovirus bien connus comme Bader et Frank, un type de « particule oncovirale » peut se transformer en un autre, et des noyaux immatures en « matures », simplement en changeant les conditions extracellulaires. (11-97) Cependant, les conditions de culture dans les cellules « infectées » et non infectées n’étaient pas les mêmes. Un diamètre de 100-120 nm et des boutons de surface sont deux caractéristiques morphologiques partagées par tous les rétrovirus. Aucune des particules ne semble avoir de boutons et aucune n’a un diamètre inférieur à 120 nm. En calculant la moyenne des diamètres majeurs et mineurs des particules indiquées et censées représenter le « VIH » et en supposant que toutes les particules sont sphériques, on constate que, dans l’étude franco-allemande, les particules sont 1,14 fois plus grosses que les particules rétrovirales authentiques et que les particules du NCI sont 1,96 fois plus grosses. Ces données se traduisent par des volumes respectivement 50 % et 750 % plus importants. La densité étant le rapport entre la masse et le volume, ces particules doivent donc avoir une masse plus importante. Compte tenu du diamètre maximal des particules rétrovirales et du fait que ces particules contiennent une masse fixe d’ARN et de protéines, il semble intenable que les particules que les deux groupes (NdT : le groupe franco-allemand et le groupe du NCI) considèrent comme le « VIH » soient la même particule ou des particules rétrovirales. La seule autre explication de ces données est que les micrographies électroniques ne proviennent pas de la bande de 1,16 g/ml ou que la bande n’a pas atteint l’équilibre, auquel cas il faut redéfinir la densité de flottaison des rétrovirus.
Les particules « VIH » sont censées avoir un noyau viral de forme conique, avec des corps latéraux denses de chaque côté du noyau. Aucune caractéristique de ce type ne peut être observée dans l’EM publiée dans ces deux études. Ainsi, par définition, ces particules ne peuvent même pas être considérées comme étant de type rétrovirus.
Si l’on tient compte du fait que, dans les deux études, les cultures témoin « non infectées » étaient des cellules H9 et que Gallo affirmait déjà en 1983 que ces cellules étaient infectées par le HTLV-I, le fait que l’on n’ait pas signalé la présence de particules de type viral dans les bandes provenant de ces cultures est une énigme.
DT : Ont-elles été publiées ?
LM : Je ne pourrais pas vous le dire… nous en avons quelque part… mais ce n’est pas intéressant, pas du tout intéressant.
Les photos de 1,16 g/ml sont d’un intérêt profondément significatif. Comment savoir autrement qu’il y a là des particules de type rétrovirus, d’autant plus que même Montagnier admet que d’autres choses peuvent se retrouver dans cette bande. Pour tout scientifique qui prétend prouver l’isolement, la purification d’un rétrovirus en utilisant la bande de gradient de densité du saccharose, il est vital et absolument nécessaire d’obtenir des micrographies électroniques de la bande de 1,16 g/ml ne montrant rien d’autre que des particules de type rétrovirus.
DT : Aujourd’hui, avec la production de masse du virus, il est possible de voir une image de microscopie électronique, après purification, d’un grand nombre de virus ?
LM : Oui, oui. Absolument. On peut les voir, on voit même des bandes visibles.
Si tel est le cas, pourquoi ces données ne sont-elles pas disponibles dans la littérature scientifique ?
DT : Donc pour vous le VIH existe ?
LM : Oh, c’est clair. Je l’ai vu et je l’ai rencontré.
Dans l’un de leurs articles de 1984 (22), Montagnier et ses collègues ont écrit : « Plusieurs caractéristiques indiquent que le virus LAV ou les virus apparentés au LAV appartiennent à la famille des rétrovirus. Des particules bourgeonnantes au niveau de la membrane plasmique ont été observées en microscopie électronique. La densité du virus en gradient de saccharose est de 1,16 et une activité de transcriptase inverse dépendante du Mg2+ a été trouvée associée aux virions contenant de l’ARN ». Cependant, dans cette interview, Montagnier admet :
(a) « Nous avons publié des images de bourgeonnement qui sont caractéristiques des rétrovirus. Cela dit, sur la seule base de la morphologie, on ne pouvait pas dire qu’il s’agissait vraiment d’un rétrovirus… Avec les premières images de bourgeonnement, il pourrait s’agir d’un virus de type C. On ne peut pas distinguer… Non… enfin, après tout, oui… ça pourrait être un autre virus bourgeonnant ».
(b) à la densité de saccharose de 1,16 mg/ml, non seulement Montagnier et ses collègues n’ont pas vu de particule de rétrovirus, mais ils ont répété à plusieurs reprises qu’ils ne voyaient pas de particules de type rétroviral ;
(c) bien qu’à la densité de saccharose de 1,16 mg/ml ils aient détecté une transcription inverse de l’amorce An.dT12-18 en présence de Mg2+, ils n’avaient pas de particules et donc aucune preuve d’une « activité de transcriptase inverse associée à des virions contenant de l’ARN ».
De plus, dans cette étude (22), ils ont montré que les ADN polymérases bêta et gamma et des cellules non infectées transcrivent de manière inverse An.dT (12-18) en présence de Mg2+. Ainsi, les propres conditions et données de Montagnier ne prouvent pas son affirmation que ce qu’il a « vu » et « rencontré » est un rétrovirus. Si le « VIH » « existe », et qu’il est « clair » pour Montagnier qu’il l’a « vu » et « rencontré », où est sa preuve ?
Eleni Papadopulos-Eleopulos[1] Valendar F. Turner[2] John M. Papadimitriou[3] Barry Page[1] & David Causer[1]
[1] Département de Physique Médicale,
[2] Département de Médecine d’Urgence, Hôpital Royal de Perth, Perth, Australie de l’Ouest,
[3] Département de Pathologie, Université d’Australie de l’Ouest.