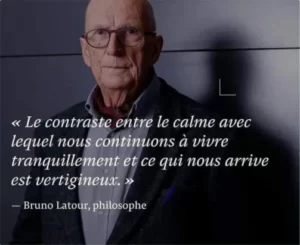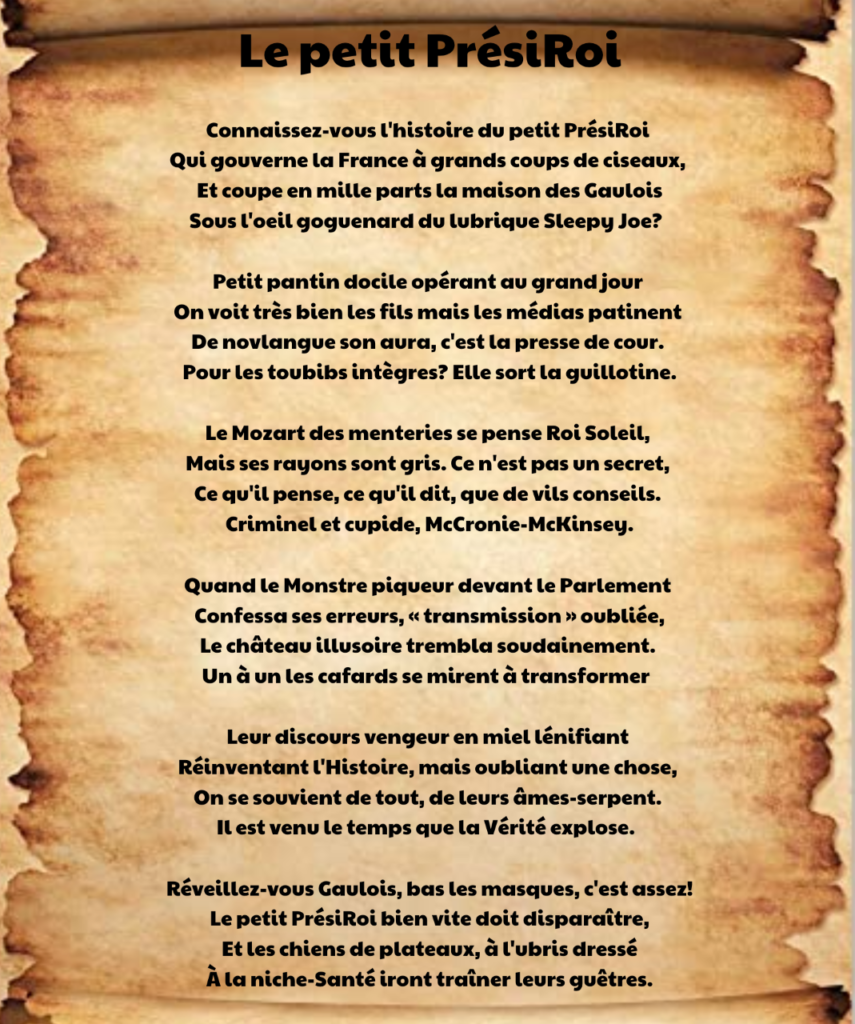Traduit de l’italien par Joël Gayraud
« fantastique poème en prose de Leopardi »
Nicolas Bonnal
Par Giacomo Leopardi
Par une matinée de printemps, Amelius, philosophe solitaire, se tenait entouré de ses livres, à l’ombre de sa maison de campagne, et lisait. Touché du chant des oiseaux qui volaient à l’entour, il se mit à les écouter et à méditer, puis abandonna sa lecture. Enfin, il prit sa plume et, sur place, écrivit ce qui suit.
Les oiseaux sont, par nature, les créatures les plus joyeuses au monde. Je ne prétends pas par là qu’à les entendre ou à les voir, l’on se réjouisse toujours ; mais je veux dire que les oiseaux, en eux-mêmes, ressentent la joie et la gaieté plus que les autres animaux. Ceux-ci paraissent d’ordinaire sérieux et graves ; nombre d’entre eux se montrent même mélancoliques : chez eux la joie ne se manifeste guère, et encore les signes en sont-ils timides et fugaces. Dans la plupart de leurs jouissances et de leurs plaisirs, jamais ils ne font fête ni ne témoignent d’allégresse. Les campagnes verdoyantes, les horizons dégagés et splendides, les soleils éclatants, les cieux cristallins et doux les charmeraient-ils, ils n’en laissent jamais rien voir ; excepté les lièvres, dont Xénophon écrit qu’aux nuits de lune, surtout lorsqu’elle est pleine, ils dansent et s’ébattent ensemble, égayés par la lumière. C’est dans leurs mouvements et leur allure que les oiseaux se montrent surtout si joyeux : et ce pouvoir qu’ils ont de nous réjouir à leur spectacle tient à ce que leurs manières et leur aspect expriment une aptitude naturelle, une inclination particulière à éprouver du plaisir et de la joie ; et c’est là une apparence qui ne saurait être tenue pour vaine et trompeuse. En effet à chacun de leurs bonheurs, à chacune de leurs satisfactions, ils se prennent à chanter ; plus ce bonheur et cette satisfaction sont vifs, plus ils mettent d’ardeur et de zèle dans leur chant ; et comme ils chantent le plus clair de leur temps, ils doivent être de belle humeur et favorisés par le plaisir. S’il est certain qu’à la saison des amours ils chantent mieux, plus souvent et plus longtemps, il ne faut pas croire qu’ils ne connaissent d’autres raisons, heureuses et agréables, de chanter. Ainsi l’on voit bien qu’ils chantent davantage par temps calme et lumineux que lorsqu’il fait sombre et que l’air est agité ; et que dans la tempête ils se taisent, comme chaque fois qu’ils sont pris de frayeur. Mais celle-ci passée, ils reviennent avec leurs chants et leurs jeux. Et, de même, ils ont coutume de chanter à l’aube, dès le réveil, poussés en partie par la joie du jour nouveau, en partie par le plaisir que prend généralement tout animal à sentir ses forces restaurées par le sommeil. Ils tirent aussi une joie extrême des riantes prairies, des vallées fertiles, des eaux pures et transparentes et de la beauté du paysage. En cela il est remarquable que ce qui nous paraît gracieux et plaisant, le leur paraisse aussi, comme on peut le voir aux leurres dont on se sert dans les oiselleries pour les attirer vers les filets et vers les pièges. L’on s’en rend compte également à la situation des lieux champêtres où ils se rassemblent en plus grand nombre et chantent avec plus de constance et d’entrain. Tandis que les autres animaux, si ce n’est peut-être ceux que l’homme a domestiqués et habitués à vivre avec lui, ne sont presque jamais sensibles à l’agrément et au charme des lieux. Et il ne faut pas s’en étonner, car ils ne sont sensibles qu’à ce qui est naturel. Or, en cette matière, la majeure partie de ce que nous appelons naturel ne l’est pas, et est bien plutôt artificiel ; ainsi, les champs cultivés, les arbres et les plantes taillés et disposés avec art, les cours d’eau endigués et détournés de leur lit, n’offrent pas l’apparence que leur eût prêtée l’état de nature. Si bien que, sans parler des villes et des autres lieux où les hommes se concentrent pour vivre, l’aspect de tout pays civilisé, depuis des générations, est purement artificiel, fort différent en cela de ce qu’il serait naturellement. Certains prétendent, ce qui conforterait notre propos, que la voix des oiseaux dans nos régions est plus délicate et plus douce, et leur chant plus harmonieux que dans celles où les habitants sont rudes et sauvages ; et ils concluent que les oiseaux, même à l’état de liberté, empruntent quelque chose à la civilisation de ces hommes dont ils côtoient les demeures.
Quoi qu’il en soit, ce fut une remarquable combinaison de la nature que d’accorder aux mêmes animaux le vol et le chant, car, ainsi, ceux qui ont à divertir les autres créatures avec la voix se rencontrent d’ordinaire dans les lieux élevés, d’où celle-ci peut se répandre plus largement à l’entour et toucher un plus grand nombre d’auditeurs ; et d’autre part, l’élément destiné au son, l’air, se trouve peuplé de créatures chantantes et musiciennes. C’est vraiment un grand réconfort et un grand plaisir que procure, autant, me semble-t-il, aux animaux qu’à nous-mêmes, le chant des oiseaux. Je crois que cela tient moins à la douceur des sons, à leur variété ou à leur harmonie, qu’à cette idée de joie qu’exprime naturellement le chant, en particulier celui-là, lequel est une sorte de rire que l’oiseau émet lorsqu’il est plongé dans le bien-être et le contentement.
Ainsi, pourrait-on dire, les oiseaux partagent avec l’homme le privilège de rire, que la nature refuse aux autres animaux ; raison pour laquelle certains pensent que l’homme, qui est défini comme un animal intelligent ou raisonnable, pourrait tout aussi bien être qualifié d’animal rieur, étant donné que le rire ne le caractérise pas moins en propre que la raison. Certes, c’est merveille qu’au fond de l’homme, de toutes les créatures la plus misérable et la plus tourmentée, réside la faculté de rire, étrangère à tout autre animal. Merveilleux aussi, l’usage que nous faisons de cette faculté, puisque jetés dans la plus cruelle infortune, accablés de chagrin, écœurés de la vie, convaincus de l’inanité des biens humains, à peu près inaccessibles à la joie et privés de tout espoir, nous n’en sommes pas moins capables de rire. Bien mieux : moins ils ignorent la vanité de ces biens, et la misère de la vie, moins ils sont aptes à espérer et à jouir, et plus ces êtres singuliers se montrent susceptibles de rire. Rire dont il est à peine possible de définir et d’élucider la nature, ses ressorts profonds et ses modes, surtout pour ce qui touche à l’âme, à moins de dire qu’il est une espèce de folie qui ne dure pas, ou même d’égarement et de délire. Car les hommes, que rien ne peut réellement charmer et satisfaire, ne peuvent jamais avoir un motif pertinent et sensé de rire. Il serait même curieux de chercher pourquoi et en quelle occasion l’homme a vraisemblablement usé et pris conscience pour la première fois de ce pouvoir. Il n’est pas douteux, en effet, qu’à l’état primitif et sauvage il se montre le plus souvent sérieux, comme les autres animaux, voire d’une apparence mélancolique. Aussi pensé-je que le rire, non seulement apparut dans le monde après les larmes — ce qui ne saurait être contesté —, mais qu’un long moment se passa avant que l’on n’en fît la première expérience. En ce temps-là, la mère ne souriait pas à son enfant, et celui-ci ne reconnaissait pas, comme dit Virgile, sa mère à son sourire. Car si aujourd’hui, du moins dans les contées civilisées, les hommes commencent à rire peu après la naissance, ils le font essentiellement en vertu de l’exemple, lorsqu’ils voient rire les autres. Et je croirais volontiers que la première occasion de rire a été donnée aux hommes par l’ivresse, cet autre caractère bien propre au genre humain. L’origine de celle-ci remonte bien avant que notre espèce connaisse aucune forme de civilisation, car il n’est pas un peuple, si grossier soit-il, qui n’ait inventé quelque boisson ou tout autre moyen de s’enivrer, et n’ait accoutumé d’en user avec passion. L’on ne saurait s’en étonner, si l’on considère que les hommes, qui sont les plus malheureux des animaux, sont séduits plus qu’aucun autre par toute forme d’aliénation non douloureuse de l’esprit, d’oubli de soi-même et, pour ainsi dire, de suspension de la vie ; ce faisant, ils annulent ou estompent pour quelque temps le sentiment et la conscience de leurs maux, ce qui pour eux n’est pas le moindre des bienfaits. On sait d’autre part que les sauvages, tristes et graves en temps normal, s’abandonnent au rire lorsqu’ils sont ivres et, contre leur habitude, se mettent alors à chanter et à parler d’abondance. Mais sur ce sujet je reviendrai longuement dans une histoire du rire, que je me propose d’écrire plus tard : là, après avoir étudié sa naissance, je poursuivrai en narrant ses exploits et ses tribulations jusqu’à nos jours où il est plus en faveur que jamais, tenant dans les nations civilisées une place et un rôle si grands qu’il remplit l’office dévolu en d’autres temps à la vertu, à la justice et à l’honneur ; c’est ainsi, par exemple, qu’il intimide parfois les hommes et les détourne de mal faire. Mais, pour conclure sur le chant des oiseaux, j’ajouterai que le spectacle de la joie chez autrui, lorsqu’il n’y a pas lieu d’en être jaloux, nous réconforte et nous égaie toujours, et que par suite il faut louer la nature d’avoir pris soin que le chant des oiseaux, qui est une manifestation d’allégresse et une sorte de rire, fût chose publique ; contrairement au chant et au rire humains qui, eu égard au reste du monde, demeurent chose privée. Et c’est par une sage disposition de la nature, que la terre et l’air sont remplis d’animaux qui, de leurs cris de joie sonores et incessants, applaudissent tout le jour à l’existence universelle et incitent à l’allégresse les autres créatures, en leur délivrant le témoignage perpétuel, quoique mensonger, de la félicité des choses.
Si les oiseaux se montrent et sont effectivement plus joyeux que les autres animaux, ce n’est pas sans raison. En vérité, comme je l’ai indiquée d’emblée, ils sont, par nature, mieux disposés au plaisir et au bonheur. D’abord, ils semblent ignorer l’ennui ; ils changent de lieu à tout instant, passant d’un pays à un autre, insoucieux des distances, s’élevant d’un trait, avec une aisance stupéfiante, depuis le niveau du sol jusqu’aux régions les plus hautes de l’air. Ils ressentent au cours de l’existence une infinité d’impressions différentes ; ils se dépensent physiquement sans compter et débordent, pour ainsi dire, de vie extérieure. Les autres animaux, sitôt qu’ils ont pourvu à leurs besoins, aiment à se tenir en paix, à rester oisifs ; aucun, hormis les poissons et quelques insectes, ne se livre aux courses lointaines pour le seul plaisir. À moins qu’il ne soit chassé par la tempête, les fauves ou quelque autre calamité, l’homme primitif ne se déplace qu’à peine, excepté pour subvenir à ses besoins, ce qui ne lui coûte que peu de temps et d’efforts. Il chérit par-dessus tout le loisir et le repos, et passe nonchalamment presque tout le jour à paresser à l’intérieur de sa hutte informe, ou bien au grand air, ou encore à l’abri de quelque faille au creux des rochers. Les oiseaux, au contraire, ne tiennent jamais en place ; ils vont et viennent sans nécessité, se plaisant à voler par jeu, et s’éloignent ainsi parfois à des centaines de milles de leur séjour habituel, pour finalement revenir avant le soir, dans la même journée. Dans le court instant où ils demeurent au même endroit, ils s’agitent toujours de côté et d’autre, tournoient, ploient leur col, étirent leurs ailes, s’ébrouent et virevoltent, avec une aisance, une vivacité, une promptitude indicibles. Bref, depuis l’heure où il sort de l’œuf, jusqu’à celle de sa mort, l’oiseau, mis à part la coupure des sommeils, ne se repose jamais. De ces observations il semble possible de conclure que, si l’état naturel des autres animaux ainsi que de l’homme est le repos, celui des oiseaux est le mouvement.
À ces caractéristiques extérieures correspondent des qualités internes, propres au domaine de l’âme, lesquelles leur assurent également une plus grande aptitude au bonheur. Ils ont l’ouïe si fine, la vue si perçante et si parfaite, qu’on ne peut que difficilement s’en faire une représentation exacte. Ces facultés leur permettent de jouir tout le jour de spectacles immenses, sans cesse changeants, car de là-haut, ils découvrent d’un coup d’œil une telle étendue de terre et distinguent tant de lieux différents que même par l’esprit, l’homme ne saurait les embrasser aussi vite. On peut en déduire que c’est chez les oiseaux que l’imagination atteint son plus haut degré de vivacité et de puissance. Non point cette imagination profonde, fébrile, orageuse, qui fut celle de Dante et du Tasse, don funeste, lourd d’angoisses et de tourments perpétuels, mais une imagination riche, variée, légère, instable et enfantine, source inépuisable de pensées aimables et joyeuses, de tendres illusions, de jouissance et de plénitude, et qui est le présent le plus précieux que puisse accorder la nature à une âme vivante. Ainsi, de cette faculté, les oiseaux recueillent-ils à profusion ce qui favorise l’épanouissement de l’âme, non ce qui lui pèse et la chagrine. Et de même qu’ils abondent de vie extérieure, mais de telle sorte que cette abondance leur soit heureuse et profitable comme chez les enfants, sans jamais devenir cause de souffrance et de détresse, comme c’est le cas pour la plupart des hommes. En effet, pour l’agilité et la vivacité du corps, l’enfant et l’oiseau présentent des similitudes évidentes, qui laissent raisonnablement supposer qu’ils se ressemblent ainsi pour les qualités de l’âme. On voit que si les biens de l’enfance étaient communs aux autres âges, et si les maux qui affectent ceux-ci n’excédaient pas les misères de nos premières années, nous aurions peut-être quelque raison de supporter patiemment la vie.
À mon sens, la nature des oiseaux, sous certains aspects, dépasse en perfection celle des autres animaux. Par exemple, dans les domaines de la vue et de l’ouïe, qui, suivant l’ordre naturel des êtres animés, sont considérés comme les sens principaux, l’oiseau l’emporte très largement. De surcroît, comme on l’a déjà vu, les oiseaux, à la différence des autres créatures, sont particulièrement enclins à se mouvoir ; or le mouvement ressemble plus à la vie que le repos — on peut même dire que la vie est mouvement — et les oiseaux sont déjà nantis au plus haut degré de cette aptitude-là. En outre, la vue et l’ouïe, qui sont leurs facultés dominantes, sont les deux sens qui caractérisent le mieux les êtres vivants, car ils sont les plus mobiles, tant en eux-mêmes que pour les comportements et les émotions qu’ils induisent chez l’animal. Enfin, en tenant compte de tout ce qui vient d’être exposé, on conclura sans peine que l’oiseau est, de toutes les créatures, celle qui jouit de la plus grande richesse de vie intérieure et extérieure. Or, si la vie est plus parfaite que son contraire, du moins chez les créatures vivantes, et si une plus grande abondance de vie indique une plus grande perfection, il s’ensuit que les oiseaux sont également capables de supporter le froid et la chaleur extrêmes, et de passer de l’un à l’autre sans transition, comme on le voit aisément lorsqu’ils quittent la terre pour s’élever en un instant jusqu’aux régions les plus hautes du ciel, où règnent des températures glaciales, ou quand nombre d’entre eux migrent en quelques jours sous des climats très différents.
Enfin, comme Anacréon, qui désirait se changer en miroir pour être sans cesse contemplé par celle qu’il aimait, ou en tunique pour la vêtir, en baume pour oindre son corps, en eau pour la baigner, en bandelette pour être serré sur son sein, en perle pour être suspendu à son cou, ou en soulier pour qu’au moins elle le pressât de son pied, de même, moi, je voudrais un moment me transformer en oiseau pour connaître le contentement et la joie qu’ils éprouvent à vivre.
Leopardi, Giacomo (1798-1837) Ecrivain italien. Il est plus célèbre comme poète pour un mince recueil d’une quarantaine de Poésies lyriques (Canti) et pour une burlesque Batrachomyomachie, que pour son œuvre en prose, bien plus considérable : neuf volumes de journal (Zibaldone), 101 Pensées dont plus d’une évoque Pascal, sans la foi, et 27 Operette morali, où le lecteur s’étonne de trouver un tout autre homme que « le sombre amant de la mort » auquel s’adressait Musset dans Après une lecture. Certaines sont dialoguées avec une saveur digne de La Bruyère. Ecrire a certainement été pour Leopardi une revanche prise sur ses misères physiques, sentimentales et même pécuniaires. Sa vie et son œuvre sont une poignante leçon de courage intellectuel et moral.